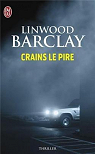Critiques à l'affiche
La promesse de l'aube (1956)
Fan de la grave drôlerie et du style percutant de Emile Ajar, je me suis décidée à remonter à la source. C'est ainsi que j'ai plongé dans le récit autobiographique de son enfance, de la relation avec une mère possessive et de son engagement dans la guerre : La promesse de l'aube.
Ce titre poétiquement énigmatique est expliqué dès les premières pages (citation célèbre) : « Avec l'amour maternel, la vie vous fait, à l'aube, une promesse qu'elle ne tient jamais. Chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son coeur, ce ne sont plus que des condoléances.» Tout étudiant en psychologie devrait lire ces pages et ces pages d'identification à une mère étouffante, épuisante, vaillante, d'affabulations et d'arrangements permanents avec la réalité, décrite à l'appui de détails croustillants et historiques dans l'Europe bien réelle et fascinante de 1920 à 1944.
J'ai trouvé cette lecture éprouvante. On ne sort pas indemne de l'univers élégant de Romain Gary, un univers qui a débuté il y a 100 ans, dans un monde sans télévision mais plein de livres, où l'imaginaire sans entraves cohabitait avec l'âpreté de la vie et l'héroïsme de la guerre.
Je suis incapable de décoder ce mélange improbable de finesse d'esprit, d'immense culture, d'enfant délicat, d'homme seul, d'écrivain remarquable. Je suis une lectrice perturbée, ma tête s'est transformée en kaléidoscope, je ne sais plus qui ou quoi je lis. Tout est dingue en permanence, jusqu'au moment où cela ne l'est plus. C'est alors qu'émergent de nulle part des pépites philosophiques du fils à maman ou du pilote médaillé, comme celle-ci : « Tout ce que la vieillesse a "appris" est en réalité tout ce qu'elle a oublié. » Il n'y a pas de sérénité, ni de sagesse, ni d'indulgence, il y a juste de l'oubli.
Lancinant est son désespoir en l'humanité, tragique est sa conscience d'une défectuosité personnelle, juste est sa tendresse pour l'animal. On ne sort pas indemne de l'univers de Romain Gary.
Fan de la grave drôlerie et du style percutant de Emile Ajar, je me suis décidée à remonter à la source. C'est ainsi que j'ai plongé dans le récit autobiographique de son enfance, de la relation avec une mère possessive et de son engagement dans la guerre : La promesse de l'aube.
Ce titre poétiquement énigmatique est expliqué dès les premières pages (citation célèbre) : « Avec l'amour maternel, la vie vous fait, à l'aube, une promesse qu'elle ne tient jamais. Chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son coeur, ce ne sont plus que des condoléances.» Tout étudiant en psychologie devrait lire ces pages et ces pages d'identification à une mère étouffante, épuisante, vaillante, d'affabulations et d'arrangements permanents avec la réalité, décrite à l'appui de détails croustillants et historiques dans l'Europe bien réelle et fascinante de 1920 à 1944.
J'ai trouvé cette lecture éprouvante. On ne sort pas indemne de l'univers élégant de Romain Gary, un univers qui a débuté il y a 100 ans, dans un monde sans télévision mais plein de livres, où l'imaginaire sans entraves cohabitait avec l'âpreté de la vie et l'héroïsme de la guerre.
Je suis incapable de décoder ce mélange improbable de finesse d'esprit, d'immense culture, d'enfant délicat, d'homme seul, d'écrivain remarquable. Je suis une lectrice perturbée, ma tête s'est transformée en kaléidoscope, je ne sais plus qui ou quoi je lis. Tout est dingue en permanence, jusqu'au moment où cela ne l'est plus. C'est alors qu'émergent de nulle part des pépites philosophiques du fils à maman ou du pilote médaillé, comme celle-ci : « Tout ce que la vieillesse a "appris" est en réalité tout ce qu'elle a oublié. » Il n'y a pas de sérénité, ni de sagesse, ni d'indulgence, il y a juste de l'oubli.
Lancinant est son désespoir en l'humanité, tragique est sa conscience d'une défectuosité personnelle, juste est sa tendresse pour l'animal. On ne sort pas indemne de l'univers de Romain Gary.
C'est en visionnant un énième reportage sur l'anniversaire de la bataille de Camerone le 30 avril, que l'envie m'a enfin titillé de me documenter sérieusement, c'est à dire en lisant un travail d'historien documenté.
Mon choix s'est porté sur cet excellent livre de André-Paul Comor, un ouvrage très bien structuré et documenté. Camarón, car c'est ainsi que cela s'écrit exactement, c'était pour moi de vagues souvenirs, la campagne du Mexique, le destin funeste de l'Empereur Maximilien et ... le fameux combat livré par la 3e compagnie de la Légion Etrangère dont on a tous entendu parler un jour.
J'ai aimé cette lecture car elle est instructive, l'auteur nous parle du contexte avec précision, Napoléon III et le Second Empire, l'Impératrice Eugénie et son influence sur la décision d'envoyer des troupes au Mexique et offrir un titre d'Empereur à Maximilien. Mais surtout l'auteur va nous instruire sur la Légion Etrangère, ses origines et sa situation d'alors au moment d'envoyer les premières troupes au Mexique, figurez vous que les légionnaires, boudés par le haut commandement militaire, feront "des pieds et des mains" pour faire partie de l'expédition et aller "au feu", ce qui finira par être entendu pour leur plus grande fierté.
Une autre partie du livre est consacrée aux hommes qui sont entrés dans l'histoire à Camarón, on sait peu de choses les concernant, leur parcours est celui de soldats de métier, de gens en quête d'aventures et de danger, n'oublions pas que la Légion Etrangère, comme son nom le laisse deviner, est pour les deux tiers composée d'étrangers, seul l'encadrement est essentiellement français.
Il sera aussi et bien sûr question de la fameuse bataille du jeudi 30 avril 1863, où les 63 hommes du capitaine Danjou retranchés dans une hacienda vont résister pendant onze heures à 2 000 ennemis, accablés par la chaleur et la soif. A la fin, le bilan sera d'environ 300 tués et autant de blessés côté mexicain. Sur les 64 combattants français, 24 seront finalement faits prisonniers, tous sont blessés et la plupart mourront en captivité.
La dernière partie du livre nous parle de la légende de Camerone, elle mettra près d'un un siècle à se ritualiser et a être célébrée chaque année désormais dans tous les casernements de la Légion à travers le monde. C'est à Aubagne que la main articulée du capitaine Danjou est conservée dans sa chasse telle une relique et sortie à chaque commémoration, le tout étant expliqué par l'auteur qui s'est remarquablement documenté.
Je livre ici une citation du général Olié : "On peut même se demander si c'est la Légion qui a idéalisé Camerone ou si c'est Camerone qui a fécondé la Légion, quelle est la part de légende ajoutée à cette lutte épique et quelle est la part d'héroïsme issue au fil des ans de cet exemple exaltant."
Si j'aime L Histoire, je dois concéder de nombreuses lacunes à tout ce qui vient après 1816 et Waterloo, pour Camerone, c'est désormais réparé, j'ai été passionné par cette lecture.
J'ai tout de même un petit bémol à exprimer, l'auteur s'est de façon évidente un peu enflammé en racontant les combats. A le lire, on se demande si les légionnaires étaient vraiment au nombre d'une soixantaine tant le ton mélodramatique les mettait en situation désespérée dès la première heure des combats face à une marée d'adversaires braves et ivres de rage...
Pour conclure, il s'agit d'un bon livre sur le sujet et son contexte.
Mon choix s'est porté sur cet excellent livre de André-Paul Comor, un ouvrage très bien structuré et documenté. Camarón, car c'est ainsi que cela s'écrit exactement, c'était pour moi de vagues souvenirs, la campagne du Mexique, le destin funeste de l'Empereur Maximilien et ... le fameux combat livré par la 3e compagnie de la Légion Etrangère dont on a tous entendu parler un jour.
J'ai aimé cette lecture car elle est instructive, l'auteur nous parle du contexte avec précision, Napoléon III et le Second Empire, l'Impératrice Eugénie et son influence sur la décision d'envoyer des troupes au Mexique et offrir un titre d'Empereur à Maximilien. Mais surtout l'auteur va nous instruire sur la Légion Etrangère, ses origines et sa situation d'alors au moment d'envoyer les premières troupes au Mexique, figurez vous que les légionnaires, boudés par le haut commandement militaire, feront "des pieds et des mains" pour faire partie de l'expédition et aller "au feu", ce qui finira par être entendu pour leur plus grande fierté.
Une autre partie du livre est consacrée aux hommes qui sont entrés dans l'histoire à Camarón, on sait peu de choses les concernant, leur parcours est celui de soldats de métier, de gens en quête d'aventures et de danger, n'oublions pas que la Légion Etrangère, comme son nom le laisse deviner, est pour les deux tiers composée d'étrangers, seul l'encadrement est essentiellement français.
Il sera aussi et bien sûr question de la fameuse bataille du jeudi 30 avril 1863, où les 63 hommes du capitaine Danjou retranchés dans une hacienda vont résister pendant onze heures à 2 000 ennemis, accablés par la chaleur et la soif. A la fin, le bilan sera d'environ 300 tués et autant de blessés côté mexicain. Sur les 64 combattants français, 24 seront finalement faits prisonniers, tous sont blessés et la plupart mourront en captivité.
La dernière partie du livre nous parle de la légende de Camerone, elle mettra près d'un un siècle à se ritualiser et a être célébrée chaque année désormais dans tous les casernements de la Légion à travers le monde. C'est à Aubagne que la main articulée du capitaine Danjou est conservée dans sa chasse telle une relique et sortie à chaque commémoration, le tout étant expliqué par l'auteur qui s'est remarquablement documenté.
Je livre ici une citation du général Olié : "On peut même se demander si c'est la Légion qui a idéalisé Camerone ou si c'est Camerone qui a fécondé la Légion, quelle est la part de légende ajoutée à cette lutte épique et quelle est la part d'héroïsme issue au fil des ans de cet exemple exaltant."
Si j'aime L Histoire, je dois concéder de nombreuses lacunes à tout ce qui vient après 1816 et Waterloo, pour Camerone, c'est désormais réparé, j'ai été passionné par cette lecture.
J'ai tout de même un petit bémol à exprimer, l'auteur s'est de façon évidente un peu enflammé en racontant les combats. A le lire, on se demande si les légionnaires étaient vraiment au nombre d'une soixantaine tant le ton mélodramatique les mettait en situation désespérée dès la première heure des combats face à une marée d'adversaires braves et ivres de rage...
Pour conclure, il s'agit d'un bon livre sur le sujet et son contexte.
Ayant besoin d'une lecture facile et divertissante, j'ai décidé de renouer avec mes anciennes amours : les romans anglais abritant de mystérieux manoirs entre la fin du XIXe siècle, et le début du 20e.
.
Les fêlures de Wakefield Manor s'est révélé être une très bonne pioche, allant plus loin que ce que j'en attendais en termes de manipulation et de manigances, de secrets et de révélations. Je fais donc une courte apparition ici pour vous le présenter.
.
Je me suis seulement demandé s'il était réellement aussi facile de faire interner les femmes au début du XXe siècle, surtout quand ce n'était pas par leur propre famille. Si c'était le cas, nul doute que beaucoup d'abus auront permis de fomenter des intrigues surprenantes, comme celle de ce roman.
.
Mais il ne s'agit que d'une toute petite part de cette histoire brillamment racontée et construite. Elle commence lorsque, pour faciliter le deuil de son mari, Honoria, issue de l'aristocratie, décide de devenir la préceptrice des enfants d'une famille de riches industriels à Wakefield Manor. Si sa personnalité gracieuse facilite son intégration, elle a cependant la sensation que plus elle se rapproche de chaque personnage, plus le décor s'effrite. Trois hommes lui feront la cour, mais qui sont-ils réellement ? Une fille manquera à l'appel, une autre sera son amie, l'autre la haïra, la dernière la vénèrera. Parmi les domestiques et les autres occupants du château, il sera parfois difficile de savoir à qui se fier et de qui se méfier. Mais pourquoi se méfier ? Les parents quant à eux offriront un masque qui ne cessera de se fendiller jusqu'à ce que l'on trouve enfin ce qui ne collait pas.
.
Il se trouve que le lecteur, grâce à un récit alternant deux temporalités ( 1870 et 1910), devinera assez vite les trois quarts de l'histoire. Par ailleurs, et contrairement à l'agaçante Agatha Christie, l'auteur ici placera régulièrement des indices à notre portée, afin que nous suivions avec attention son jeu de piste. Mais Honoria, ne possédant que les preuves qu'elle découvrira malgré elle durant son séjour au manoir, fera durer le suspense jusqu'à la fin, nous torturant avec délices de nos incertitudes et blancs restant à combler.
.
Une intrigue efficace aux rebondissements bien rythmés, à l'ambiance idéalement feutrée et aux personnages bien construits. Grand plaisir de lecture malgré, peut-être, l'apparente facilité de l'une des péripéties.
.
Le petit plus : une playlist pour débuter chaque chapitre dans l’ambiance adéquate, j’ai adoré !
.
Les fêlures de Wakefield Manor s'est révélé être une très bonne pioche, allant plus loin que ce que j'en attendais en termes de manipulation et de manigances, de secrets et de révélations. Je fais donc une courte apparition ici pour vous le présenter.
.
Je me suis seulement demandé s'il était réellement aussi facile de faire interner les femmes au début du XXe siècle, surtout quand ce n'était pas par leur propre famille. Si c'était le cas, nul doute que beaucoup d'abus auront permis de fomenter des intrigues surprenantes, comme celle de ce roman.
.
Mais il ne s'agit que d'une toute petite part de cette histoire brillamment racontée et construite. Elle commence lorsque, pour faciliter le deuil de son mari, Honoria, issue de l'aristocratie, décide de devenir la préceptrice des enfants d'une famille de riches industriels à Wakefield Manor. Si sa personnalité gracieuse facilite son intégration, elle a cependant la sensation que plus elle se rapproche de chaque personnage, plus le décor s'effrite. Trois hommes lui feront la cour, mais qui sont-ils réellement ? Une fille manquera à l'appel, une autre sera son amie, l'autre la haïra, la dernière la vénèrera. Parmi les domestiques et les autres occupants du château, il sera parfois difficile de savoir à qui se fier et de qui se méfier. Mais pourquoi se méfier ? Les parents quant à eux offriront un masque qui ne cessera de se fendiller jusqu'à ce que l'on trouve enfin ce qui ne collait pas.
.
Il se trouve que le lecteur, grâce à un récit alternant deux temporalités ( 1870 et 1910), devinera assez vite les trois quarts de l'histoire. Par ailleurs, et contrairement à l'agaçante Agatha Christie, l'auteur ici placera régulièrement des indices à notre portée, afin que nous suivions avec attention son jeu de piste. Mais Honoria, ne possédant que les preuves qu'elle découvrira malgré elle durant son séjour au manoir, fera durer le suspense jusqu'à la fin, nous torturant avec délices de nos incertitudes et blancs restant à combler.
.
Une intrigue efficace aux rebondissements bien rythmés, à l'ambiance idéalement feutrée et aux personnages bien construits. Grand plaisir de lecture malgré, peut-être, l'apparente facilité de l'une des péripéties.
.
Le petit plus : une playlist pour débuter chaque chapitre dans l’ambiance adéquate, j’ai adoré !
Il y a certes bien des fulgurances géniales ou profondes, le thème est très fort, mais, cette quête évidente du roman philosophique le rend un peu pesant dans le style et dans le rythme, à mon goût. Ton descriptif, explicatif, didactique aidant, la monotonie s'installe et, au milieu du roman, j'ai eu moins envie de poursuivre. Sans doute voulu par le grand Camus, la souffrance continue des hommes ayant en soi quelque chose de profondément monotone. J'avais adoré l'Etranger, lu au moins deux fois.
Mais au milieu de La Peste, j'ai mis le livre en pose (temporaire?), lui préférant l'excellente récente mini série qu'il a inspiré et qui a ajouté, avec beaucoup de bonheur, dans l'intrigue originale des ressorts et des personnages captivants.
Mais au milieu de La Peste, j'ai mis le livre en pose (temporaire?), lui préférant l'excellente récente mini série qu'il a inspiré et qui a ajouté, avec beaucoup de bonheur, dans l'intrigue originale des ressorts et des personnages captivants.
Publié en 1959 par Philip K. Dick, « Le temps désarticulé » n’a ni l’aura de son chef d’oeuvre « Ubik », ni celle du « Maître du Haut Château ». Si ce roman n’atteint ni la perfection formelle d’ « Ubik », ni la puissance évocatrice de l’uchronie qui rendit l’auteur célèbre, il recèle déjà tous les tropes de l’oeuvre foisonnante du génie américain : dissolution du temps, et donc du réel, paranoïa à tous les étages, énigmes borgésiennes, goût prononcé pour une ironie teintée d’étrangeté. Comme dans d’autres ouvrages dits « mineurs », on y retrouve une forme de fraîcheur, voire d’humour potache, qui font du « temps désarticulé » un ouvrage aussi touchant qu’attachant.
Le texte qui suit est un pastiche décalé, dont l’objet est de rendre la « couleur » de ce roman typiquement dickien.
***
2020. Le premier confinement. C’est là que tout a basculé. Je venais de tondre, j’avais taillé mes haies et je sirotais une bière dans ma chaise longue. Désoeuvré. Je me suis connecté sur le net à la recherche d’informations sur un roman et j’ai rejoint la matrice. Un site d’apparence anodine, où des lecteurs publient des critiques souvent enthousiastes de leur dernière lecture. C’est ce jour-là que je me suis inscrit et que j’ai commencé à « poster » des critiques.
À l’époque, on envoyait un message pour devenir amis, depuis, on se contente de s’abonner. 181 abonnés à ce jour, un nombre premier. Un signal faible ? Qui me rappelle ce mantra que je répétais tous les matins : « Seuls les paranoïaques survivent. » Un mantra qui m’a valu d’être interné dans les années 90, des hommes en blouse blanche ont effacé ma mémoire à coup d’électrochocs. Enfin, ils ont cru avoir effacé ma mémoire, et m’ont relâché dans le meilleur des mondes.
Depuis ce premier confinement, où il n’a pas plu un seul jour (étrange ce temps méditerranéen au coeur de la Normandie), dans ce petit village si bien tenu, qui évoque un paradis oublié, la paranoïa est revenue. Qui sont ces voisins si sympathiques ? Sont-ils réels ? Pourquoi leurs haies sont-elles mieux taillées que ma barbe ? Je me souviens d’un film, comment s’appelait-il déjà ? « Le Truman Show », où Jim Carrey vit dans une réalité factice, trop belle pour être honnête, un décor de cinéma.
Mes angoisses ont recommencé, des cauchemars terrifiants envahissent mes nuits. Je marche des heures, je travaille au jardin, je lis et je me connecte à la matrice. Babelio, c’est son nom. Une référence étrange à la tour de Babel. Chaque semaine, je poste consciencieusement une critique sur le site, je compte le nombre de « like », 13, 31, 47, que des nombres premiers. Est-ce une énigme que m’adresse la matrice ? Les autres utilisateurs sont-ils réels ? Ou s’agit-il de robots, d’I.A. dernier cri, qui écrivent des critiques à intervalle régulier. J’échange parfois en MP avec une certaine AnnaCan, mais je me méfie, est-elle humaine ou s’agit-il d’une I.A. conversationnelle ?
La matrice me propose régulièrement de m’envoyer des livres en échange d’une critique. Une proposition qui évoque un piège. Donner mon adresse ? Hors de question. Je brouille mon adresse IP à chaque fois que je me connecte. « Seuls les paranos survivent ». Hier soir, je suis tombé en montant l’escalier, au moment de poser le pied sur la dernière marche, je n’ai trouvé que le vide, elle avait disparu. Un peu sonné par ma chute, j’ai voulu allumer une vieille lampe qui se trouve sur ma droite, en tirant sur le fil qui sert d’interrupteur. Ma main rencontre le néant, la lampe a disparu elle aussi.
Mes souvenirs sont pourtant nets, c’est le temps qui s’est désarticulé. J’aurais dû me tenir à l’écart de la matrice. Les critiques ne sont qu’un prétexte. La seule chose qui compte est le nombre de likes. Je l’ai compris depuis le début. Il est de mon devoir de continuer à poster des critiques sur le site. Dès que je m’arrête, je reçois des messages d’autres membres du site qui me demandent comment je vais, quand je reviens. J’en conclus que les nombres de likes que reçoivent mes critiques sont importants, peut-être même nécessaires. Qu’ils signifient quelque chose.
Chaque nuit, je refais le même cauchemar, où des bombes H pleuvent comme dans la chanson de Bob Dylan, « A Hard Rain’s A-gonna fall ». Au réveil, je comprends, les likes indiquent les coordonnées visées par les têtes nucléaires envoyées par l’Ennemi. Et permettent à nos missiles anti-missiles de les détruire avant leur entrée dans l’atmosphère. Voilà pourquoi ma mission est si importante, il faut continuer à alimenter la matrice en chroniques, pour générer des likes, qui indiquent à notre système de défense où frapper.
Me voilà condamné, à écrire des critiques, encore et encore, tant que la menace n’aura pas été éradiquée. Pendant que le temps se délite, que les objets disparaissent, au point qu’en conduisant jusqu’au supermarché, j’ai aperçu la route qui défilait sous mes pieds. Comment saurai-je que la Menace nucléaire n’est plus qu’un souvenir ? Le temps va-t-il continuer à se désagréger ? Je suis très inquiet, mais je me rassure en me répétant, chaque jour, le mantra qui m’a toujours sauvé, « Seuls les paranos survivent ».
***
Je remercie Anna@AnnaCan qui a accepté de figurer dans ce pastiche, et m’a suggéré plusieurs améliorations pertinentes après avoir relu une première mouture de ce texte.
Le texte qui suit est un pastiche décalé, dont l’objet est de rendre la « couleur » de ce roman typiquement dickien.
***
2020. Le premier confinement. C’est là que tout a basculé. Je venais de tondre, j’avais taillé mes haies et je sirotais une bière dans ma chaise longue. Désoeuvré. Je me suis connecté sur le net à la recherche d’informations sur un roman et j’ai rejoint la matrice. Un site d’apparence anodine, où des lecteurs publient des critiques souvent enthousiastes de leur dernière lecture. C’est ce jour-là que je me suis inscrit et que j’ai commencé à « poster » des critiques.
À l’époque, on envoyait un message pour devenir amis, depuis, on se contente de s’abonner. 181 abonnés à ce jour, un nombre premier. Un signal faible ? Qui me rappelle ce mantra que je répétais tous les matins : « Seuls les paranoïaques survivent. » Un mantra qui m’a valu d’être interné dans les années 90, des hommes en blouse blanche ont effacé ma mémoire à coup d’électrochocs. Enfin, ils ont cru avoir effacé ma mémoire, et m’ont relâché dans le meilleur des mondes.
Depuis ce premier confinement, où il n’a pas plu un seul jour (étrange ce temps méditerranéen au coeur de la Normandie), dans ce petit village si bien tenu, qui évoque un paradis oublié, la paranoïa est revenue. Qui sont ces voisins si sympathiques ? Sont-ils réels ? Pourquoi leurs haies sont-elles mieux taillées que ma barbe ? Je me souviens d’un film, comment s’appelait-il déjà ? « Le Truman Show », où Jim Carrey vit dans une réalité factice, trop belle pour être honnête, un décor de cinéma.
Mes angoisses ont recommencé, des cauchemars terrifiants envahissent mes nuits. Je marche des heures, je travaille au jardin, je lis et je me connecte à la matrice. Babelio, c’est son nom. Une référence étrange à la tour de Babel. Chaque semaine, je poste consciencieusement une critique sur le site, je compte le nombre de « like », 13, 31, 47, que des nombres premiers. Est-ce une énigme que m’adresse la matrice ? Les autres utilisateurs sont-ils réels ? Ou s’agit-il de robots, d’I.A. dernier cri, qui écrivent des critiques à intervalle régulier. J’échange parfois en MP avec une certaine AnnaCan, mais je me méfie, est-elle humaine ou s’agit-il d’une I.A. conversationnelle ?
La matrice me propose régulièrement de m’envoyer des livres en échange d’une critique. Une proposition qui évoque un piège. Donner mon adresse ? Hors de question. Je brouille mon adresse IP à chaque fois que je me connecte. « Seuls les paranos survivent ». Hier soir, je suis tombé en montant l’escalier, au moment de poser le pied sur la dernière marche, je n’ai trouvé que le vide, elle avait disparu. Un peu sonné par ma chute, j’ai voulu allumer une vieille lampe qui se trouve sur ma droite, en tirant sur le fil qui sert d’interrupteur. Ma main rencontre le néant, la lampe a disparu elle aussi.
Mes souvenirs sont pourtant nets, c’est le temps qui s’est désarticulé. J’aurais dû me tenir à l’écart de la matrice. Les critiques ne sont qu’un prétexte. La seule chose qui compte est le nombre de likes. Je l’ai compris depuis le début. Il est de mon devoir de continuer à poster des critiques sur le site. Dès que je m’arrête, je reçois des messages d’autres membres du site qui me demandent comment je vais, quand je reviens. J’en conclus que les nombres de likes que reçoivent mes critiques sont importants, peut-être même nécessaires. Qu’ils signifient quelque chose.
Chaque nuit, je refais le même cauchemar, où des bombes H pleuvent comme dans la chanson de Bob Dylan, « A Hard Rain’s A-gonna fall ». Au réveil, je comprends, les likes indiquent les coordonnées visées par les têtes nucléaires envoyées par l’Ennemi. Et permettent à nos missiles anti-missiles de les détruire avant leur entrée dans l’atmosphère. Voilà pourquoi ma mission est si importante, il faut continuer à alimenter la matrice en chroniques, pour générer des likes, qui indiquent à notre système de défense où frapper.
Me voilà condamné, à écrire des critiques, encore et encore, tant que la menace n’aura pas été éradiquée. Pendant que le temps se délite, que les objets disparaissent, au point qu’en conduisant jusqu’au supermarché, j’ai aperçu la route qui défilait sous mes pieds. Comment saurai-je que la Menace nucléaire n’est plus qu’un souvenir ? Le temps va-t-il continuer à se désagréger ? Je suis très inquiet, mais je me rassure en me répétant, chaque jour, le mantra qui m’a toujours sauvé, « Seuls les paranos survivent ».
***
Je remercie Anna@AnnaCan qui a accepté de figurer dans ce pastiche, et m’a suggéré plusieurs améliorations pertinentes après avoir relu une première mouture de ce texte.
Un jour ou l'autre, je reviens vers mes auteurs fétiches.
Cette fois, c'est Linwood Barclay qui s'y colle.
Père d'une ado, Syd, qu'il couve comme le lait sur le feu, Tim, divorcé, a un petit accrochage avec sa fille au moment oú elle part travailler.
Il culpabilise et a hâte de voir le soir arriver pour discuter avec Syd.
Seulement ce soir-là, elle ne rentre pas.
L'affolement le gagne, il appelle son ex-femme avec laquelle il est resté en très bons termes, malgré l'animosité de Bob, son nouveau mari.
Les heures passent, puis les jours, et toujours aucune nouvelle de Syd.
Alors il va se mettre à sa recherche.
C'est du Linwood Barclay, et je savais que le sort s'acharnerait sur le héros.
Et en effet, ça bouge pas mal, entre fausses pistes, tueurs â ses trousses...
Les balles volent bas. La police est plutôt molle, hormis pour l'enquiquiner...
Tim est l'unique narrateur de cette histoire, et c'était un peu longuet.
Il m'a fallu un moment pour lire le bouquin, même compte tenu de mon absence la semaine dernière.
La chute est surprenante. Je n'ai rien vu venir.
Un roman sympa, pas prise de tête, à lire sur la plage ou en squattant une terrasse quelconque en sirotant un verre d'eau du robinet. :)
J'en lirai d'autres, bien entendu, mais quand ? Les paris sont ouverts.
Cette fois, c'est Linwood Barclay qui s'y colle.
Père d'une ado, Syd, qu'il couve comme le lait sur le feu, Tim, divorcé, a un petit accrochage avec sa fille au moment oú elle part travailler.
Il culpabilise et a hâte de voir le soir arriver pour discuter avec Syd.
Seulement ce soir-là, elle ne rentre pas.
L'affolement le gagne, il appelle son ex-femme avec laquelle il est resté en très bons termes, malgré l'animosité de Bob, son nouveau mari.
Les heures passent, puis les jours, et toujours aucune nouvelle de Syd.
Alors il va se mettre à sa recherche.
C'est du Linwood Barclay, et je savais que le sort s'acharnerait sur le héros.
Et en effet, ça bouge pas mal, entre fausses pistes, tueurs â ses trousses...
Les balles volent bas. La police est plutôt molle, hormis pour l'enquiquiner...
Tim est l'unique narrateur de cette histoire, et c'était un peu longuet.
Il m'a fallu un moment pour lire le bouquin, même compte tenu de mon absence la semaine dernière.
La chute est surprenante. Je n'ai rien vu venir.
Un roman sympa, pas prise de tête, à lire sur la plage ou en squattant une terrasse quelconque en sirotant un verre d'eau du robinet. :)
J'en lirai d'autres, bien entendu, mais quand ? Les paris sont ouverts.
Comme promis, j'ai laissé passer la vague déferlante des critiques sur ce livre pour m'en emparer à mon tour.
Le 11 octobre 1932, nous faisons cnonaissance avec le narrateur, surnommé La Teigne.
C'est l'heure de la cantine dans la colonie pénitentiaire pour mineurs de Belle-Ïle-en-mer.
"Tous sont tête basse, le nez dans leur écuelle à chien. Ils bouffent, ils lapent, ils saucent leur pâtée sans un bruit. Interdit à table, le bruit. Le réfectoire doit être silencieux".
Ces enfants sont emprisonnés pour menus larcins, ou pour avoir commis le crime d'être orphelins.
La Teigne par exemple, mère partie voir si l'herbe était plus verte ailleurs, père démissionnaire, grands-parents qui s'en fichent.
Le jour où il a été traîné au tribunal pour une bêtise dont il a été reconnu innocent, la "Justice" l'a libéré.
Mais comme personne n'a voulu de lui, on l'a envoyé se refaire une santé entre ces quatre murs où le soleil ne pénètre jamais.
Les matons, enfin gardiens ou moniteurs, sont impitoyables.
Brimades, coups, isolement, privations, cachot, toutes formes de maltraitance sont au menu du jour, même hors cantine.
Les plus petits sont dominés par les plus grands qui les soumettent sexuellement sous le regard impassible des gardiens.
Quand ils ne sont pas à l'intérieur de la prison, on les envoie travailler. De lourdes tâches pour ces petits bouts de choux.
Jusqu'au jour où n'en pouvant plus de plier sous le joug, les enfants se révoltent.
Tout ça m'a rappelé beaucoup d'orphelinats, tel celui de Jersey, ainsi que d'autres, sur lesquels je me suis documentée.
Cependant, je suis mitigée sur cette lecture.
Bien sûr, les descriptions sont particulièrement horribles, mais elles ne m'ont pas émotionnellement touchée.
L'auteur n'engage pas son ressenti dans le récit. Le style est froid, désincarné.
Alors je n'ai rien ressenti non plus pendant la permière moitié du livre.
Ensuite, une touche d'émotion pendant une trentaine de pages. J'ai bien accroché, j'étais contente, et puis le soufflé est retombé.
C'est dommage, parce que tous les ingrédients étaient réunis, mais contrairement à la majorité de mes babelpotes, je n'ai pas embarqué comme je l'aurais voulu.
Je ne déconseille cependant pas ce livre que j'ai apprécié quand même.
C'est juste qu'il m'a manqué ce petit quelque chose qui en aurait fait un coup de coeur.
.
Le 11 octobre 1932, nous faisons cnonaissance avec le narrateur, surnommé La Teigne.
C'est l'heure de la cantine dans la colonie pénitentiaire pour mineurs de Belle-Ïle-en-mer.
"Tous sont tête basse, le nez dans leur écuelle à chien. Ils bouffent, ils lapent, ils saucent leur pâtée sans un bruit. Interdit à table, le bruit. Le réfectoire doit être silencieux".
Ces enfants sont emprisonnés pour menus larcins, ou pour avoir commis le crime d'être orphelins.
La Teigne par exemple, mère partie voir si l'herbe était plus verte ailleurs, père démissionnaire, grands-parents qui s'en fichent.
Le jour où il a été traîné au tribunal pour une bêtise dont il a été reconnu innocent, la "Justice" l'a libéré.
Mais comme personne n'a voulu de lui, on l'a envoyé se refaire une santé entre ces quatre murs où le soleil ne pénètre jamais.
Les matons, enfin gardiens ou moniteurs, sont impitoyables.
Brimades, coups, isolement, privations, cachot, toutes formes de maltraitance sont au menu du jour, même hors cantine.
Les plus petits sont dominés par les plus grands qui les soumettent sexuellement sous le regard impassible des gardiens.
Quand ils ne sont pas à l'intérieur de la prison, on les envoie travailler. De lourdes tâches pour ces petits bouts de choux.
Jusqu'au jour où n'en pouvant plus de plier sous le joug, les enfants se révoltent.
Tout ça m'a rappelé beaucoup d'orphelinats, tel celui de Jersey, ainsi que d'autres, sur lesquels je me suis documentée.
Cependant, je suis mitigée sur cette lecture.
Bien sûr, les descriptions sont particulièrement horribles, mais elles ne m'ont pas émotionnellement touchée.
L'auteur n'engage pas son ressenti dans le récit. Le style est froid, désincarné.
Alors je n'ai rien ressenti non plus pendant la permière moitié du livre.
Ensuite, une touche d'émotion pendant une trentaine de pages. J'ai bien accroché, j'étais contente, et puis le soufflé est retombé.
C'est dommage, parce que tous les ingrédients étaient réunis, mais contrairement à la majorité de mes babelpotes, je n'ai pas embarqué comme je l'aurais voulu.
Je ne déconseille cependant pas ce livre que j'ai apprécié quand même.
C'est juste qu'il m'a manqué ce petit quelque chose qui en aurait fait un coup de coeur.
.
1910, quai Colbert au Havre. Là où travaillent les charbonniers pour gagner misère. Ces charbonniers, « fringues en lambeaux, galoches trouées, mines d'affamés. Une bande de pouilleux, misérables de la tête aux pieds ». Des charbonniers se situant au plus bas de la hiérarchie des dockers. « Les derniers des derniers ». « Le quai Colbert n'était rien d'autre qu'un territoire de cendre, de crasse et de suie, où trimaient les damnés du port, des mercenaires dégénérés sur lesquels couraient les rumeurs les plus folles et les plus sordides. Là-dedans, dans l'espace maudit, on buvait et on se battait jusqu'à la mort. Un repaire de hors-la-loi où régnaient une terreur sanglante et une licence abjecte. Quai Colbert, tout était pire qu'ailleurs sur le port où pourtant rien n'était rose. »
« Des bêtes de somme, voilà ce qu'ils étaient, rien d'autre. Et traitées comme telles. Ou pire encore. [...] Pour quatre francs la bordée, ils suaient sang et eau, se brisaient les reins et respiraient de la merde. Cela en valait-il la peine ? Sur le quai, à quarante ans, on était foutu. Quand on n'était pas mort. »
Leurs conditions de vie sont épouvantables, à l'opposé de celles des négociants-importateurs de charbon dont les affaires prospèrent. « Le charbon ! Rien ne comptait plus pour la formidable industrie portuaire, pour ce rivage où le monde entier faisait escale, où les plus grands navires, les plus modernes, les plus rapides se donnaient rendez-vous. Il avait lu récemment dans Le Figaro que la croissance du Havre était un fait unique dans l'histoire commerciale française, qu'en quarante ans le trafic portuaire avait été multiplié par dix ! »
Voilà le contexte sur lequel repose cet ouvrage où vous devinez, rien qu'à la lecture de ces deux paragraphes, que la colère va gronder sur fond de lutte des classes. Le moindre prétexte est source de bagarres, d'énervement et voilà que se pointe à l'horizon une machine grue capable de remplacer une bonne partie de la main d'œuvre. le terreau fertile d'une révolte syndicale, qui rappelle celui des mineurs du Nord.
J'ai trouvé ce roman historique, basé sur des faits réels, absolument passionnant tant pour son écriture à la Zola que pour son histoire. Celle de Jules Durand, un chef de file syndical qui finira broyé. L'ambiance est palpable, les descriptions et le vocabulaire d'époque sont immersifs, la narration est prenante. Tellement prenante que j'ai trouvé cette lecture fatigante, moi qui lis le soir ! J'ai mis plusieurs jours avant de tourner la dernière page.
Petit bémol sur la forme, car les notes sont situées en fin d'ouvrage, ce qui oblige à s'y rendre régulièrement. Cela coupe la lecture, j'aurais préféré qu'elles soient en bas de pages.
En résumé, une très belle lecture qui me restera en mémoire, à la fois pour l'écriture et pour l'histoire.
« Des bêtes de somme, voilà ce qu'ils étaient, rien d'autre. Et traitées comme telles. Ou pire encore. [...] Pour quatre francs la bordée, ils suaient sang et eau, se brisaient les reins et respiraient de la merde. Cela en valait-il la peine ? Sur le quai, à quarante ans, on était foutu. Quand on n'était pas mort. »
Leurs conditions de vie sont épouvantables, à l'opposé de celles des négociants-importateurs de charbon dont les affaires prospèrent. « Le charbon ! Rien ne comptait plus pour la formidable industrie portuaire, pour ce rivage où le monde entier faisait escale, où les plus grands navires, les plus modernes, les plus rapides se donnaient rendez-vous. Il avait lu récemment dans Le Figaro que la croissance du Havre était un fait unique dans l'histoire commerciale française, qu'en quarante ans le trafic portuaire avait été multiplié par dix ! »
Voilà le contexte sur lequel repose cet ouvrage où vous devinez, rien qu'à la lecture de ces deux paragraphes, que la colère va gronder sur fond de lutte des classes. Le moindre prétexte est source de bagarres, d'énervement et voilà que se pointe à l'horizon une machine grue capable de remplacer une bonne partie de la main d'œuvre. le terreau fertile d'une révolte syndicale, qui rappelle celui des mineurs du Nord.
J'ai trouvé ce roman historique, basé sur des faits réels, absolument passionnant tant pour son écriture à la Zola que pour son histoire. Celle de Jules Durand, un chef de file syndical qui finira broyé. L'ambiance est palpable, les descriptions et le vocabulaire d'époque sont immersifs, la narration est prenante. Tellement prenante que j'ai trouvé cette lecture fatigante, moi qui lis le soir ! J'ai mis plusieurs jours avant de tourner la dernière page.
Petit bémol sur la forme, car les notes sont situées en fin d'ouvrage, ce qui oblige à s'y rendre régulièrement. Cela coupe la lecture, j'aurais préféré qu'elles soient en bas de pages.
En résumé, une très belle lecture qui me restera en mémoire, à la fois pour l'écriture et pour l'histoire.
Une histoire d'attachements, au pluriel, voilà à quoi pourrait se résumer ce premier roman profondément humain et sensible de Barbara Kingslover. On est dans la tête de Taylor Greer pour l'essentiel avec son langage familier, chamarré et poétique, en réalité Missy Marietta mais rebaptisée ainsi à l'occasion de son périple sans but et apparemment sans fin vers l'Ouest, si ce n'est la panne rédhibitoire de sa guimbarde dépourvue de démarreur. Du comté de Pittman dans le Kentucky à l'Ocklahoma en laissant derrière les vibrations d'un lien charnel avec sa mère, avec pour rencontres à venir des paumés dans des bars, des tenancières d'hôtel, et surtout un bébé à l'allure cherokee et l'expression catatonique. Elle deviendra Turtle et changera la vie de la jeune Taylor, prête à devenir quant à elle maman sans avoir été enceinte, prête surtout à s'ouvrir à l'altérité et l'entraide à Tucson, ville de destination. Un véritable foyer de cocon de tendresse et d'humanité y verra le jour, Mattie, Esperanza ou Estevan, plus encore avec Lou-Ann sa colocataire elle aussi avec un enfant dans les bras. Mais un foyer sensible, souvent embrasé des flammèches du monde extérieur codifié par l'absurde et la cruauté, où illégal peut devenir adjectif pour un être humain au même titre que bon ou méchant, où maltraitance peut se retrouver à côtoyer naissance.
Une histoire d'attachement qui pourrait aussi se déclarer entre lecteur et autrice. C'est mon deuxième de Barbara Kingslover, découverte avec son dernier « On m'appelle Demon Copperhead ». Du dernier qui l'a consacrée au premier qui l'a révélée, le trajet de la découverte est à rebours pour moi mais la reconnaissance des similitudes est là, dans la voix et le ton terriblement attachants de ses personnages, dans sa narration accrocheuse et simple en apparence, en réalité parsemée de trouvailles inspirées. Chouette, il m'en reste plein à lire !
Une histoire d'attachement qui pourrait aussi se déclarer entre lecteur et autrice. C'est mon deuxième de Barbara Kingslover, découverte avec son dernier « On m'appelle Demon Copperhead ». Du dernier qui l'a consacrée au premier qui l'a révélée, le trajet de la découverte est à rebours pour moi mais la reconnaissance des similitudes est là, dans la voix et le ton terriblement attachants de ses personnages, dans sa narration accrocheuse et simple en apparence, en réalité parsemée de trouvailles inspirées. Chouette, il m'en reste plein à lire !
Le musicien et son ombre
Ils sont unis par un lien indéfectible, indestructible. Ken Mizutani et son violoncelle ne forment qu'un. Mobilisé par l'armée impériale d'un pays en plein conflit mondial, le jeune virtuose doit pourtant se séparer de son Goffriller, une pièce rare du 18ème siècle qu'il confie à Hortense Schmidt, une luthière talentueuse, après une dernière interprétation pour le moins émouvante..
Bien des années plus tard, Pamina, la petite fille d'Hortense, se voit confier le précieux violoncelle afin de le réparer.
En le démontant, elle découvre une lettre d'amour qui la mènera sur les traces de destins que la guerre a fait voler en éclats..
Une partition fine et délicate dans laquelle passé et présent s'entrelacent dans l'écho de notes intemporelles.
Les émotions et les sentiments traversent le temps et résistent à l'Absence , sublimés par la musique qui unit, qui console.
La musique qui transcende , plus forte que la folie meurtrière des hommes.
Ce roman, qui flatte la sensibilité des mélomanes, souffre aussi de la présence de boucles redondantes qui peuvent parfois mettre à mal la patience de certains lecteurs.
La lecture n'en reste pas moins plaisante et chargée en émotions.
Ils sont unis par un lien indéfectible, indestructible. Ken Mizutani et son violoncelle ne forment qu'un. Mobilisé par l'armée impériale d'un pays en plein conflit mondial, le jeune virtuose doit pourtant se séparer de son Goffriller, une pièce rare du 18ème siècle qu'il confie à Hortense Schmidt, une luthière talentueuse, après une dernière interprétation pour le moins émouvante..
Bien des années plus tard, Pamina, la petite fille d'Hortense, se voit confier le précieux violoncelle afin de le réparer.
En le démontant, elle découvre une lettre d'amour qui la mènera sur les traces de destins que la guerre a fait voler en éclats..
Une partition fine et délicate dans laquelle passé et présent s'entrelacent dans l'écho de notes intemporelles.
Les émotions et les sentiments traversent le temps et résistent à l'Absence , sublimés par la musique qui unit, qui console.
La musique qui transcende , plus forte que la folie meurtrière des hommes.
Ce roman, qui flatte la sensibilité des mélomanes, souffre aussi de la présence de boucles redondantes qui peuvent parfois mettre à mal la patience de certains lecteurs.
La lecture n'en reste pas moins plaisante et chargée en émotions.
Publié en 1907, « Les garçons de la rue Pál » est un célèbre roman hongrois, qui nous conte l’affrontement entre deux bandes d’enfants à Budapest, à la fin du XIXe siècle. Une rivalité oppose les garçons de la rue Pál dirigés par János Boka et la bande des Chemises Pourpres dirigée par Feri Áts. Cette rivalité prend un tour guerrier lorsque la bande des Chemises Pourpres décide de s’emparer du terrain vague occupé par la bande rivale.
Le début du roman frappe par l’esprit de sérieux de ces enfants qui jouent à la guerre. Respect de la hiérarchie, attribution d’un grade à chacun, règlement intérieur, les garçons de la rue Pál ne font pas semblant, et prennent leur rôle avec un sérieux confondant. Leur chef János Boka, aussi charismatique que sage, mène ses troupes avec droiture et mesure. Le comportement trouble de son second Geréb le laisse songeur, et Boka se méfie.
Une mission d’espionnage menée en compagnie du minot de la bande, Nemecsek, un jeune garçon courageux et tout entier dédié à sa mission, confirme les soupçons de Boka. Geréb a changé de camp et les Chemises Pourpres ont l’intention de s’emparer du terrain vague qui constitue le quartier général des garçons de la rue Pál. Feri Áts, le chef de la bande rivale, a lui aussi le sens de l’honneur et met les formes pour déclarer la guerre de territoire qui gronde. Il indique avec une franchise désarmante le lieu et l’heure de l’attaque prévue par les Chemises Pourpres, laissant à Boka le temps de préparer un plan de défense complexe face à un ennemi supposé plus fort.
***
« Les garçons de la rue Pál » évoque de prime abord un roman enfantin, « Une guerre des boutons » à la sauce hongroise. Le roman de Ferenc Molnár comporte pourtant plusieurs niveaux de lecture. S’il nous conte une histoire d’enfants qui jouent à la guerre, avec la rigueur de leurs aînés, « Les garçons de la rue Pál » nous propose également une analyse des mécanismes des guerres de conquête.
« Et voilà, c’était précisément pour ce genre de raison que se décidait une guerre, pour des objectifs semblables que de vrais soldats se battaient. Les Russes voulaient un accès à l’océan, c’est pourquoi ils avaient attaqué les Japonais. Les Chemises Pourpres avaient besoin d’un terrain de jeu, et puisque ça ne marchait pas autrement, ils voulaient le conquérir par les armes. »
Le roman peut se lire à hauteur d’enfant, ce qui lui confère le charme de l’innocence de ces gamins qui singent la rigueur militaire de leurs aînés avec un sérieux irréprochable. On y retrouve le respect d’un code d’honneur implicite, le courage, en particulier celui du petit Nemecsek, le plus attachant de la bande, prêt à affronter les pires dangers pour servir son camp, ainsi que la magnanimité, dont fait preuve János Boka, personnage solaire, qui découvre trop tôt le tragique de l’existence.
« János Boka, plein de gravité, gardait les yeux rivés sur le banc devant lui ; et pour la première fois commençait à poindre dans son âme juvénile et candide le soupçon de la véritable nature de la vie, que nous servons tous autant que nous sommes, en combattants tantôt affligés, tantôt joyeux. »
Et pourtant. Le roman nous conte aussi la duplicité, la trahison, dont fait preuve Geréb, qui change de camp par dépit, ainsi que l’obéissance trop stricte à un règlement parfois absurde, qui confine à la lâcheté et conduit à l’injustice. Si les garçons de la rue Pál sont attachants, ils ont déjà emprunté à leurs aînés les défauts inhérents à toute organisation militaire.
À la fois roman d’apprentissage et métaphore des guerres de conquête, le livre de Ferenc Molnár, frappe le lecteur par la limpidité de son style, et par la subtilité avec laquelle il approche la guerre qui gronde au coeur d’un empire austro-hongrois au bord du gouffre. « Les garçons de la rue Pál » évoque « La ferme des animaux » de George Orwell qui dissèque les mécanismes de l’instauration d’une dictature d’inspiration marxiste-léniniste. Tandis qu’Orwell remplace les hommes par des animaux grotesques, l’auteur nous propose une guerre enfantine, qui évoque un jeu, afin de disséquer les mécanismes de déclenchement d’une guerre de conquête.
Si le récit d’Orwell est absolument transparent, la dénonciation de Ferenc Molnár est nettement plus subtile. Il ne nous propose pas un roman à thèse, mais l’aventure guerrière de bandes d’enfants de Budapest. L’absurdité et le tragique de la guerre, la vraie, affleurent à la lecture des « garçons de la rue Pál », mais ne constituent aucunement l’unique clé de lecture du roman. C’est sans doute la véritable réussite de ce livre : nous proposer un authentique jeu d’enfants, tout en dénonçant implicitement la tentation expansionniste, ce ferment maudit, qui conduira au déclenchement de la Première Guerre.
Le début du roman frappe par l’esprit de sérieux de ces enfants qui jouent à la guerre. Respect de la hiérarchie, attribution d’un grade à chacun, règlement intérieur, les garçons de la rue Pál ne font pas semblant, et prennent leur rôle avec un sérieux confondant. Leur chef János Boka, aussi charismatique que sage, mène ses troupes avec droiture et mesure. Le comportement trouble de son second Geréb le laisse songeur, et Boka se méfie.
Une mission d’espionnage menée en compagnie du minot de la bande, Nemecsek, un jeune garçon courageux et tout entier dédié à sa mission, confirme les soupçons de Boka. Geréb a changé de camp et les Chemises Pourpres ont l’intention de s’emparer du terrain vague qui constitue le quartier général des garçons de la rue Pál. Feri Áts, le chef de la bande rivale, a lui aussi le sens de l’honneur et met les formes pour déclarer la guerre de territoire qui gronde. Il indique avec une franchise désarmante le lieu et l’heure de l’attaque prévue par les Chemises Pourpres, laissant à Boka le temps de préparer un plan de défense complexe face à un ennemi supposé plus fort.
***
« Les garçons de la rue Pál » évoque de prime abord un roman enfantin, « Une guerre des boutons » à la sauce hongroise. Le roman de Ferenc Molnár comporte pourtant plusieurs niveaux de lecture. S’il nous conte une histoire d’enfants qui jouent à la guerre, avec la rigueur de leurs aînés, « Les garçons de la rue Pál » nous propose également une analyse des mécanismes des guerres de conquête.
« Et voilà, c’était précisément pour ce genre de raison que se décidait une guerre, pour des objectifs semblables que de vrais soldats se battaient. Les Russes voulaient un accès à l’océan, c’est pourquoi ils avaient attaqué les Japonais. Les Chemises Pourpres avaient besoin d’un terrain de jeu, et puisque ça ne marchait pas autrement, ils voulaient le conquérir par les armes. »
Le roman peut se lire à hauteur d’enfant, ce qui lui confère le charme de l’innocence de ces gamins qui singent la rigueur militaire de leurs aînés avec un sérieux irréprochable. On y retrouve le respect d’un code d’honneur implicite, le courage, en particulier celui du petit Nemecsek, le plus attachant de la bande, prêt à affronter les pires dangers pour servir son camp, ainsi que la magnanimité, dont fait preuve János Boka, personnage solaire, qui découvre trop tôt le tragique de l’existence.
« János Boka, plein de gravité, gardait les yeux rivés sur le banc devant lui ; et pour la première fois commençait à poindre dans son âme juvénile et candide le soupçon de la véritable nature de la vie, que nous servons tous autant que nous sommes, en combattants tantôt affligés, tantôt joyeux. »
Et pourtant. Le roman nous conte aussi la duplicité, la trahison, dont fait preuve Geréb, qui change de camp par dépit, ainsi que l’obéissance trop stricte à un règlement parfois absurde, qui confine à la lâcheté et conduit à l’injustice. Si les garçons de la rue Pál sont attachants, ils ont déjà emprunté à leurs aînés les défauts inhérents à toute organisation militaire.
À la fois roman d’apprentissage et métaphore des guerres de conquête, le livre de Ferenc Molnár, frappe le lecteur par la limpidité de son style, et par la subtilité avec laquelle il approche la guerre qui gronde au coeur d’un empire austro-hongrois au bord du gouffre. « Les garçons de la rue Pál » évoque « La ferme des animaux » de George Orwell qui dissèque les mécanismes de l’instauration d’une dictature d’inspiration marxiste-léniniste. Tandis qu’Orwell remplace les hommes par des animaux grotesques, l’auteur nous propose une guerre enfantine, qui évoque un jeu, afin de disséquer les mécanismes de déclenchement d’une guerre de conquête.
Si le récit d’Orwell est absolument transparent, la dénonciation de Ferenc Molnár est nettement plus subtile. Il ne nous propose pas un roman à thèse, mais l’aventure guerrière de bandes d’enfants de Budapest. L’absurdité et le tragique de la guerre, la vraie, affleurent à la lecture des « garçons de la rue Pál », mais ne constituent aucunement l’unique clé de lecture du roman. C’est sans doute la véritable réussite de ce livre : nous proposer un authentique jeu d’enfants, tout en dénonçant implicitement la tentation expansionniste, ce ferment maudit, qui conduira au déclenchement de la Première Guerre.
Et ils dansaient le dimanche, parce qu’il n’y avait qu’un dimanche par semaine et les autres jours s’était la graine qu’ils allaient gagner comme on peut.
Avant 1936, avant les congés payés, le fixe mensuel, et l’indemnisation des accidents de travail, comment c’était ?
Dans la période d’entre deux guerres le monde s’industrialise. On automatise, on systématise c’est le prélude du fordisme dans les usines. Elles avalent des hommes et des femmes par milliers, les lobotomisent, les réduit à un geste, les même gestes répétés à l’infini dans des conditions d’hygiène et de salubrité déplorables. On lutte contre les émanations chimiques avec un verre de lait et contre l’ennui du geste répété par l’oubli de soi. Devenir ouvrier c’est être dépossédé de son corps, réduit à un outil de travail, un rouage de la machine. L’ouvrier est étranger à lui même il ne s’appartient plus. S’ajoutent à cette déshumanisation les humiliations des chefs, la colère contenue, les amendes pour une maladresse, un mauvais geste quand l’homme renaît derrière la machine et oublie de s’oublier. Les accidents de travail n’existent pas, seuls les inattentions et les erreurs des ouvriers sont en cause. Les machines et les patrons ne commentent jamais d’erreurs. Les maladies professionnelles sont un manque de chance, on s’empresse d’enterrer les morts et d’oublier pour ne pas sombrer.
On use les ouvriers comme les pièces des machines, des corps prêts à broyés dévorés par l’usine. Ce monstre qui se nourri des vies des ouvriers, ce monstre qui est leur seul horizon. Pourvoyeur de logements, de jardins ouvriers, il imprègne tout de son odeur, pose sa marque indélébile sur les esprits et marque les corps.
L’usine c’est un abrutissement organisé. Un entre soi savamment orchestré. On casse les corps et on brise les rêves. L’être humain ramené à l’essentiel : manger, dormir, de loger.
Mais ces ouvriers venus de Hongrie, d’Italie, d’Espagne, d’Arménie et d’ailleurs ont fuit quelque chose de bien pire pour la plupart : le fascisme, la famine, la guerre… Ils ont la foi en leurs rêves chevillés au corps et petit à petit la révolte gronde. Dans ce roman historique Paola PIGANI nous parle des ouvriers immigrés et surtout des ouvrières. Ces femmes qui ont quitté leur pays qui arrivent dans un univers inconnu, se débattent avec une langue inconnue, sont payées moins bien que les hommes. Ces femmes qui n’ont pas le droit de vote, pas encore, qui tentent de se faire naturaliser, qui aiment mais qui doivent se raisonner. La raison avant le cœur.
Ces ouvriers solidaires et portés par leurs rêves et leur courage vont faire l’Histoire et changer leurs vies et les nôtres, en occupant les usines, en revendiquant en osant demander de vivre dignement et non plus de survivre.
Paola PIGANI a su insuffler de la poésie dans ce pan de l’Histoire dominé par la politique et les luttes intestines des syndicats. Elle a mis sur le devant de la scène la vie de tous les jours en utilisant sa plume douce et mélancolique, offrant ainsi des moments de grâce. Malgré un récit raconté à la troisième personne, j’ai été immergée dans cette citée ouvrière d’une époque pas si lointaine.
En racontant l’histoire de Szonja, Bianca, Elsa, Marco, Andor, Jean et les autres Paola PIGANI nous rappelle qu’au delà des syndicats, du Front populaire et de ce que les livres d’Histoire retiennent, il y avait des hommes et des femmes, souvent venus de loin, une solidarité inébranlable, des idéaux, et une soif de vivre qui longtemps n’a pu s’exprimer qu’en dansant le dimanche.
Avant 1936, avant les congés payés, le fixe mensuel, et l’indemnisation des accidents de travail, comment c’était ?
Dans la période d’entre deux guerres le monde s’industrialise. On automatise, on systématise c’est le prélude du fordisme dans les usines. Elles avalent des hommes et des femmes par milliers, les lobotomisent, les réduit à un geste, les même gestes répétés à l’infini dans des conditions d’hygiène et de salubrité déplorables. On lutte contre les émanations chimiques avec un verre de lait et contre l’ennui du geste répété par l’oubli de soi. Devenir ouvrier c’est être dépossédé de son corps, réduit à un outil de travail, un rouage de la machine. L’ouvrier est étranger à lui même il ne s’appartient plus. S’ajoutent à cette déshumanisation les humiliations des chefs, la colère contenue, les amendes pour une maladresse, un mauvais geste quand l’homme renaît derrière la machine et oublie de s’oublier. Les accidents de travail n’existent pas, seuls les inattentions et les erreurs des ouvriers sont en cause. Les machines et les patrons ne commentent jamais d’erreurs. Les maladies professionnelles sont un manque de chance, on s’empresse d’enterrer les morts et d’oublier pour ne pas sombrer.
On use les ouvriers comme les pièces des machines, des corps prêts à broyés dévorés par l’usine. Ce monstre qui se nourri des vies des ouvriers, ce monstre qui est leur seul horizon. Pourvoyeur de logements, de jardins ouvriers, il imprègne tout de son odeur, pose sa marque indélébile sur les esprits et marque les corps.
L’usine c’est un abrutissement organisé. Un entre soi savamment orchestré. On casse les corps et on brise les rêves. L’être humain ramené à l’essentiel : manger, dormir, de loger.
Mais ces ouvriers venus de Hongrie, d’Italie, d’Espagne, d’Arménie et d’ailleurs ont fuit quelque chose de bien pire pour la plupart : le fascisme, la famine, la guerre… Ils ont la foi en leurs rêves chevillés au corps et petit à petit la révolte gronde. Dans ce roman historique Paola PIGANI nous parle des ouvriers immigrés et surtout des ouvrières. Ces femmes qui ont quitté leur pays qui arrivent dans un univers inconnu, se débattent avec une langue inconnue, sont payées moins bien que les hommes. Ces femmes qui n’ont pas le droit de vote, pas encore, qui tentent de se faire naturaliser, qui aiment mais qui doivent se raisonner. La raison avant le cœur.
Ces ouvriers solidaires et portés par leurs rêves et leur courage vont faire l’Histoire et changer leurs vies et les nôtres, en occupant les usines, en revendiquant en osant demander de vivre dignement et non plus de survivre.
Paola PIGANI a su insuffler de la poésie dans ce pan de l’Histoire dominé par la politique et les luttes intestines des syndicats. Elle a mis sur le devant de la scène la vie de tous les jours en utilisant sa plume douce et mélancolique, offrant ainsi des moments de grâce. Malgré un récit raconté à la troisième personne, j’ai été immergée dans cette citée ouvrière d’une époque pas si lointaine.
En racontant l’histoire de Szonja, Bianca, Elsa, Marco, Andor, Jean et les autres Paola PIGANI nous rappelle qu’au delà des syndicats, du Front populaire et de ce que les livres d’Histoire retiennent, il y avait des hommes et des femmes, souvent venus de loin, une solidarité inébranlable, des idéaux, et une soif de vivre qui longtemps n’a pu s’exprimer qu’en dansant le dimanche.
Ce livre est certainement celui qui a le plus durablement marqué ma vie de lecteur. Je l'ai lu voici près de 20 ans. Pour la petite anecdote, avant de partir en vacances, je vais dans ma librairie pour choisir des lectures d'été. Dans un rayon, il y avait le Prince des marées avec la mention "Roman culte". En discutant avec la libraire, je la taquine sur cette mention assez marketing. Elle me répond : "cher monsieur, si vous l'achetez, je m'engage à vous le rembourser si vous n'êtes pas bouleversé". Je la prend au mot et je l'achète. Et je commence à le lire.....Je l'ai dévoré en 3 jours malgré ses plus de 1000 pages. Je suis ressorti écrasé, brisé, bouleversé par cette œuvre.
Pourquoi ? Certainement car ce qui se passe faisait échos à ma vie mais surtout par la puissance de ses personnages, la capacité à brasser les sentiments humains avec un art, une précision et une puissance inégalée. Et bien sur, sans rien dévoiler, au milieu du livre il y a une scène fameuse qui brise vos digues. J'ai pleuré à chaudes larmes. Je ne pensais pas que la littérature pouvait avoir une telle puissance, une telle force. Il a su donner, à travers ses personnages une dimension d'éternité à nos passions, à nos émotions, à notre humanité tout simplement.
Bien sur, je suis retourné voir ma libraire. Bien sur je n'ai demandé à me faire rembourser. Bien sur, j'ai acheter tout Pat Conroy pour retrouver la même émotion.
Comme quoi, oui, les libraires sont indispensables. Ils peuvent changer le cours de votre vie.
Pourquoi ? Certainement car ce qui se passe faisait échos à ma vie mais surtout par la puissance de ses personnages, la capacité à brasser les sentiments humains avec un art, une précision et une puissance inégalée. Et bien sur, sans rien dévoiler, au milieu du livre il y a une scène fameuse qui brise vos digues. J'ai pleuré à chaudes larmes. Je ne pensais pas que la littérature pouvait avoir une telle puissance, une telle force. Il a su donner, à travers ses personnages une dimension d'éternité à nos passions, à nos émotions, à notre humanité tout simplement.
Bien sur, je suis retourné voir ma libraire. Bien sur je n'ai demandé à me faire rembourser. Bien sur, j'ai acheter tout Pat Conroy pour retrouver la même émotion.
Comme quoi, oui, les libraires sont indispensables. Ils peuvent changer le cours de votre vie.
Quinze jours dans la vie d’un homme.
Vincente Minnelli a adapté ce roman d’Irvin Shaw en en 1962 avec Kirk Douglas, Edward G. Robinson et Cyd Charisse dans les rôles principaux. S’il en a respecté l’atmosphère, celle du Holywood de l’âge d’or finissant, il a fait du principal protagoniste, Jack Andrus, un homme en proie à de violentes crises d'alcoolisme.
Chez Shaw, c’est d’une crise existentielle dont il s’agit, celle vécue par un homme qui fut un acteur connu et reconnu, jusqu’à la seconde guerre mondiale. Traumatisé, blessé, Andrus a changé de carrière, travaille désormais pour l’OTAN, a épousé une Française, fondé une famille et vit à Paris.
Un ami metteur en scène qui a lui aussi connu son heure de gloire le contacte. Angus le rejoint sur un tournage à Rome pour une durée de deux semaines, espérant tourner le dos à l’ennui dont il est la proie, et renouer, qui sait, avec son ancienne carrière.
« Mourir, mourir, avaient chuchoté les voix, Mourir, avaient chanté les sirènes de Rome, il n’y a rien de meilleur que l’oubli, rien de plus délicieux que le néant. Il n’était pas ligoté à un mât, ses oreilles n’étaient pas bouchées par la cire, il avait écouté, il avait tendu la main dans la direction de la musique.
C’était incroyable que chose pareille lui fût arrivée. Mais cela lui était arrivé.
Au cours de ces deux semaines quelques chose s’était produit qui ne s’était jamais produit avant: il avait commencé d’avoir envie de mourir. »
Quinze jours ailleurs n’est pas le roman le plus connu d’Irwin Shaw, l’action y est quasiment inexistante, mais il offre le portrait saisissant d’un homme hanté par son passé, bouleversé par une femme, et par d’anciennes amitiés.
On ressent la patte d’Irwin Shaw, romancier, dramaturge, scénariste (Arc de Triomphe, Un acte d'amour , L'Enfer des tropiques…), engagé durant la seconde guerre mondiale, qui dut s’exiler en Suisse à cause de la tristement célèbre Liste Noire. Francophile, il a comme son personnage tourné le dos à une partie de son existence, et sait mieux que quiconque évoquer la vie des Américains en Europe.
Vincente Minnelli a adapté ce roman d’Irvin Shaw en en 1962 avec Kirk Douglas, Edward G. Robinson et Cyd Charisse dans les rôles principaux. S’il en a respecté l’atmosphère, celle du Holywood de l’âge d’or finissant, il a fait du principal protagoniste, Jack Andrus, un homme en proie à de violentes crises d'alcoolisme.
Chez Shaw, c’est d’une crise existentielle dont il s’agit, celle vécue par un homme qui fut un acteur connu et reconnu, jusqu’à la seconde guerre mondiale. Traumatisé, blessé, Andrus a changé de carrière, travaille désormais pour l’OTAN, a épousé une Française, fondé une famille et vit à Paris.
Un ami metteur en scène qui a lui aussi connu son heure de gloire le contacte. Angus le rejoint sur un tournage à Rome pour une durée de deux semaines, espérant tourner le dos à l’ennui dont il est la proie, et renouer, qui sait, avec son ancienne carrière.
« Mourir, mourir, avaient chuchoté les voix, Mourir, avaient chanté les sirènes de Rome, il n’y a rien de meilleur que l’oubli, rien de plus délicieux que le néant. Il n’était pas ligoté à un mât, ses oreilles n’étaient pas bouchées par la cire, il avait écouté, il avait tendu la main dans la direction de la musique.
C’était incroyable que chose pareille lui fût arrivée. Mais cela lui était arrivé.
Au cours de ces deux semaines quelques chose s’était produit qui ne s’était jamais produit avant: il avait commencé d’avoir envie de mourir. »
Quinze jours ailleurs n’est pas le roman le plus connu d’Irwin Shaw, l’action y est quasiment inexistante, mais il offre le portrait saisissant d’un homme hanté par son passé, bouleversé par une femme, et par d’anciennes amitiés.
On ressent la patte d’Irwin Shaw, romancier, dramaturge, scénariste (Arc de Triomphe, Un acte d'amour , L'Enfer des tropiques…), engagé durant la seconde guerre mondiale, qui dut s’exiler en Suisse à cause de la tristement célèbre Liste Noire. Francophile, il a comme son personnage tourné le dos à une partie de son existence, et sait mieux que quiconque évoquer la vie des Américains en Europe.
Jouer à la roulette russe à l'aube du jour et de sa vie adulte, en discerner le « bruit morne et ennuyeux » du clac après «la sensation de volupté et d'apaisement » procurée par le contact avec le métal à peine froid, voilà une entrée dans ce roman symboliquement forte même si l'on ne pourra pas prétendre que ça augure d'une indéfectible envie de vivre chez Jakob. On pourra juste évoquer sa bonne étoile depuis tant d'années, « aussi peu probable que si, lors d'un lancer de dés, on ne tombait jamais, si fort qu'on s'évertuât, sur le six, ou sur le un, jamais sur un chiffre précis, jamais sur celui qu'on attendait ». À moins que l'on pense à estimer la violence consubstantielle de Jakob, qu'il semble prêt à retourner contre lui-même,.
Et pourtant, voilà un jeune homme pas vraiment du genre à tergiverser dans l'inertie au sein de sa ferme familiale qui tremble du fracas incessant de l'autoroute, il ne rechigne pas à la besogne, fourmille même d'idées et de projets, tente les bassins de truites avant de s'en remettre à leur location au vu des aléas piscivores, s'éreinte dans l'élevage de poulets et dans la poursuite de sa chienne. Sa réputation n'est plus à faire dans cette région de Haute-Autriche en pénurie de main-d'oeuvre, qui lui permet même d'arrondir ses fins de mois. C'est dans ce contexte qu'il croisera Katja, jeune femme qu'il aurait pu connaître sur Tinder avant de l'ignorer comme à son habitude, mais qui « lui était apparue devant la bicoque du concierge, attablée devant un bloc de papier à dessin et une poignée de crayons de tailles inégales, l'ongle du pouce entre les dents, le nez pointant en l'air...»
La tension est aux aguets dans ce roman, à petites touches subtiles de mal-être et d'infirmité chez Jakob à ne pas savoir aimer, de silences, de secret ou de liens avariés au sein de sa famille avec « un père à demi-dément et une mère pendue à son portable », mais aussi (et surtout ?) d'une lignée agricole et d'un héritage aux relents historiques de malaise. Après les somptueux « Lilas noir » et « Lilas rouge », Reinhard Kaiser-Mühlecker écrit de nouveau un roman rural, fluide et passionnant, à la dramaturgie sous-jacente prête à jaillir d'un geyser de violence, qui questionne de nouveau l'héritage du nazisme, sans doute de manière plus suggestive cette fois. Un roman puissant et souvent beau, aux allures de grand et à la saveur d'une littérature classique, de celle qui laisse des traces à la fois sûres pour ce qui est de sa puissance évocatrice ou sa valeur, et incertaines quant aux questions qui peuvent continuer de vriller dans la tête du lecteur.
"Lorsque leurs yeux s'étaient rencontrés, il avait senti, face à ce regard habité d'une cruauté dont il ne l'aurait pas crue capable, un frisson glacé lui courir le long du dos, et dans le même temps c'était comme s'il s'était soudain affranchi de la force qui le terrassait, et qu'elle se fût transmise à Katja; qu'elle l'eût délesté de son fardeau. Jamais auparavant il n'avait partagé avec quelqu'un un moment tel que celui-là, et il lui sembla qu'il venait de lire au fond de son âme"
Et pourtant, voilà un jeune homme pas vraiment du genre à tergiverser dans l'inertie au sein de sa ferme familiale qui tremble du fracas incessant de l'autoroute, il ne rechigne pas à la besogne, fourmille même d'idées et de projets, tente les bassins de truites avant de s'en remettre à leur location au vu des aléas piscivores, s'éreinte dans l'élevage de poulets et dans la poursuite de sa chienne. Sa réputation n'est plus à faire dans cette région de Haute-Autriche en pénurie de main-d'oeuvre, qui lui permet même d'arrondir ses fins de mois. C'est dans ce contexte qu'il croisera Katja, jeune femme qu'il aurait pu connaître sur Tinder avant de l'ignorer comme à son habitude, mais qui « lui était apparue devant la bicoque du concierge, attablée devant un bloc de papier à dessin et une poignée de crayons de tailles inégales, l'ongle du pouce entre les dents, le nez pointant en l'air...»
La tension est aux aguets dans ce roman, à petites touches subtiles de mal-être et d'infirmité chez Jakob à ne pas savoir aimer, de silences, de secret ou de liens avariés au sein de sa famille avec « un père à demi-dément et une mère pendue à son portable », mais aussi (et surtout ?) d'une lignée agricole et d'un héritage aux relents historiques de malaise. Après les somptueux « Lilas noir » et « Lilas rouge », Reinhard Kaiser-Mühlecker écrit de nouveau un roman rural, fluide et passionnant, à la dramaturgie sous-jacente prête à jaillir d'un geyser de violence, qui questionne de nouveau l'héritage du nazisme, sans doute de manière plus suggestive cette fois. Un roman puissant et souvent beau, aux allures de grand et à la saveur d'une littérature classique, de celle qui laisse des traces à la fois sûres pour ce qui est de sa puissance évocatrice ou sa valeur, et incertaines quant aux questions qui peuvent continuer de vriller dans la tête du lecteur.
"Lorsque leurs yeux s'étaient rencontrés, il avait senti, face à ce regard habité d'une cruauté dont il ne l'aurait pas crue capable, un frisson glacé lui courir le long du dos, et dans le même temps c'était comme s'il s'était soudain affranchi de la force qui le terrassait, et qu'elle se fût transmise à Katja; qu'elle l'eût délesté de son fardeau. Jamais auparavant il n'avait partagé avec quelqu'un un moment tel que celui-là, et il lui sembla qu'il venait de lire au fond de son âme"
Je suis décidément verni dans le genre BD en ce moment, je cumule, d'une part de bonnes suggestions sur Babélio, et d'autre part leurs disponibilité à ma médiathèque. Depuis quelques mois, c'est plus d'une vingtaine de lectures, et vu mon retard accumulé dans ce domaine, c'est loin d'être fini :)
Pour parler de cette BD, je vais commencer par les graphismes, ils sont extra, jetez un œil sur la couverture et vous comprendrez, mais il y a aussi un scénario intéressant, le thème et l'intrigue sont assez originaux, et le traitement, du début jusqu'à l'épilogue est simplement inattendu.
Ce western crépusculaire nous raconte la fin d'un monde, celui des cowboys convoyeurs de bétail, l'arrivée du train et de la modernité sonne le glas de leur mode de vie. Pour beaucoup, le désarroi est total, car la reconversion est pour ainsi dire impossible, fermier ou outlaw ? Pour Russell, ce sera la vie de fermier avec Benett, un simplet qui est aussi son fils adoptif, il a fait des économies et compte se rendre propriétaire d'une ferme...
Ce qui est amusant, c'est la façon dont on peut se faire influencer et abuser par un titre, je n'en dirais pas plus, si ce n'est que j'ai beaucoup aimé cette lecture.
Pour parler de cette BD, je vais commencer par les graphismes, ils sont extra, jetez un œil sur la couverture et vous comprendrez, mais il y a aussi un scénario intéressant, le thème et l'intrigue sont assez originaux, et le traitement, du début jusqu'à l'épilogue est simplement inattendu.
Ce western crépusculaire nous raconte la fin d'un monde, celui des cowboys convoyeurs de bétail, l'arrivée du train et de la modernité sonne le glas de leur mode de vie. Pour beaucoup, le désarroi est total, car la reconversion est pour ainsi dire impossible, fermier ou outlaw ? Pour Russell, ce sera la vie de fermier avec Benett, un simplet qui est aussi son fils adoptif, il a fait des économies et compte se rendre propriétaire d'une ferme...
Ce qui est amusant, c'est la façon dont on peut se faire influencer et abuser par un titre, je n'en dirais pas plus, si ce n'est que j'ai beaucoup aimé cette lecture.
J'ai découvert John Boyne très récemment avec la vie en fuite que j'avais beaucoup appréciée.
J'y reviens aujourd'hui avec : Les fureurs invisibles du cœur et ce livre m'a énormément plu et touchée.
John Boyne se livre à une véritable radioscopie de l'Irlande des années 45 à aujourd'hui.
Le puritanisme et le rôle de l'église prépondérante a de quoi nous réjouir de n'être pas né en Irlande dans les années 50.
Je dois dire qu'avant d'évoquer le roman, il est évidemment indissociable d'évoquer le film: Magdalena sisters paru dans les années 2000 évoquant ces couvents" laveries" où on enfermait des jeunes filles innocentes bannies par leurs familles, exploitées et maltraitées par les soeurs.L'une des héroïnes du film y est enfermé car elle a dénoncé son cousin qui l'a violée.
John Boyne, dans son roman lui se penche sur un " autre travers" pour la société irlandaise de l'époque : l'homosexualité jugée comme une déviance, un état anormal pouvant qualifier un homme de malade mental.
Les fureurs invisibles du cœur nous conte l'histoire de deux enfants, puis adolescents et adultes : Cyril adopté par une famille bourgeoise, l'autre Julian.
Cyril n'aime que les hommes et découvre son homosexualité étant adolescent alors que Julian lui a une passion pour toutes les femmes.
Ces deux hommes que tout oppose seront amis pour la vie, leurs vies seront étroitement liées . Cyril aime Julian pendant des années sans jamais lui avouer.
Chacun mènera sa vie à leur manière.
Pour Cyril, l'amour est une tragédie, et son parcours d'homosexuels dans l'Irlande de sa jeunesse est un véritable enfer.
Alors qu'il découvre enfin l'amour harmonieux avec un homme, il retrouve Julian à New York qui meurt du sida
Des pages splendides sont consacrées avec beaucoup de justesse à cette pandémie qui jugera le monde des homosexuels de façon impitoyable.
Mais les fureurs invisibles du cœur sont aussi l'histoire d'une fille -mère, elle aussi bien malmenée au début de son existence.
Des tas de personnages émergent de cette saga réellement addictive et attachante.
Les huit cent pages passent à toute allure et l'on est bien un peu orphelin au sortir de ce magnifique roman.
J'y reviens aujourd'hui avec : Les fureurs invisibles du cœur et ce livre m'a énormément plu et touchée.
John Boyne se livre à une véritable radioscopie de l'Irlande des années 45 à aujourd'hui.
Le puritanisme et le rôle de l'église prépondérante a de quoi nous réjouir de n'être pas né en Irlande dans les années 50.
Je dois dire qu'avant d'évoquer le roman, il est évidemment indissociable d'évoquer le film: Magdalena sisters paru dans les années 2000 évoquant ces couvents" laveries" où on enfermait des jeunes filles innocentes bannies par leurs familles, exploitées et maltraitées par les soeurs.L'une des héroïnes du film y est enfermé car elle a dénoncé son cousin qui l'a violée.
John Boyne, dans son roman lui se penche sur un " autre travers" pour la société irlandaise de l'époque : l'homosexualité jugée comme une déviance, un état anormal pouvant qualifier un homme de malade mental.
Les fureurs invisibles du cœur nous conte l'histoire de deux enfants, puis adolescents et adultes : Cyril adopté par une famille bourgeoise, l'autre Julian.
Cyril n'aime que les hommes et découvre son homosexualité étant adolescent alors que Julian lui a une passion pour toutes les femmes.
Ces deux hommes que tout oppose seront amis pour la vie, leurs vies seront étroitement liées . Cyril aime Julian pendant des années sans jamais lui avouer.
Chacun mènera sa vie à leur manière.
Pour Cyril, l'amour est une tragédie, et son parcours d'homosexuels dans l'Irlande de sa jeunesse est un véritable enfer.
Alors qu'il découvre enfin l'amour harmonieux avec un homme, il retrouve Julian à New York qui meurt du sida
Des pages splendides sont consacrées avec beaucoup de justesse à cette pandémie qui jugera le monde des homosexuels de façon impitoyable.
Mais les fureurs invisibles du cœur sont aussi l'histoire d'une fille -mère, elle aussi bien malmenée au début de son existence.
Des tas de personnages émergent de cette saga réellement addictive et attachante.
Les huit cent pages passent à toute allure et l'on est bien un peu orphelin au sortir de ce magnifique roman.
Nous avons tous nos petites marottes quand nous choisissons nos lectures. Des petites choses auxquelles nous avons du mal à résister. Comme vous, j'en ai plusieurs et l'une dans elle est le mot « Vagabond ». Donc quand j'ai croisé ce titre j'ai sauté sur le livre avant de me raviser. La quatrième de couverture me faisait hésiter : encore une énième histoire de vampires diluée dans une amourette d'ado ou rendue fade par un besoin incompréhensible, pour moi, d'en faire de pâles copies d'êtres humains. Et là mes yeux se sont posés sur … une recommandation du King qui disait que c'était une des meilleures histoires de vampires qu'il ait lu. Mouais, j'adore le King mais il est aussi fan de Faulkner alors on n'est pas toujours d'accord. Et juste en dessous Michel Farris Smith en rajoute une couche et parle de gothique au far West. Bon ok je m'avoue vaincue, bien que j'ouvre ce livre sur la réserve et avec quelques a priori (oui je sais c'est moche !)
Bien m'en a pris ! Une fois le livre ouvert il a été pour moi impossible de le lâcher. Richard LANGE nous embarque dans un road movie nocturne. D'un côté Jesse et son frère, simple d'esprit, et non moins vampire, et de l'autre côté un groupe de motards diaboliques qui semblent sortis tout droit de l'enfer. Et en plein milieu du jeu de quilles un pauvre gars désespérément humain qui va se retrouver plongé en plein cauchemar.
Dans cette histoire racontée à plusieurs voix, le lecteur est transporté dans le temps, parfois des centaines d'années en arrière. Les vampires aussi ont été humains et ils trainent avec eux les souvenirs de leur vie passée. Il est aussi secoué par les rebondissements et aux prises avec une intrigue très bien ficelée.
Je l'ai adoré, mais visiblement pas du tout pour les mêmes raisons que certains babeliotes. En allant regarder les billets des copains je me suis aperçue que la plupart y ont vu une ode aux marginaux, à ceux qui vivent en marge de la société. S'il est vrai que l'auteur en profite pour parler du racisme, de l'homophobie, de la différence, ce n'est pas l'impression que ce livre m'a laissé. Pour moi tout l'intérêt de l'histoire est dans le fait que l'on revient aux sources. Même si l'auteur a aménagé quelques détails et que passer un vampire à la guillotine ou utiliser une bonne vieille hache semble être un moyen radicale pour le réduire en poussière. C'est toujours bon à savoir. L'important c'est que l'auteur ait gardé le coeur de ce qui constitue mythe: Les vampires sont des êtres qui ont basculés dans les ténèbres, y compris leurs âmes. Ils vivent la nuit car le soleil les brûle et si les gousses d'ail les font rire il n'en demeure pas moins qu'ils vident de leur sang les pauvres gars qui croisent leur chemin. Certes c'est pour leur survie mais aussi sympathiques soient ces vampires, la survie ne légitime pas tout. Faut-ils que certains meurent prématurément pour permettre à d'autres de vivre éternellement ? Les victimes sont toujours des pauvres âmes esseulées la plupart du temps complètement saoules. le vampire choisi les proies qui lui attireront le moins d'ennuis, ceux que personne ne cherchera, des marginaux eux aussi. le vampire ne choisit pas en fonction d'une morale quelle qu'elle soit puisqu'il n'en a pas. Il croquerait bien quelques bébés sans aucun état d'âme si ce n'était pas aussi risqué.
Là où c'est intéressant, c'est que les vampires ne sont pas incapables d'aimer pour autant. Et comme l'amour fait tourner le monde il paraît, c'est justement là que les ennuis commencent. Car à bien y regarder, un vampire c'est une allégorie de l'égoïsme : rien ne compte à part le vampire, la satisfaction de ses besoins et la préservation de ceux vers qui va son affection quel qu'en soit le prix. Dénué d'empathie, de morale et d'idéaux il ne peut se comporter comme ce qu'il n'est plus et ne peut plus. Malgré cela l'auteur arrive facilement à nous les rendre attachants. Ni meilleurs ni pires que les êtres humains. Un juste dosage qui permettra à de nombreux lecteurs, amateurs de vampires ou non, de s'y retrouver.
L'auteur évite de sombrer dans la guimauve et certains personnages en feront les frais, mais l'histoire n'en sera que plus crédible et addictive.
En refermant ce livre, je me suis dit que la morale de l'histoire était double : il ne suffit pas d'être humain pour ne pas être un monstre et ce n'est pas parce que la vie vous a forcé à agir de manière monstrueuse que toute humanité vous a quitté.
Bien m'en a pris ! Une fois le livre ouvert il a été pour moi impossible de le lâcher. Richard LANGE nous embarque dans un road movie nocturne. D'un côté Jesse et son frère, simple d'esprit, et non moins vampire, et de l'autre côté un groupe de motards diaboliques qui semblent sortis tout droit de l'enfer. Et en plein milieu du jeu de quilles un pauvre gars désespérément humain qui va se retrouver plongé en plein cauchemar.
Dans cette histoire racontée à plusieurs voix, le lecteur est transporté dans le temps, parfois des centaines d'années en arrière. Les vampires aussi ont été humains et ils trainent avec eux les souvenirs de leur vie passée. Il est aussi secoué par les rebondissements et aux prises avec une intrigue très bien ficelée.
Je l'ai adoré, mais visiblement pas du tout pour les mêmes raisons que certains babeliotes. En allant regarder les billets des copains je me suis aperçue que la plupart y ont vu une ode aux marginaux, à ceux qui vivent en marge de la société. S'il est vrai que l'auteur en profite pour parler du racisme, de l'homophobie, de la différence, ce n'est pas l'impression que ce livre m'a laissé. Pour moi tout l'intérêt de l'histoire est dans le fait que l'on revient aux sources. Même si l'auteur a aménagé quelques détails et que passer un vampire à la guillotine ou utiliser une bonne vieille hache semble être un moyen radicale pour le réduire en poussière. C'est toujours bon à savoir. L'important c'est que l'auteur ait gardé le coeur de ce qui constitue mythe: Les vampires sont des êtres qui ont basculés dans les ténèbres, y compris leurs âmes. Ils vivent la nuit car le soleil les brûle et si les gousses d'ail les font rire il n'en demeure pas moins qu'ils vident de leur sang les pauvres gars qui croisent leur chemin. Certes c'est pour leur survie mais aussi sympathiques soient ces vampires, la survie ne légitime pas tout. Faut-ils que certains meurent prématurément pour permettre à d'autres de vivre éternellement ? Les victimes sont toujours des pauvres âmes esseulées la plupart du temps complètement saoules. le vampire choisi les proies qui lui attireront le moins d'ennuis, ceux que personne ne cherchera, des marginaux eux aussi. le vampire ne choisit pas en fonction d'une morale quelle qu'elle soit puisqu'il n'en a pas. Il croquerait bien quelques bébés sans aucun état d'âme si ce n'était pas aussi risqué.
Là où c'est intéressant, c'est que les vampires ne sont pas incapables d'aimer pour autant. Et comme l'amour fait tourner le monde il paraît, c'est justement là que les ennuis commencent. Car à bien y regarder, un vampire c'est une allégorie de l'égoïsme : rien ne compte à part le vampire, la satisfaction de ses besoins et la préservation de ceux vers qui va son affection quel qu'en soit le prix. Dénué d'empathie, de morale et d'idéaux il ne peut se comporter comme ce qu'il n'est plus et ne peut plus. Malgré cela l'auteur arrive facilement à nous les rendre attachants. Ni meilleurs ni pires que les êtres humains. Un juste dosage qui permettra à de nombreux lecteurs, amateurs de vampires ou non, de s'y retrouver.
L'auteur évite de sombrer dans la guimauve et certains personnages en feront les frais, mais l'histoire n'en sera que plus crédible et addictive.
En refermant ce livre, je me suis dit que la morale de l'histoire était double : il ne suffit pas d'être humain pour ne pas être un monstre et ce n'est pas parce que la vie vous a forcé à agir de manière monstrueuse que toute humanité vous a quitté.
Au bonheur des ogres, c’est une sacrée recette.
Il y a le côté caramélisé des personnages, ce zeste de folie qui les accompagne au quotidien. Ajoutez une pincée d'astrologie, de photos compromettantes, de dialogues riches en féculents. Pour que la recette soit parfaite, il faut qu'elle dégage l'odeur fétide d'un chien épileptique, sinon cela ne fonctionnera pas.
Versez 3L de café brasileiro pour donner un côté électrique aux ingrédients. Saupoudrez le tout par beaucoup de péripéties et d'humour.
Et enfin, n'oubliez pas de rajouter un soupçon d'enquête policière.
Enfournez le tout à 220 degrés et vous obtenez un plat qui fera peut-être revenir votre mère de chez son nouvel amant.
Bon appétit.
Il y a le côté caramélisé des personnages, ce zeste de folie qui les accompagne au quotidien. Ajoutez une pincée d'astrologie, de photos compromettantes, de dialogues riches en féculents. Pour que la recette soit parfaite, il faut qu'elle dégage l'odeur fétide d'un chien épileptique, sinon cela ne fonctionnera pas.
Versez 3L de café brasileiro pour donner un côté électrique aux ingrédients. Saupoudrez le tout par beaucoup de péripéties et d'humour.
Et enfin, n'oubliez pas de rajouter un soupçon d'enquête policière.
Enfournez le tout à 220 degrés et vous obtenez un plat qui fera peut-être revenir votre mère de chez son nouvel amant.
Bon appétit.
Ce roman tchèque inachevé (1921-23) est extraordinaire et diabolique ! Une allure de bon vieux feuilleton populaire avec une suite rocambolesque de (més)aventures invraisemblables et puis en même temps un roman d'une subversion féroce. J'ai ri tout du long, que dis-je, je me suis gondolée comme jamais en lisant pourtant, un livre terrible sur la Grande Guerre, cette vaste boucherie. Et je n'ai lu que le premier tome qui se déroule à Prague en 1914. La Tchéquie est alors sous la botte de l'Empire austro-hongrois. Chvéïk a été déclaré « complètement idiot » par la commission médicale, il a renoncé au service militaire et vit tranquillement en vendant d'horribles chiens bâtards pour lesquels il fabrique des pédigrées et puis il fréquente assidûment la taverne « le Calice ». Il souffre de rhumatismes et il est justement en train de frictionner ses genoux au baume d'opodeldoch quand sa logeuse , l'interpelle :
"— Quoi donc ? fit-il.
— Eh ! bien, notre Ferdinand… il n'y en a plus !
— De quel Ferdinand parlez-vous, M'ame Muller ? questionna Chvéïk tout en continuant sa friction. J'en connais deux, moi. Il y a d'abord Ferdinand qui est garçon chez le droguiste Proucha et qui lui a bu une fois, par erreur, une bouteille de lotion pour les cheveux. Après, il y a Ferdinand Kokochka, celui qui ramasse les crottes de chiens. Si c'est l'un de ces deux-là, ce n'est pas grand dommage ni pour l'un, ni pour l'autre.
— Mais, M'sieur le patron, c'est l'archiduc Ferdinand, celui de Konopiste, le gros calotin, vous savez bien ? ".
La guerre est déclarée et Joseph Chveik va au Calice, picoler. le cruel et zélé agent de police Bretschneider l'entraîne à dire, sous l'effet de l'alcool, ce qu'il pense de L'Empereur. Il n'en dit que du bien. Ce qui pourrait passer pour une insolence. Chveik est arrêté de même que le cabaretier qui avait ôté le portrait de l'Empereur parce que les mouches chiaient dessus. Chveik est emprisonné mais passe de commissions en commissions toutes chargées de statuer sur son état mental.
En effet Joseph Chvéïk est unique en son genre, tantôt idiot, tantôt plein de bon sens. Il désarçonne les représentants de l'autorité les plus terribles par sa candeur et son optimisme à toute épreuve. Et le grand tour de force de Jaroslav Hasek, c'est qu'on ne saura jamais s'il est un imbécile heureux ou un grand simulateur, un fou ou un sage. le lecteur n'est d'ailleurs pas plus fortiche que ses sombres inquisiteurs. C'est que le brave Chveik surjoue l'obéissance moutonnière en toutes circonstances avec un grand sourire béat. Il se conforme à ce qu'on attend de lui, avoue ce qu'on lui demande d'avouer sans protester, pleure quand on veut qu'il pleure, prie quand on veut qu'il prie. Mais hop aussitôt que l'autorité a le dos tourné, il transgresse et il mord. Autre caractéristique hilarante, Chveik est doté d' une gouaille phénoménale. Il palabre, déboise, digresse, dérive dans des récits complètement à côté de la plaque de manière tellement grandiose que ses interlocuteurs sont déstabilisés, paralysés, désarmés. Et vous vous vous tordez de rire. Son comportement grotesque et décalé, sa tchatche infatigable et son optimisme candide révèlent en miroir la stupidité, l'incompétence, l'hypocrisie et la cruauté de ceux qui composent la machine à broyer austro-hongroise : les policiers , les juges, les gardiens de prison, les médecins légistes, les aumôniers, les bonnes dames charitables et j'en passe.
Vivement le deuxième livre !
"— Quoi donc ? fit-il.
— Eh ! bien, notre Ferdinand… il n'y en a plus !
— De quel Ferdinand parlez-vous, M'ame Muller ? questionna Chvéïk tout en continuant sa friction. J'en connais deux, moi. Il y a d'abord Ferdinand qui est garçon chez le droguiste Proucha et qui lui a bu une fois, par erreur, une bouteille de lotion pour les cheveux. Après, il y a Ferdinand Kokochka, celui qui ramasse les crottes de chiens. Si c'est l'un de ces deux-là, ce n'est pas grand dommage ni pour l'un, ni pour l'autre.
— Mais, M'sieur le patron, c'est l'archiduc Ferdinand, celui de Konopiste, le gros calotin, vous savez bien ? ".
La guerre est déclarée et Joseph Chveik va au Calice, picoler. le cruel et zélé agent de police Bretschneider l'entraîne à dire, sous l'effet de l'alcool, ce qu'il pense de L'Empereur. Il n'en dit que du bien. Ce qui pourrait passer pour une insolence. Chveik est arrêté de même que le cabaretier qui avait ôté le portrait de l'Empereur parce que les mouches chiaient dessus. Chveik est emprisonné mais passe de commissions en commissions toutes chargées de statuer sur son état mental.
En effet Joseph Chvéïk est unique en son genre, tantôt idiot, tantôt plein de bon sens. Il désarçonne les représentants de l'autorité les plus terribles par sa candeur et son optimisme à toute épreuve. Et le grand tour de force de Jaroslav Hasek, c'est qu'on ne saura jamais s'il est un imbécile heureux ou un grand simulateur, un fou ou un sage. le lecteur n'est d'ailleurs pas plus fortiche que ses sombres inquisiteurs. C'est que le brave Chveik surjoue l'obéissance moutonnière en toutes circonstances avec un grand sourire béat. Il se conforme à ce qu'on attend de lui, avoue ce qu'on lui demande d'avouer sans protester, pleure quand on veut qu'il pleure, prie quand on veut qu'il prie. Mais hop aussitôt que l'autorité a le dos tourné, il transgresse et il mord. Autre caractéristique hilarante, Chveik est doté d' une gouaille phénoménale. Il palabre, déboise, digresse, dérive dans des récits complètement à côté de la plaque de manière tellement grandiose que ses interlocuteurs sont déstabilisés, paralysés, désarmés. Et vous vous vous tordez de rire. Son comportement grotesque et décalé, sa tchatche infatigable et son optimisme candide révèlent en miroir la stupidité, l'incompétence, l'hypocrisie et la cruauté de ceux qui composent la machine à broyer austro-hongroise : les policiers , les juges, les gardiens de prison, les médecins légistes, les aumôniers, les bonnes dames charitables et j'en passe.
Vivement le deuxième livre !
Suivez toutes les critiques de la presse
Voir plus

Actualitte
3299 critiques
LeFigaro
4048 critiques
LeMonde
5763 critiques
Lhumanite
509 critiques
Liberation
2716 critiques
Bibliobs
2492 critiques
LePoint
1265 critiques
LesEchos
1329 critiques
Lexpress
4147 critiques
Telerama
3479 critiques
LaPresse
2664 critiques