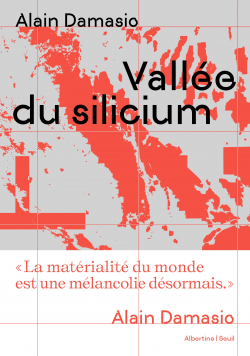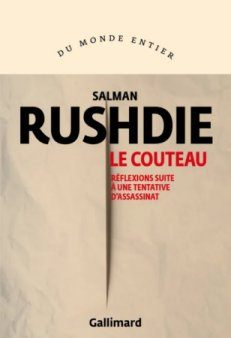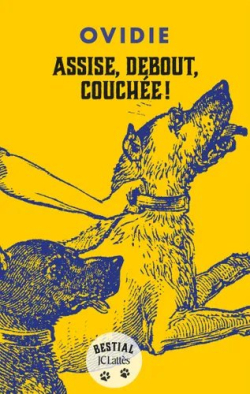Gilles DeleuzeFélix GuattariCapitalisme et schizophrénie tome 2 sur 2
/5 63 notes
/5 63 notes
Résumé :
L'espace lisse, ou Nomos : sa différence avec l'espace strié.
- Ce qui remplit l'espace lisse : le corps, sa différence avec l'organisme. - Ce qui se distribue dans cet espace : rhizome, meutes et multiplicités. - Ce qui se passe : les devenirs et les intensités. - Les coordonnées tracées : territoires, terre et déterritorialisations, Cosmos. - Les signes correspondants, le langage et la musique (Les ritournelles). - Agencement des espaces-temps : machine de ... >Voir plus
- Ce qui remplit l'espace lisse : le corps, sa différence avec l'organisme. - Ce qui se distribue dans cet espace : rhizome, meutes et multiplicités. - Ce qui se passe : les devenirs et les intensités. - Les coordonnées tracées : territoires, terre et déterritorialisations, Cosmos. - Les signes correspondants, le langage et la musique (Les ritournelles). - Agencement des espaces-temps : machine de ... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Capitalisme et Schizophrénie, tome 2 : Mille PlateauxVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (4)
Ajouter une critique
Quel est le rapport entre la parole d'un fou, le chant d'un oiseau et un discours politique ?
C'est peut-être chez la personne dite « schizophrène » qu'on peut l'entendre mieux qu'ailleurs :
« il y a toutes sortes de voix dans une voix »…
Gilles Deleuze et Felix Guattari ont conçu une expérience analogue de la multiplicité, pour le lecteur comme pour eux-mêmes, en écrivant ce livre. À deux, ils ont déclaré que le « je » n'avait pas grande importance. Ils ont détaché les chapitres comme autant de voix, et ils ont laissé advenir un agencement singulier de concepts…
Au lecteur de jouer. Je ne sais pas dire si cet agencement est concret ; j'emploierais plutôt le mot pâteux. Pour se rendre compte du processus, suivons le bouillonnant professeur Challenger tout droit sorti de la nouvelle de Arthur Conan Doyle, « Quand la terre hurla » ; ça se passe lors d'une conférence de presse imaginée par Deleuze et Guattari, où le professeur part en vrille devant un auditoire qui déserte en dénonçant le côté fumeux de l'affaire...
Si on devient fou en lisant ce livre, on peut dire que l'objectif est atteint. On aura compris que « le devenir et la multiplicité sont une seule et même chose » ;
Devenir-sorcier.e peut-être, ou devenir-femme, ou devenir-animal pour l'homme aux loups ;
On devient ce qu'on n'est pas, or je ne suis pas ce que je suis. On devient, c'est tout, par un concours de circonstances…
Ce qui est amusant quand on s'intéresse à l'éthologie, c'est de se dire que les animaux, comme tous les êtres vivants, multiplient par avance les solutions aux problèmes qui pourraient se poser ;
Naturellement, on est donc en train de résoudre des problèmes sans savoir lesquels...
Comment ? par une prolifération d'expérimentations baroques, « des noces contre nature » comme la symbiose de la guêpe et de l'orchidée, des aventures « cosmiques » comme la prodigieuse remontée des saumons à leur source…
Si on veut, on peut trouver un fondement à cette prolifération ou aux agencements concrets, en le nommant « inconscient libidinal, machinique, moléculaire » ;
Mais ce qui est manifeste dans ce livre, c'est que tout devenir n'est qu'un rapport à autrui : les animaux, les fous (même si ce livre ne s'intéresse pas directement à leur souffrance), les personnages de romans, les femmes...
Partout, la fascination est manifeste. « C'est curieux comme une femme peut être secrète en ne cachant rien »…
C'est un régal d'en apprendre plus sur les pinsons d'Australie, sur leur chant et leur comportement ;
agencement collectif d'énonciation et agencement de corps ;
C'est l'histoire d'un pinson qui tenait en son bec un concept...
un simple brin d'herbe en l'espèce,
« un vecteur de deterritorialisation » qui agit comme « une composante de passage entre l'agencement territorial et l'agencement de cour » ;
Les vecteurs se conjuguant, le pinson devenait une autre créature…
C'est encore un régal de lire Henry James et de rencontrer les personnages de ses romans, à l'invitation de notre duo de choc Deleuze et Guattari ;
Leur pragmatique à ces trois là n'est pas exactement le pragmatisme de William James, le frère. On a dit que Henry est un romancier de l'indirect...
Voici un autre visage du concept : « Le concept par certains aspects, est un personnage, et le personnage, par certains aspects, est un concept »...
On aimerait poursuivre sur cette tonalité joyeuse, mais on sait qu'on peut devenir réellement fou, par une déterritorialisation brutale : on voit une meute de loups, un essaim d'abeille puis un champs d'anus...Il peut aussi survenir une reterritorialisation destructrice ;
La psychiatrie nous révèle notre propre image : « tantôt avoir l'air fou sans l'être, tantôt l'être sans en avoir l'air » ;
C'est la figure de la face blanche et des trous noirs qui vient hanter ce livre ; nous sommes pris dans le mix « d'un régime de signes despotique, signifiant et paranoïaque, et d'un régime autoritaire, post signifiant, subjectif ou passionnel »...
Notre duo de choc y voit le visage humain : « La tête humaine implique une déterritorialisation par rapport à l'animal » ;
Or, le côté obsessionnel de cette face blanche avec ses trous noirs me fait plutôt penser à un cul ; à chacun son délire...
Pourquoi s'efforcer de fonder une exceptionnalité humaine, si c'est pour se dire à la fin du livre qu'« il n'est pas sûr qu'on puisse faire passer une frontière entre l'animal et l'homme » ?…
Et pourquoi cette question : « Faut-il garder un minimum de sujet ? »
Pourquoi cette tentation de conserver un moi minimal, un fondement, un plein, qu'aucun affect ne peut faire vaciller, pour faire face à la réalité dominante…
…alors que la question suggère déjà que le Moi y est toujours englué…
Nous sommes sur le plan politique depuis le début de ce livre ;
pris dans des alliances infernales entre, d'une part, un régime totalitaire qui ne réclame que l'obéissance et qui obture les lignes de fuites, et d'autre part, un régime suicidaire dans lequel les lignes de fuites sont devenues destructrices ;
Or, l'appareil d'état et la machine de guerre n'ont pas la même origine…
Encore ce besoin de fonder : trouver une origine puis construire un appareil conceptuel ;
C'est curieux comme ça suppose aussi le pouvoir de déformer, destratifier ;
John Dewey, un autre philosophe du pragmatisme, avait noté ce paradoxe observable chez tous les animaux : « l'augmentation du pouvoir de former des habitudes signifie qu'augmentent aussi l'émotivité, la sensibilité, la réceptivité »…
Refaire l'histoire est décidément trop tentant ; en quelques pages on trouve l'origine nomade de la machine de guerre ;
celle-ci est dirigée contre l'état avant que celui-ci s'en empare et fasse de la guerre son objet ;
Mais cette machine de guerre renvoie d'abord aux mutations, à « l'émission de quanta de déterritorialisation » ; elle renvoie à une sémiotique contre-signifiante, distincte des deux précédentes, signifiante et post-signifiante (voir au-dessus)…
On n'a encore rien dit sur le capitalisme. Or, si l'embarras est évident, il me semble qu'il vient d'abord de la tentative douteuse de traiter la question comme une pathologie sur le même plan que la schizophrénie ;
Pourquoi devrais-je m'accommoder à une société comme à une réalité qui est en même temps un bien ? (question du médecin-philosophe Canguilhem) ;
Et réciproquement, on ne sait rien non plus des résultats de la « schizo-analyse », car il n'a jamais été question dans ce livre de personnes en souffrance…
La machine de guerre monde, avec le capital en input, semble fonder la société entière sur une axiomatique pas plus large qu'une tête d'épingle ;
Et comme réponse type à cette situation, la « pragmatique » est aussi indirecte que possible ; c'est « un voyage sur place »...
« Les conditions mêmes de la machine de guerre d'Etat ou de Monde…ne cessent de recréer des possibilités de ripostes inattendues, d'initiatives imprévues qui déterminent des machines mutantes, minoritaires, populaires, révolutionnaires. »...
On nous croit stratifiés sur le fond d'une axiomatique ou d'une morale,
à la fois sédimentés et plissés, codés et surcodés ;
Voyez les deux articulations, le contenu et l'expression : chacune met en jeu des formes et des substances, des codes et des territorialités…
C'est « la géologie de la morale », géologie et non généalogie…
Mais la stratification n'est pas tout ; Il faudrait revenir à la conférence du professeur Challenger…
Comme la terre sous sa croûte,
les terriens n'ont pas dit leur dernier mot ;
Et de son côté, la machine Deleuze-Guattari expérimente un « Corps sans Organes »…
C'est peut-être chez la personne dite « schizophrène » qu'on peut l'entendre mieux qu'ailleurs :
« il y a toutes sortes de voix dans une voix »…
Gilles Deleuze et Felix Guattari ont conçu une expérience analogue de la multiplicité, pour le lecteur comme pour eux-mêmes, en écrivant ce livre. À deux, ils ont déclaré que le « je » n'avait pas grande importance. Ils ont détaché les chapitres comme autant de voix, et ils ont laissé advenir un agencement singulier de concepts…
Au lecteur de jouer. Je ne sais pas dire si cet agencement est concret ; j'emploierais plutôt le mot pâteux. Pour se rendre compte du processus, suivons le bouillonnant professeur Challenger tout droit sorti de la nouvelle de Arthur Conan Doyle, « Quand la terre hurla » ; ça se passe lors d'une conférence de presse imaginée par Deleuze et Guattari, où le professeur part en vrille devant un auditoire qui déserte en dénonçant le côté fumeux de l'affaire...
Si on devient fou en lisant ce livre, on peut dire que l'objectif est atteint. On aura compris que « le devenir et la multiplicité sont une seule et même chose » ;
Devenir-sorcier.e peut-être, ou devenir-femme, ou devenir-animal pour l'homme aux loups ;
On devient ce qu'on n'est pas, or je ne suis pas ce que je suis. On devient, c'est tout, par un concours de circonstances…
Ce qui est amusant quand on s'intéresse à l'éthologie, c'est de se dire que les animaux, comme tous les êtres vivants, multiplient par avance les solutions aux problèmes qui pourraient se poser ;
Naturellement, on est donc en train de résoudre des problèmes sans savoir lesquels...
Comment ? par une prolifération d'expérimentations baroques, « des noces contre nature » comme la symbiose de la guêpe et de l'orchidée, des aventures « cosmiques » comme la prodigieuse remontée des saumons à leur source…
Si on veut, on peut trouver un fondement à cette prolifération ou aux agencements concrets, en le nommant « inconscient libidinal, machinique, moléculaire » ;
Mais ce qui est manifeste dans ce livre, c'est que tout devenir n'est qu'un rapport à autrui : les animaux, les fous (même si ce livre ne s'intéresse pas directement à leur souffrance), les personnages de romans, les femmes...
Partout, la fascination est manifeste. « C'est curieux comme une femme peut être secrète en ne cachant rien »…
C'est un régal d'en apprendre plus sur les pinsons d'Australie, sur leur chant et leur comportement ;
agencement collectif d'énonciation et agencement de corps ;
C'est l'histoire d'un pinson qui tenait en son bec un concept...
un simple brin d'herbe en l'espèce,
« un vecteur de deterritorialisation » qui agit comme « une composante de passage entre l'agencement territorial et l'agencement de cour » ;
Les vecteurs se conjuguant, le pinson devenait une autre créature…
C'est encore un régal de lire Henry James et de rencontrer les personnages de ses romans, à l'invitation de notre duo de choc Deleuze et Guattari ;
Leur pragmatique à ces trois là n'est pas exactement le pragmatisme de William James, le frère. On a dit que Henry est un romancier de l'indirect...
Voici un autre visage du concept : « Le concept par certains aspects, est un personnage, et le personnage, par certains aspects, est un concept »...
On aimerait poursuivre sur cette tonalité joyeuse, mais on sait qu'on peut devenir réellement fou, par une déterritorialisation brutale : on voit une meute de loups, un essaim d'abeille puis un champs d'anus...Il peut aussi survenir une reterritorialisation destructrice ;
La psychiatrie nous révèle notre propre image : « tantôt avoir l'air fou sans l'être, tantôt l'être sans en avoir l'air » ;
C'est la figure de la face blanche et des trous noirs qui vient hanter ce livre ; nous sommes pris dans le mix « d'un régime de signes despotique, signifiant et paranoïaque, et d'un régime autoritaire, post signifiant, subjectif ou passionnel »...
Notre duo de choc y voit le visage humain : « La tête humaine implique une déterritorialisation par rapport à l'animal » ;
Or, le côté obsessionnel de cette face blanche avec ses trous noirs me fait plutôt penser à un cul ; à chacun son délire...
Pourquoi s'efforcer de fonder une exceptionnalité humaine, si c'est pour se dire à la fin du livre qu'« il n'est pas sûr qu'on puisse faire passer une frontière entre l'animal et l'homme » ?…
Et pourquoi cette question : « Faut-il garder un minimum de sujet ? »
Pourquoi cette tentation de conserver un moi minimal, un fondement, un plein, qu'aucun affect ne peut faire vaciller, pour faire face à la réalité dominante…
…alors que la question suggère déjà que le Moi y est toujours englué…
Nous sommes sur le plan politique depuis le début de ce livre ;
pris dans des alliances infernales entre, d'une part, un régime totalitaire qui ne réclame que l'obéissance et qui obture les lignes de fuites, et d'autre part, un régime suicidaire dans lequel les lignes de fuites sont devenues destructrices ;
Or, l'appareil d'état et la machine de guerre n'ont pas la même origine…
Encore ce besoin de fonder : trouver une origine puis construire un appareil conceptuel ;
C'est curieux comme ça suppose aussi le pouvoir de déformer, destratifier ;
John Dewey, un autre philosophe du pragmatisme, avait noté ce paradoxe observable chez tous les animaux : « l'augmentation du pouvoir de former des habitudes signifie qu'augmentent aussi l'émotivité, la sensibilité, la réceptivité »…
Refaire l'histoire est décidément trop tentant ; en quelques pages on trouve l'origine nomade de la machine de guerre ;
celle-ci est dirigée contre l'état avant que celui-ci s'en empare et fasse de la guerre son objet ;
Mais cette machine de guerre renvoie d'abord aux mutations, à « l'émission de quanta de déterritorialisation » ; elle renvoie à une sémiotique contre-signifiante, distincte des deux précédentes, signifiante et post-signifiante (voir au-dessus)…
On n'a encore rien dit sur le capitalisme. Or, si l'embarras est évident, il me semble qu'il vient d'abord de la tentative douteuse de traiter la question comme une pathologie sur le même plan que la schizophrénie ;
Pourquoi devrais-je m'accommoder à une société comme à une réalité qui est en même temps un bien ? (question du médecin-philosophe Canguilhem) ;
Et réciproquement, on ne sait rien non plus des résultats de la « schizo-analyse », car il n'a jamais été question dans ce livre de personnes en souffrance…
La machine de guerre monde, avec le capital en input, semble fonder la société entière sur une axiomatique pas plus large qu'une tête d'épingle ;
Et comme réponse type à cette situation, la « pragmatique » est aussi indirecte que possible ; c'est « un voyage sur place »...
« Les conditions mêmes de la machine de guerre d'Etat ou de Monde…ne cessent de recréer des possibilités de ripostes inattendues, d'initiatives imprévues qui déterminent des machines mutantes, minoritaires, populaires, révolutionnaires. »...
On nous croit stratifiés sur le fond d'une axiomatique ou d'une morale,
à la fois sédimentés et plissés, codés et surcodés ;
Voyez les deux articulations, le contenu et l'expression : chacune met en jeu des formes et des substances, des codes et des territorialités…
C'est « la géologie de la morale », géologie et non généalogie…
Mais la stratification n'est pas tout ; Il faudrait revenir à la conférence du professeur Challenger…
Comme la terre sous sa croûte,
les terriens n'ont pas dit leur dernier mot ;
Et de son côté, la machine Deleuze-Guattari expérimente un « Corps sans Organes »…
- Tu vois 1000 Plateaux c'est comme un super vélo à 1000 vitesses. Tu pédales pas mal pour comprendre, parfois tu moulines, mais des fois tu gravis des sommets que tu n'aurais jamais pensé franchir, à toute allure.
- J'ai toujours pas pigé ce que c'est qu'un « plateau ».
- C'est comme… C'est un plan d'immanence, composé d'agencements de concepts, de dates, de figures qui permettent, si tu veux, de penser l'organisation de la réalité à nouveaux frais.
- C'est ton cerveau qu'est pas frais.
- Tu rigoles ? 1000 Plateaux c'est le pédalier du Disque-Monde !
Ainsi peut-on (doit-on ?) aborder cette oeuvre de Guattari&Deleuze : avec humour et enthousiasme. J'avoue, la métaphore du vélo ne va pas chercher loin. Mais on ne peut pas introduire réellement à la facture de l'ouvrage que par ce genre de tournure décalée. Et c'est sûrement une des qualités de l'écriture du livre qui l'a rendu si sympathique à autant de lecteurs différents : « livre pour tous et pour personne » comme disait Nietzsche (c'est un bel hommage que de faire parler le Grand Moustachu). Car il faut suivre, et il est facile de se perdre dans ces plateaux, ces strates géologiques de concepts forts mais parfois bruts, non-raffinés : au lecteur d'opérer la transformation des injonctions, de traduire en sa langue mentale toutes les pistes esquissées par le double-philosophe Deleuze&Guattari. C'est là le risque et la réussite de l'ouvrage. DIY : dé-fais toi toi-même scande le livre.
Livre de philosophie c'est-à-dire livre-concept, légèrement imagé, à la prose tantôt magmatique, digressive, scientifique, linguiste, tantôt fulgurante, poétique, 1000 Plateaux est fécond en concept décisifs et fascinants : déterritorialisation, corps-sans-organes, lignes molaires - lignes moléculaires - lignes de fuite, devenir-animal – devenir-intense – devenir-imperceptible, ritournelle, agencements, plan d'immanence, nomadologie, etc. Tout ce lexique qui fait que « le siècle sera deleuzien » pour reprendre la formule de Foucault. Vraiment, un cortège de concepts vitaux qui se veulent opératoires. Et qui peuvent l'être si l'on prend le temps d'approfondir la lecture (ce qui n'est tout de même pas évident).
Il faudrait 1000 textes et 1000 lectures pour bien traiter l'ouvrage. le commentateur moutonne.
Qu'à cela ne tienne. On y revient, toujours avec plaisir, avec perplexité, et parfois l'on fait des découvertes étonnantes. A vous de dire.
- J'ai toujours pas pigé ce que c'est qu'un « plateau ».
- C'est comme… C'est un plan d'immanence, composé d'agencements de concepts, de dates, de figures qui permettent, si tu veux, de penser l'organisation de la réalité à nouveaux frais.
- C'est ton cerveau qu'est pas frais.
- Tu rigoles ? 1000 Plateaux c'est le pédalier du Disque-Monde !
Ainsi peut-on (doit-on ?) aborder cette oeuvre de Guattari&Deleuze : avec humour et enthousiasme. J'avoue, la métaphore du vélo ne va pas chercher loin. Mais on ne peut pas introduire réellement à la facture de l'ouvrage que par ce genre de tournure décalée. Et c'est sûrement une des qualités de l'écriture du livre qui l'a rendu si sympathique à autant de lecteurs différents : « livre pour tous et pour personne » comme disait Nietzsche (c'est un bel hommage que de faire parler le Grand Moustachu). Car il faut suivre, et il est facile de se perdre dans ces plateaux, ces strates géologiques de concepts forts mais parfois bruts, non-raffinés : au lecteur d'opérer la transformation des injonctions, de traduire en sa langue mentale toutes les pistes esquissées par le double-philosophe Deleuze&Guattari. C'est là le risque et la réussite de l'ouvrage. DIY : dé-fais toi toi-même scande le livre.
Livre de philosophie c'est-à-dire livre-concept, légèrement imagé, à la prose tantôt magmatique, digressive, scientifique, linguiste, tantôt fulgurante, poétique, 1000 Plateaux est fécond en concept décisifs et fascinants : déterritorialisation, corps-sans-organes, lignes molaires - lignes moléculaires - lignes de fuite, devenir-animal – devenir-intense – devenir-imperceptible, ritournelle, agencements, plan d'immanence, nomadologie, etc. Tout ce lexique qui fait que « le siècle sera deleuzien » pour reprendre la formule de Foucault. Vraiment, un cortège de concepts vitaux qui se veulent opératoires. Et qui peuvent l'être si l'on prend le temps d'approfondir la lecture (ce qui n'est tout de même pas évident).
Il faudrait 1000 textes et 1000 lectures pour bien traiter l'ouvrage. le commentateur moutonne.
Qu'à cela ne tienne. On y revient, toujours avec plaisir, avec perplexité, et parfois l'on fait des découvertes étonnantes. A vous de dire.
Proposition alternative
Il s'agit d'un texte rédigé dans un moment d'enragement alors que j'assistais à un cours de psychopathologie.. (ce qui remonte à quelques années..)
Je crois n'avoir rien corrigé ou presque
Quel rapport ?..
C'est un moment de rupture ; un manifeste, si l'on veut
En partie motivé par la découverte de Deleuze et Guattari, les cours de Deleuze surtout..
"Qu'est-ce que ça veut dire ?..."
Veuillez m'excuser d'avance pour le texte en question (sans doute un peu, voire très jargonneux, selon le point de vue..)
Les émargés ne sont pas dénués de volonté (au sens passivité/activité). Ils sont au contraire producteurs, inventeurs dans le champ social, sans médiation, ni médiateur.
Situer la limite dépassée, un peu plus près, un peu plus loin, ne permet en aucun cas une restructuration d'un désir réel.
C'est-à-dire, de son aspect révolutionnaire.
À quoi sert de saisir des libertés, dans leur plus stricte expression, à partir de structures d'enlisement social ou politique ?
le désir n'est pas nécessairement désir d'interdit. Il est a-légal.
Il affleure quand l'homme social devient mouvant (vivant), générant de nouveaux discours.
L'enlisement social témoigne de la légitimation du mythe au niveau symbolique (dans le langage, les interactions sociales et la vie quotidienne). La répression (théologique ou psychanalytique) cherche la mort au coeur du vivant.
Et nécessairement la trouve, figeant un peu plus le mouvement et illusionnant le "sujet" sur ses possibilités d'invention.
*émargés : mis dans la marge
La production/invention, c'est la manifestation de vie.
(monde)
La construction sociale de la réalité, dans l'activité humaine limitée et limitative du monde, doit stigmatiser la pensée échappant à un cadre conceptuel donné pour encore reconnaître la validité d'une "mondanité" (appartenance au monde) illusoire.
Pourquoi l'obéissance serait-elle normative ? Il faut regarder de côté pour voir ou "réaliser" l'artificialité de l'édifice, au lieu de lever les yeux au ciel.
Il s'agit d'un texte rédigé dans un moment d'enragement alors que j'assistais à un cours de psychopathologie.. (ce qui remonte à quelques années..)
Je crois n'avoir rien corrigé ou presque
Quel rapport ?..
C'est un moment de rupture ; un manifeste, si l'on veut
En partie motivé par la découverte de Deleuze et Guattari, les cours de Deleuze surtout..
"Qu'est-ce que ça veut dire ?..."
Veuillez m'excuser d'avance pour le texte en question (sans doute un peu, voire très jargonneux, selon le point de vue..)
Les émargés ne sont pas dénués de volonté (au sens passivité/activité). Ils sont au contraire producteurs, inventeurs dans le champ social, sans médiation, ni médiateur.
Situer la limite dépassée, un peu plus près, un peu plus loin, ne permet en aucun cas une restructuration d'un désir réel.
C'est-à-dire, de son aspect révolutionnaire.
À quoi sert de saisir des libertés, dans leur plus stricte expression, à partir de structures d'enlisement social ou politique ?
le désir n'est pas nécessairement désir d'interdit. Il est a-légal.
Il affleure quand l'homme social devient mouvant (vivant), générant de nouveaux discours.
L'enlisement social témoigne de la légitimation du mythe au niveau symbolique (dans le langage, les interactions sociales et la vie quotidienne). La répression (théologique ou psychanalytique) cherche la mort au coeur du vivant.
Et nécessairement la trouve, figeant un peu plus le mouvement et illusionnant le "sujet" sur ses possibilités d'invention.
*émargés : mis dans la marge
La production/invention, c'est la manifestation de vie.
(monde)
La construction sociale de la réalité, dans l'activité humaine limitée et limitative du monde, doit stigmatiser la pensée échappant à un cadre conceptuel donné pour encore reconnaître la validité d'une "mondanité" (appartenance au monde) illusoire.
Pourquoi l'obéissance serait-elle normative ? Il faut regarder de côté pour voir ou "réaliser" l'artificialité de l'édifice, au lieu de lever les yeux au ciel.
Un monument heureux de la philosophie contemporaine de combat, qui n'a rien perdu de sa puissance et de sa pertinence 40 ans après sa publication, malgré les efforts réguliers menés à son encontre.
Sur le blog Charybde 27 : https://charybde2.wordpress.com/2019/06/18/note-de-lecture-mille-plateaux-gilles-deleuze-felix-guattari/
Lien : https://charybde2.wordpress...
Sur le blog Charybde 27 : https://charybde2.wordpress.com/2019/06/18/note-de-lecture-mille-plateaux-gilles-deleuze-felix-guattari/
Lien : https://charybde2.wordpress...
Citations et extraits (170)
Voir plus
Ajouter une citation
C'est une notion très complexe, celle de minorité, avec ses renvois musicaux, littéraires, linguistiques, mais aussi juridiques, politiques. Minorité et majorité ne s'opposent pas d'une manière seulement quantitative. Majorité implique une constante, d'expression ou de contenu, comme un mètre-étalon par rapport auquel elle s'évalue. Supposons que la constante ou l'étalon soit Homme-blanc-mâle-adulte-habitant des villes-parlant une langue standard-européen-hétérosexuel quelconque (l'Ulysse de Joyce ou d'Ezra Pound). Il est évident que « l'homme » a la majorité, même s'il est moins nombreux que les moustiques, les enfants, les femmes, les Noirs, les paysans, les homosexuels, etc. C'est qu'il apparaît deux fois, une fois dans la constante, une fois dans la variable d'où l'on extrait la constante. La majorité suppose un état de pouvoir et de domination, et non l'inverse. Elle suppose le mètre-étalon et non l'inverse. Même le marxisme «a traduit presque toujours l'hégémonie du point de vue de l'ouvrier national, qualifié, mâle et de plus de trente-cinq ans» (Yann Moulier, préface à "Ouvriers et Capital" de Mario Tronti, Bourgois). Une autre détermination que la constante sera donc considérée comme minoritaire, par nature et quel que soit son nombre, c'est-à-dire comme un sous-système ou comme hors-système. On le voit bien dans toutes les opérations, électorales ou autres, où l'on vous donne à choisir, à condition que votre choix reste conforme aux limites de la constante («vous n'avez pas à choisir un changement de société…»). Mais, à ce point, tout se renverse. Car la majorité, dans la mesure où elle est analytiquement comprise dans l'étalon abstrait, ce n'est jamais personne, c'est toujours Personne — Ulysse —, tandis que la minorité, c'est le devenir de tout le monde, son devenir potentiel pour autant qu'il dévie du modèle. Il y a un « fait » majoritaire, mais c'est le fait analytique de Personne, qui s'oppose au devenir-minoritaire de tout le monde. C'est pourquoi nous devons distinguer: le majoritaire comme système homogène et constant, les minorités comme sous-systèmes, et le minoritaire comme devenir potentiel et créé, créatif. Le problème n'est jamais d'acquérir la majorité, même en instaurant une nouvelle constante. Il n'y a pas de devenir majoritaire, majorité n'est jamais un devenir. I] n'y a de devenir que minoritaire. Les femmes, quel que soit leur nombre, sont une minorité, définissable comme état ou sous-ensemble ; mais elles ne créent qu'en rendant possible un devenir, dont elles n'ont pas la propriété, dans lequel elles ont elles-mêmes à entrer, un devenir-femme qui concerne l'homme tout entier, hommes et femmes y compris.
[…]
Oui, tous les devenirs sont moléculaires; l'animal, la fleur ou la pierre qu'on devient sont des collectivités moléculaires, des heccéités, non pas des formes, des objets ou sujets molaires qu'on connaît hors de nous, et qu'on reconnaît à force d'expérience ou de science, ou d'habitude. Or, si c'est vrai, il faut le dire des choses humaines aussi: il y a un devenir-femme, un devenir-enfant, qui ne ressemblent pas à la femme ou à l'enfant comme entités molaires bien distinctes (quoique la femme ou l'enfant puissent avoir des positions privilégiées possibles, mais seulement possibles, en fonction de tels devenirs). Ce que nous appelons entité molaire ici, par exemple, c'est la femme en tant qu'elle est prise dans une machine duelle qui l'oppose à l'homme, en tant qu'elle est déterminée par sa forme, et pourvue d'organes et de fonctions, et assignée comme sujet. Or devenir-femme n'est pas imiter cette entité, ni même se transformer en elle. On ne négligera pourtant pas l'importance de l'imitation, ou de moments d'imitation, chez certains homosexuels mâles; encore moins, la prodigieuse tentative de transformation réelle chez certains travestis. Nous voulons seulement dire que ces aspects inséparables du devenir-femme doivent d'abord se comprendre en fonction d'autre chose : ni imiter ni prendre la forme féminine, mais émettre des particules qui entrent dans le rapport de mouvement et de repos, ou dans la zone de voisinage d'une micro-féminité, c'est-à-dire produire en nous-mêmes une femme moléculaire, créer la femme moléculaire. Nous ne voulons pas dire qu'une telle création soit l'apanage de l'homme, mais, au contraire, que la femme comme entité molaire a à devenir-femme, pour que l'homme aussi le devienne ou puisse le devenir. Certainement il est indispensable que les femmes mènent une politique molaire, en fonction d'une conquête qu'elles opèrent de leur propre organisme, de leur propre histoire, de leur propre subjectivité : «nous en tant que femmes...» apparaît alors comme sujet d’énonciation. Mais il est dangereux de se rabattre sur un tel sujet, qui ne fonctionne pas sans tarir une source ou arrêter un flux. Le chant de la vie est souvent entonné par les femmes les plus sèches, animées de ressentiment, de volonté de puissance et de froid maternage. Comme un enfant tari fait d'autant mieux l'enfant qu'aucun flux d'enfance n'émane plus de lui. Il ne suffit pas davantage de dire que chaque sexe contient l'autre, et doit développer en lui-même le pôle opposé. Bisexualité n'est pas un meilleur concept que celui de la séparation des sexes. Miniaturiser, intérioriser la machine binaire, est aussi fâcheux que l'exaspérer, on n'en sort pas ainsi. Il faut donc concevoir une politique féminine moléculaire, qui se glisse dans les affrontements molaires et passe en dessous, ou à travers.
Quand on interroge Virginia Woolf sur une écriture proprement féminine, elle s'effare à l'idée d'écrire «en tant que femme». Il faut plutôt que l'écriture produise un devenir-femme, comme des atomes de féminité capables de parcourir et d'imprégner tout un champ social, et de contaminer les hommes, de les prendre dans ce devenir. Particules très douces, mais aussi dures et obstinées, irréductibles, indomptables. La montée des femmes dans l'écriture romanesque anglaise n'épargnera aucun homme: ceux qui passent pour les plus virils, les plus phallocrates, Lawrence, Miller, ne cesseront de capter et d'émettre à leur tour ces particules qui entrent dans le voisinage ou dans la zone d'indiscernabilité des femmes. Ils deviennent-femme en écrivant. C'est que la question n'est pas, ou n'est pas seulement celle de l'organisme, de l'histoire et du sujet d'énonciation qui opposent le masculin et le féminin dans les grandes machines duelles. La question est d'abord celle du corps -le corps qu'on nous vole pour fabriquer des organismes opposables. Or, c'est à la fille qu'on vole d'abord ce corps : cesse de te tenir comme ça, tu n'es plus une petite fille, tu n'es pas un garçon manqué, etc. C'est à la fille qu'on vole d'abord son devenir pour lui imposer une histoire, ou une pré-histoire. Le tour du garçon vient ensuite, mais c'est en lui montrant l'exemple de la fille, en lui indiquant la fille comme objet de son désir, qu'on lui fabrique à son tour un organisme opposé, une histoire dominante. La fille est la première victime, mais elle doit aussi servir d'exemple et de piège.
C'est pourquoi, inversement, la reconstruction du corps comme Corps sans organes, l'anorganisme du corps, est inséparable d'un devenir-femme ou de la production d'une femme moléculaire. Sans doute la jeune fille devient-elle femme, au sens organique ou molaire. Mais inversement le devenir-femme ou la femme moléculaire sont la jeune fille elle-même. La jeune fille ne se définit certes pas par la virginité, mais par un rapport de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur, par une combinaison d'atomes, une émission de particules: heccéité. Elle ne cesse de courir sur un corps sans organes. Elle est ligne abstraite, ou ligne de fuite. Aussi les jeunes filles n'appartiennent pas à un âge, à un sexe, à un ordre ou à un règne : elles se glissent plutôt, entre les ordres, les actes, les ages, les sexes ; elles produisent n sexes moléculaires sur la ligne de fuite, par rapport aux machines duelles qu'elles traversent de part en part. La seule manière de sortir des dualismes, être-entre, passer entre, intermezzo, c'est ce que Virginia Woolf a vécu de toutes ses forces, dans toute son œuvre, ne cessant pas de devenir. La jeune fille est comme le bloc de devenir qui reste contemporain de chaque terme opposable, homme, femme, enfant, adulte. Ce n'est pas la jeune fille qui devient femme, c'est le devenir-femme qui fait la jeune fille universelle ; ce n'est pas l'enfant qui devient adulte, c'est le devenir-enfant qui fait une jeunesse universelle. […] Il est sûr que la politique moléculaire passe par la jeune fille et l’enfant. Mais il est sûr aussi que les jeunes filles et les enfants ne tirent pas leurs forces du statut molaire qui les dompte, ni de l'organisme et de la subjectivité qu'ils reçoivent; ils tirent toutes leurs forces du devenir moléculaire qu'ils font passer entre les sexes et les âges, devenir-enfant de l'adulte comme de l'enfant, devenir-femme de l'homme comme de la femme. La jeune fille et l'enfant ne deviennent pas, c'est le devenir lui-même qui est enfant ou jeune fille. L'enfant ne devient pas adulte, pas plus que la jeune fille ne devient femme; mais la jeune fille est le devenir-femme de chaque sexe, comme l'enfant le devenir-jeune de chaque âge. Savoir vieillir n'est pas rester jeune, c'est extraire de son âge les particules, les vitesses et lenteurs, les flux qui constituent la jeunesse de cet âge. Savoir aimer n'est pas rester homme ou femme, c'est extraire de son sexe les particules, les vitesses et lenteurs, les flux, les n sexes qui constituent la jeune fille de cette sexualité. C'est l’Âge même qui est un devenir-enfant, comme la Sexualité, n'importe quelle sexualité, un devenir-femme, c'est-à-dire une jeune fille. — Afin de répondre à la question stupide : pourquoi Proust a-t-il fait d'Albert Albertine?
[…]
Oui, tous les devenirs sont moléculaires; l'animal, la fleur ou la pierre qu'on devient sont des collectivités moléculaires, des heccéités, non pas des formes, des objets ou sujets molaires qu'on connaît hors de nous, et qu'on reconnaît à force d'expérience ou de science, ou d'habitude. Or, si c'est vrai, il faut le dire des choses humaines aussi: il y a un devenir-femme, un devenir-enfant, qui ne ressemblent pas à la femme ou à l'enfant comme entités molaires bien distinctes (quoique la femme ou l'enfant puissent avoir des positions privilégiées possibles, mais seulement possibles, en fonction de tels devenirs). Ce que nous appelons entité molaire ici, par exemple, c'est la femme en tant qu'elle est prise dans une machine duelle qui l'oppose à l'homme, en tant qu'elle est déterminée par sa forme, et pourvue d'organes et de fonctions, et assignée comme sujet. Or devenir-femme n'est pas imiter cette entité, ni même se transformer en elle. On ne négligera pourtant pas l'importance de l'imitation, ou de moments d'imitation, chez certains homosexuels mâles; encore moins, la prodigieuse tentative de transformation réelle chez certains travestis. Nous voulons seulement dire que ces aspects inséparables du devenir-femme doivent d'abord se comprendre en fonction d'autre chose : ni imiter ni prendre la forme féminine, mais émettre des particules qui entrent dans le rapport de mouvement et de repos, ou dans la zone de voisinage d'une micro-féminité, c'est-à-dire produire en nous-mêmes une femme moléculaire, créer la femme moléculaire. Nous ne voulons pas dire qu'une telle création soit l'apanage de l'homme, mais, au contraire, que la femme comme entité molaire a à devenir-femme, pour que l'homme aussi le devienne ou puisse le devenir. Certainement il est indispensable que les femmes mènent une politique molaire, en fonction d'une conquête qu'elles opèrent de leur propre organisme, de leur propre histoire, de leur propre subjectivité : «nous en tant que femmes...» apparaît alors comme sujet d’énonciation. Mais il est dangereux de se rabattre sur un tel sujet, qui ne fonctionne pas sans tarir une source ou arrêter un flux. Le chant de la vie est souvent entonné par les femmes les plus sèches, animées de ressentiment, de volonté de puissance et de froid maternage. Comme un enfant tari fait d'autant mieux l'enfant qu'aucun flux d'enfance n'émane plus de lui. Il ne suffit pas davantage de dire que chaque sexe contient l'autre, et doit développer en lui-même le pôle opposé. Bisexualité n'est pas un meilleur concept que celui de la séparation des sexes. Miniaturiser, intérioriser la machine binaire, est aussi fâcheux que l'exaspérer, on n'en sort pas ainsi. Il faut donc concevoir une politique féminine moléculaire, qui se glisse dans les affrontements molaires et passe en dessous, ou à travers.
Quand on interroge Virginia Woolf sur une écriture proprement féminine, elle s'effare à l'idée d'écrire «en tant que femme». Il faut plutôt que l'écriture produise un devenir-femme, comme des atomes de féminité capables de parcourir et d'imprégner tout un champ social, et de contaminer les hommes, de les prendre dans ce devenir. Particules très douces, mais aussi dures et obstinées, irréductibles, indomptables. La montée des femmes dans l'écriture romanesque anglaise n'épargnera aucun homme: ceux qui passent pour les plus virils, les plus phallocrates, Lawrence, Miller, ne cesseront de capter et d'émettre à leur tour ces particules qui entrent dans le voisinage ou dans la zone d'indiscernabilité des femmes. Ils deviennent-femme en écrivant. C'est que la question n'est pas, ou n'est pas seulement celle de l'organisme, de l'histoire et du sujet d'énonciation qui opposent le masculin et le féminin dans les grandes machines duelles. La question est d'abord celle du corps -le corps qu'on nous vole pour fabriquer des organismes opposables. Or, c'est à la fille qu'on vole d'abord ce corps : cesse de te tenir comme ça, tu n'es plus une petite fille, tu n'es pas un garçon manqué, etc. C'est à la fille qu'on vole d'abord son devenir pour lui imposer une histoire, ou une pré-histoire. Le tour du garçon vient ensuite, mais c'est en lui montrant l'exemple de la fille, en lui indiquant la fille comme objet de son désir, qu'on lui fabrique à son tour un organisme opposé, une histoire dominante. La fille est la première victime, mais elle doit aussi servir d'exemple et de piège.
C'est pourquoi, inversement, la reconstruction du corps comme Corps sans organes, l'anorganisme du corps, est inséparable d'un devenir-femme ou de la production d'une femme moléculaire. Sans doute la jeune fille devient-elle femme, au sens organique ou molaire. Mais inversement le devenir-femme ou la femme moléculaire sont la jeune fille elle-même. La jeune fille ne se définit certes pas par la virginité, mais par un rapport de mouvement et de repos, de vitesse et de lenteur, par une combinaison d'atomes, une émission de particules: heccéité. Elle ne cesse de courir sur un corps sans organes. Elle est ligne abstraite, ou ligne de fuite. Aussi les jeunes filles n'appartiennent pas à un âge, à un sexe, à un ordre ou à un règne : elles se glissent plutôt, entre les ordres, les actes, les ages, les sexes ; elles produisent n sexes moléculaires sur la ligne de fuite, par rapport aux machines duelles qu'elles traversent de part en part. La seule manière de sortir des dualismes, être-entre, passer entre, intermezzo, c'est ce que Virginia Woolf a vécu de toutes ses forces, dans toute son œuvre, ne cessant pas de devenir. La jeune fille est comme le bloc de devenir qui reste contemporain de chaque terme opposable, homme, femme, enfant, adulte. Ce n'est pas la jeune fille qui devient femme, c'est le devenir-femme qui fait la jeune fille universelle ; ce n'est pas l'enfant qui devient adulte, c'est le devenir-enfant qui fait une jeunesse universelle. […] Il est sûr que la politique moléculaire passe par la jeune fille et l’enfant. Mais il est sûr aussi que les jeunes filles et les enfants ne tirent pas leurs forces du statut molaire qui les dompte, ni de l'organisme et de la subjectivité qu'ils reçoivent; ils tirent toutes leurs forces du devenir moléculaire qu'ils font passer entre les sexes et les âges, devenir-enfant de l'adulte comme de l'enfant, devenir-femme de l'homme comme de la femme. La jeune fille et l'enfant ne deviennent pas, c'est le devenir lui-même qui est enfant ou jeune fille. L'enfant ne devient pas adulte, pas plus que la jeune fille ne devient femme; mais la jeune fille est le devenir-femme de chaque sexe, comme l'enfant le devenir-jeune de chaque âge. Savoir vieillir n'est pas rester jeune, c'est extraire de son âge les particules, les vitesses et lenteurs, les flux qui constituent la jeunesse de cet âge. Savoir aimer n'est pas rester homme ou femme, c'est extraire de son sexe les particules, les vitesses et lenteurs, les flux, les n sexes qui constituent la jeune fille de cette sexualité. C'est l’Âge même qui est un devenir-enfant, comme la Sexualité, n'importe quelle sexualité, un devenir-femme, c'est-à-dire une jeune fille. — Afin de répondre à la question stupide : pourquoi Proust a-t-il fait d'Albert Albertine?
Or, si tous les devenirs sont déjà moléculaires, y compris le devenir-femme, il faut dire aussi que tous les devenirs commencent et passent par le devenir-femme. C'est la clef des autres devenirs.
[…]
Les rites de transvestisme, de travestissement, dans les sociétés primitives où l'homme devient femme ne s'expliquent ni par une organisation sociale qui ferait correspondre des rapports donnés, ni par une organisation psychique qui ferait que l'homme ne désirerait pas moins être femme que la femme, homme (cf Bruno Bettelheim, "Les blessures symboliques", Gallimard). La structure sociale, l'identification psychique laissent de côté trop de facteurs spéciaux: l'enchaînement, le déchaînement et,la communication de devenirs que le travesti déclenche; la puissance du devenir-animal qui en découle; et surtout l'appartenance de ces devenirs à une machine de guerre spécifique. Il en est de même pour la sexualité: celle-ci s'explique mal par l'organisation binaire des sexes, et pas mieux par une organisation bisexuée de chacun des deux. La sexualité met en jeu des devenirs conjugués trop divers qui sont comme n sexes, toute une machine de guerre par quoi l'amour passe. Ce qui ne se ramène pas aux fâcheuses métaphores entre l'amour et la guerre, la séduction et la conquête, la lutte des sexes et la scène de ménage, ou même la guerre-Strindberg: c'est seulement quand l'amour est fini, la sexualité tarie, que les choses apparaissent ainsi. Mais ce qui compte est que l'amour lui-même est une machine de guerre douée de pouvoirs étranges et quasi terrifiants. La sexualité est une production de mille sexes, qui sont autant de devenirs incontrôlables. La sexualité passe par le devenir-femme de l'homme et le devenir-animal de l'humain: émission de particules.
[…]
"Souvenirs et devenirs, points et blocs." — Pourquoi y a-t-il tant de devenirs de l'homme, mais pas de devenir-homme ? C'est d'abord parce que l'homme est majoritaire par excellence, tandis que les devenirs sont minoritaires, tout devenir est un devenir-minoritaire. Par majorité, nous n'entendons pas une quantité relative plus grande, mais la détermination d'un état ou d'un étalon par rapport auquel les quantités plus grandes aussi bien que les plus petites seront dites minoritaires : homme-blanc adulte-mâle, etc. Majorité suppose un état de domination, non pas l'inverse. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a plus de moustiques ou de mouches que d'hommes, mais comment «l'homme » a constitué dans l'univers un étalon par rapport auquel les hommes forment nécessairement (analytiquement) une majorité. De même que la majorité dans la cité suppose un droit de vote, et ne s'établit pas seulement parmi ceux qui possèdent ce droit, mais s'exerce sur ceux qui ne l'ont pas, quel que soit leur nombre, la majorité dans l'univers suppose déjà donnés le droit ou le pouvoir de l'homme. C'est en ce sens que les femmes, les enfants, et aussi les animaux, les végétaux, les molécules sont minoritaires. C'est peut-être même la situation particulière de la femme par rapport à l'étalon-homme qui fait que tous les devenirs, étant minoritaires, passent par un devenir-femme. Il ne faut pourtant pas confondre « minoritaire » en tant que devenir ou processus, et « minorité » comme ensemble ou état. […] Tout devenir est un bloc de coexistence.
[…]
Le propre de la minorité, c'est de faire valoir la puissance du non-dénombrable, même quand elle est composée d'un seul membre. C'est la formule des multiplicités. Minorité comme figure universelle, ou devenir tout le monde. Femme, nous avons tous à le devenir, que nous soyons masculins ou féminins. Non-blanc, nous avons tous à le devenir, que nous soyons blancs, jaunes ou noirs. — La encore, ce n'est pas dire que la lutte au niveau des axiomes soit sans importance ; elle est déterminante au contraire (aux niveaux les plus différents, lutte des femmes pour le vote, pour l'avortement, pour l'emploi; lutte des régions pour l'autonomie; lutte du tiers monde; lutte des masses et des minorités opprimées dans les régions de l'Est ou de |'Ouest...). Mais, aussi, il y a toujours un signe pour montrer que ces luttes sont l'indice d'un autre combat coexistant. Si modeste soit une revendication, elle présente toujours un point que l'axiomatique ne peut supporter, lorsque les gens réclament de poser eux-mêmes leurs propres problèmes, et de déterminer au moins les conditions particulières sous lesquelles ceux-ci peuvent recevoir une solution plus générale (tenir au "Particulier" comme forme innovatrice). On est toujours stupéfait par la répétition de la même histoire : la modestie des revendications de minorités, au début, jointe à l'impuissance de l'axiomatique à résoudre le moindre problème correspondant. Bref, la lutte autour des axiomes est d'autant plus importante qu'elle manifeste et creuse elle-même l'écart entre deux types de propositions, les propositions de flux et les propositions d'axiomes. La puissance des minorités ne se mesure pas à leur capacité d'entrer et de s'imposer dans le système majoritaire, ni même de renverser le critère nécessairement tautologique de la majorité, mais de faire valoir une force des ensembles non dénombrables, si petits soient-ils, contre la force des ensembles dénombrables, même infinis, même renversés ou changés, même ne impliquant de nouveaux axiomes ou, plus encore, une nouvelle axiomatique. La question n'est pas du tout l'anarchie ou l'organisation, pas même le centralisme et la décentralisation, mais celle d'un calcul ou conception des problèmes concernant les ensembles non dénombrables, contre une axiomatique des ensembles dénombrables. Or ce calcul peut avoir ses compositions, ses organisations, même ses centralisations, il ne passe pas par la voie des États ni par le processus de l'axiomatique, mais par un devenir des minorités… »
[…]
Les rites de transvestisme, de travestissement, dans les sociétés primitives où l'homme devient femme ne s'expliquent ni par une organisation sociale qui ferait correspondre des rapports donnés, ni par une organisation psychique qui ferait que l'homme ne désirerait pas moins être femme que la femme, homme (cf Bruno Bettelheim, "Les blessures symboliques", Gallimard). La structure sociale, l'identification psychique laissent de côté trop de facteurs spéciaux: l'enchaînement, le déchaînement et,la communication de devenirs que le travesti déclenche; la puissance du devenir-animal qui en découle; et surtout l'appartenance de ces devenirs à une machine de guerre spécifique. Il en est de même pour la sexualité: celle-ci s'explique mal par l'organisation binaire des sexes, et pas mieux par une organisation bisexuée de chacun des deux. La sexualité met en jeu des devenirs conjugués trop divers qui sont comme n sexes, toute une machine de guerre par quoi l'amour passe. Ce qui ne se ramène pas aux fâcheuses métaphores entre l'amour et la guerre, la séduction et la conquête, la lutte des sexes et la scène de ménage, ou même la guerre-Strindberg: c'est seulement quand l'amour est fini, la sexualité tarie, que les choses apparaissent ainsi. Mais ce qui compte est que l'amour lui-même est une machine de guerre douée de pouvoirs étranges et quasi terrifiants. La sexualité est une production de mille sexes, qui sont autant de devenirs incontrôlables. La sexualité passe par le devenir-femme de l'homme et le devenir-animal de l'humain: émission de particules.
[…]
"Souvenirs et devenirs, points et blocs." — Pourquoi y a-t-il tant de devenirs de l'homme, mais pas de devenir-homme ? C'est d'abord parce que l'homme est majoritaire par excellence, tandis que les devenirs sont minoritaires, tout devenir est un devenir-minoritaire. Par majorité, nous n'entendons pas une quantité relative plus grande, mais la détermination d'un état ou d'un étalon par rapport auquel les quantités plus grandes aussi bien que les plus petites seront dites minoritaires : homme-blanc adulte-mâle, etc. Majorité suppose un état de domination, non pas l'inverse. Il ne s'agit pas de savoir s'il y a plus de moustiques ou de mouches que d'hommes, mais comment «l'homme » a constitué dans l'univers un étalon par rapport auquel les hommes forment nécessairement (analytiquement) une majorité. De même que la majorité dans la cité suppose un droit de vote, et ne s'établit pas seulement parmi ceux qui possèdent ce droit, mais s'exerce sur ceux qui ne l'ont pas, quel que soit leur nombre, la majorité dans l'univers suppose déjà donnés le droit ou le pouvoir de l'homme. C'est en ce sens que les femmes, les enfants, et aussi les animaux, les végétaux, les molécules sont minoritaires. C'est peut-être même la situation particulière de la femme par rapport à l'étalon-homme qui fait que tous les devenirs, étant minoritaires, passent par un devenir-femme. Il ne faut pourtant pas confondre « minoritaire » en tant que devenir ou processus, et « minorité » comme ensemble ou état. […] Tout devenir est un bloc de coexistence.
[…]
Le propre de la minorité, c'est de faire valoir la puissance du non-dénombrable, même quand elle est composée d'un seul membre. C'est la formule des multiplicités. Minorité comme figure universelle, ou devenir tout le monde. Femme, nous avons tous à le devenir, que nous soyons masculins ou féminins. Non-blanc, nous avons tous à le devenir, que nous soyons blancs, jaunes ou noirs. — La encore, ce n'est pas dire que la lutte au niveau des axiomes soit sans importance ; elle est déterminante au contraire (aux niveaux les plus différents, lutte des femmes pour le vote, pour l'avortement, pour l'emploi; lutte des régions pour l'autonomie; lutte du tiers monde; lutte des masses et des minorités opprimées dans les régions de l'Est ou de |'Ouest...). Mais, aussi, il y a toujours un signe pour montrer que ces luttes sont l'indice d'un autre combat coexistant. Si modeste soit une revendication, elle présente toujours un point que l'axiomatique ne peut supporter, lorsque les gens réclament de poser eux-mêmes leurs propres problèmes, et de déterminer au moins les conditions particulières sous lesquelles ceux-ci peuvent recevoir une solution plus générale (tenir au "Particulier" comme forme innovatrice). On est toujours stupéfait par la répétition de la même histoire : la modestie des revendications de minorités, au début, jointe à l'impuissance de l'axiomatique à résoudre le moindre problème correspondant. Bref, la lutte autour des axiomes est d'autant plus importante qu'elle manifeste et creuse elle-même l'écart entre deux types de propositions, les propositions de flux et les propositions d'axiomes. La puissance des minorités ne se mesure pas à leur capacité d'entrer et de s'imposer dans le système majoritaire, ni même de renverser le critère nécessairement tautologique de la majorité, mais de faire valoir une force des ensembles non dénombrables, si petits soient-ils, contre la force des ensembles dénombrables, même infinis, même renversés ou changés, même ne impliquant de nouveaux axiomes ou, plus encore, une nouvelle axiomatique. La question n'est pas du tout l'anarchie ou l'organisation, pas même le centralisme et la décentralisation, mais celle d'un calcul ou conception des problèmes concernant les ensembles non dénombrables, contre une axiomatique des ensembles dénombrables. Or ce calcul peut avoir ses compositions, ses organisations, même ses centralisations, il ne passe pas par la voie des États ni par le processus de l'axiomatique, mais par un devenir des minorités… »
Un livre n’a pas d’objet ni de sujet, il est fait de matières diversement formées, de dates et de vitesses très différentes. Dès qu’on attribue le livre à un sujet, on néglige ce travail des matières, et l’extériorité de leurs relations. On fabrique un bon Dieu pour des mouvements géologiques. Dans un livre comme dans toute chose, il y a des lignes d’articulation ou de segmentarité, des strates, des territorialités ; mais aussi des lignes de fuite, des mouvements de déterritorialisation et de déstratification. Les vitesses comparées d’écoulement d’après ces lignes entraînent des phénomènes de retard relatif, de viscosité, ou au contraire de précipitation et de rupture. Tout cela, les lignes et les vitesses mesurables, constitue un agencement. Un livre est un tel agencement, comme tel inattribuable. C’est une multiplicité – mais on ne sait pas encore ce que le multiple implique quand il cesse d’être attribué, c’est-à-dire quand il est élevé à l’état de substantif. Un agencement machinique est tourné vers les strates qui en font sans doute une sorte d’organisme, ou bien une totalité signifiante, ou bien une détermination attribuable à un sujet, mais non moins vers un corps sans organes qui ne cesse de défaire l’organisme, de faire passer et circuler des particules asignifiantes, intensités pures, et de s’attribuer les sujets auxquels il ne laisse plus qu’un nom comme trace d’une intensité. Quel est le corps sans organes d’un livre ? Il y en a plusieurs, d’après la nature des lignes considérées, d’après leur teneur ou leur densité propre, d’après leur possibilité de convergence sur un « plan de consistance », qui en assure la sélection. Là comme ailleurs, l’essentiel, ce sont les unités de mesure : quantifier l’écriture. Il n’y a pas de différence entre ce dont un livre parle et la manière dont il est fait. Un livre n’a donc pas davantage d’objet. En tant qu’agencement, il est seulement lui-même en connexion avec d’autres agencements, par rapport à d’autres corps sans organes. On ne demandera jamais ce que veut dire un livre, signifié ou signifiant, on ne cherchera rien à comprendre dans un livre, on se demandera avec quoi il fonctionne, en connexion de quoi il fait ou non passer des intensités, dans quelles multiplicités il introduit et métamorphose la sienne, avec quels corps sans organes il fait lui-même converger le sien. Un livre n’existe que par le dehors et au-dehors. Ainsi, un livre étant lui-même une petite machine, dans quel rapport à son tour mesurable cette machine littéraire est-elle avec une machine de guerre, une machine d’amour, une machine révolutionnaire, etc. – et avec une machine abstraite qui les entraîne ? On nous a reproché d’invoquer trop souvent des littérateurs. Mais la seule question quand on écrit, c’est de savoir avec quelle autre machine la machine littéraire peut être branchée, et doit être branchée pour fonctionner. Kleist et une folle machine de guerre, Kafka et une machine bureaucratique inouïe… (et si l’on devenait animal ou végétal par littérature, ce qui ne veut certes pas dire littérairement ? ne serait-ce pas d’abord par la voix qu’on devient animal ?). La littérature est un agencement, elle n’a rien à voir avec de l’idéologie, il n’y a pas et il n’y a jamais eu d’idéologie.
Nous ne savons plus très bien ce que sont les bijoux, tant ils ont subi d'adaptations secondaires. Mais quelque chose se réveille dans notre âme lorsqu'on nous dit que l'orfèvrerie fut l'art "barbare", ou l'art nomade par excellence, et lorsque nous voyons ces chefs-d'œuvre d'art mineur. Ces fibules, ces plaques d'or et d'argent, ces bijoux, concernent de petits objets meubles, non seulement faciles à transporter, mais qui n'appartiennent à l'objet qu'en tant qu'il bouge. Ces plaques constituent des traits d'expression de pure vitesse, sur des objets eux-mêmes mobiles et mouvants. Elles ne passent pas par un rapport forme-matière, mais motif-support, où la terre n'est plus qu'un sol, et même il n'y a plus de sol du tout, le support étant aussi mobile que le motif. Elles donnent aux couleurs la vitesse de la lumière, faisant rougeoyer l'or, et faisant de l'argent une lumière blanche. Elles appartiennent au harnais du cheval, au fourreau de l'épée, au vêtement du guerrier, à la poignée de l'arme : elles décorent même ce qui ne servira qu'une fois, la pointe d'une flèche.
"C'est parce que nous n'avons plus rien à cacher que nous ne pouvons plus être saisis. Devenir soi-même imperceptible, avoir défait l'amour pour devenir capable d'aimer. Avoir défait son propre moi pour être enfin seul, et rencontrer le vrai double à l'autre bout de la ligne. Passager clandestin d'un voyage immobile. Devenir comme tout le monde, mais justement ce n'est un devenir que pour celui qui sait n'être personne, n'être plus personne. II s'est peint gris sur gris." (pp. 241-242)
Videos de Gilles Deleuze (11)
Voir plusAjouter une vidéo
David Lapoujade vous présente l'ouvrage "Sur la peinture : cours mars-juin 1981" de Gilles Deleuze aux Éditions de Minuit. Entretien avec Jérémy Gadras.
Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/2928333/gilles-deleuze-sur-la-peinture-cours-mars-juin-1981
Note de musique : © mollat Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/ Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux : Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/ Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/ Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/ Vimeo : https://vimeo.com/mollat
Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/2928333/gilles-deleuze-sur-la-peinture-cours-mars-juin-1981
Note de musique : © mollat Sous-titres générés automatiquement en français par YouTube.
Visitez le site : http://www.mollat.com/ Suivez la librairie mollat sur les réseaux sociaux : Instagram : https://instagram.com/librairie_mollat/ Facebook : https://www.facebook.com/Librairie.mollat?ref=ts Twitter : https://twitter.com/LibrairieMollat Linkedin : https://www.linkedin.com/in/votre-libraire-mollat/ Soundcloud: https://soundcloud.com/librairie-mollat Pinterest : https://www.pinterest.com/librairiemollat/ Vimeo : https://vimeo.com/mollat
+ Lire la suite
Dans la catégorie :
Troubles psychiatriquesVoir plus
>Maladies>Maladies du système nerveux. Troubles psychiques>Troubles psychiatriques (235)
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Gilles Deleuze (38)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
442 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre442 lecteurs ont répondu