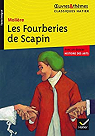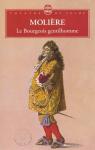Critiques filtrées sur 5 étoiles
Dans - le goût des autres - ce superbe film d'Agnès Jaoui, Castella-Bacri, homme frust(r)e aux entournures, tombe amoureux de - Bérénice - la pièce de Jean Racine, et de son interprète.
Pourquoi initier cette critique ainsi ?
Parce que je suis persuadé que les chefs-d'oeuvre en littérature, et le théâtre est littérature, les chefs-d'oeuvre ne s'empoussièrent pas avec le temps, ne se naphtalinent pas au prétexte que les temps et leurs codes ( terme générique ) changent.
Ainsi lis-je avec autant d'intérêt et d'émotion des pièces de Sophocle, d'Aristophane, de Corneille, de Racine, de Baumarchais, de Dumas, d'Hugo, de Rostand, de Guitry, de Giraudoux, de Camus, de Sartre, de Tchekhov, de Gogol, de Gorki, de Shakespeare ( j'ai une véritable passion pour Macbeth ), de Tennessee Williams, de Miller, de Brecht, de Beckett, de Ionesco, de Pinter, de Yasmina Reza, de Nathalie Sarraute, d'Ariel Dorfman, de Christopher Hampton...o.k. o.k o.k o.k comme dirait Jonasz...
J'ai vu 100 fois, j'exagère... plutôt 99..., la trilogie de Pagnol - Marius - - Fanny - - César - ( pas au théâtre, hélas ! )... et je ne m'en lasse pas.
Donc, retrouver Alceste le plus droit, le plus loyal, le plus honnête et le plus rigoureux des hommes qui, dans sa vertu paroxystique, hait un monde qui est tout son contraire, un monde d'apparences, de mensonges, de fourberies, de trahisons, de compromissions et de lâchetés, c'est se confronter à une comédie de moeurs qui, si elle a troqué des rubans contre des dreadlocks, des perruques contre des implants capillaires, la céruse contre le botox, reste notre quotidien.
Ce petit salon dans lequel évoluent Célimène la coquette médisante, Arsinoé son amie et rivale faussement prude et authentiquement jalouse, Éliante sa cousine bonne et vertueuse, Philinte, l'ami dévoué d'Alceste, homme qui oppose à la misanthropie de ce dernier une antonymie qui pourrait s'apparenter à la philanthropie si elle n'était pas nimbée d'un peu trop d'indulgence et de complaisance, les petits marquis que sont Oronte "le poète" vers de terre peu reluisant, oisif dont la seule gloire est d'être de ceux qui assistent matin et soir au lever et au coucher du Roi Soleil assis sur son trône d'aisance, Acaste et Clitandre tous deux aussi superficiels qu'inutiles, ce salon n'est-il pas l'allégorie d'un monde qui, si quelques-unes de ses formes ont changé, a pour autant maladivement gardé le même fond tout autant gangrené par le côté sombre, malsain et équivoque de l'humaine nature ?
Alceste notre misanthrope a donc un talon d'Achille qui se nomme Célimène, dont il est jalousement et atrabilairement épris. Arsinoé et Éliante sont amoureuses de cet homme inflexiblement grincheux. Philinte aime Éliante et nos trois marquis se disputent les faveurs de la belle Célimène.
C'était un petit rappel pour ceux qui auraient oublié ( je n'y crois pas mais dans le doute...) ou un court résumé pour ceux qui ne connaissent pas encore la pièce... il y en a chez les jeunes lecteurs... et chez les moins jeunes.
Naturellement, pour savoir comment se dénouera l'intrigue, je vous invite à lire ce chef-d'oeuvre de Molière dont je reste persuadé qu'il continue de nous parler, de nous interroger, de nous instruire... et moi de m'émouvoir...
À titre d'exemple, prenons la scène du sonnet. Combien vois-je autour de moi sur les réseaux sociaux, agitant leurs grelots de postulants à la Pléiade ou à l'Académie, d'Oronte 2.0 ?
Savez-vous qu'il y a en France aujourd'hui plus " d'auteurs " que de lecteurs ?
Qu'en aurait pensé Molière ?
Et ces nouveaux génies de la littérature, pareils au petit marquis, ne doutent pas un seul instant de leur talent... et gare s'il se trouve un Alceste pour nuancer leurs certitudes ! Comme lui, il sera mis au ban et contraint à l'exil...
Non, le monde est bien resté ce qu'il était au temps où Jean-Baptiste Poquelin le tartuffait.
L'homme est un animal culturel complexe, écartelé entre son aspiration à la vérité incarnée par Alceste, ses vanités dont Oronte nous est une figure familière, son désir de plaire que Célimène nous renvoie à travers un miroir où nous nous mirons souvent, sa quête de l'absolu, de l'inaccessible dont la douce Éliante à la manière d'un Don Quichotte nous murmure qu'elle devrait être notre essentiel.
Mais au mieux, pouvons-nous nous estimer satisfaits lorsque nous parvenons â être des Philinte, des hommes honnêtes.
Pour conclure et pour étayer mon long propos, un quatrain dodécasyllabique que j'ai écrit avec la plume d'Oronte et la lucidité d'Alceste.
ÉCRIVAILLEURS
Tu écris, il ou elle écrit, nous écrivons
Imbus et convaincus de posséder le don
Mais de tous ces mots sans honneur qui sont légion
Sache que le dernier reviendra au pilon...
Lisez ou relisez Molière, ça fait le plus grand bien !
Pourquoi initier cette critique ainsi ?
Parce que je suis persuadé que les chefs-d'oeuvre en littérature, et le théâtre est littérature, les chefs-d'oeuvre ne s'empoussièrent pas avec le temps, ne se naphtalinent pas au prétexte que les temps et leurs codes ( terme générique ) changent.
Ainsi lis-je avec autant d'intérêt et d'émotion des pièces de Sophocle, d'Aristophane, de Corneille, de Racine, de Baumarchais, de Dumas, d'Hugo, de Rostand, de Guitry, de Giraudoux, de Camus, de Sartre, de Tchekhov, de Gogol, de Gorki, de Shakespeare ( j'ai une véritable passion pour Macbeth ), de Tennessee Williams, de Miller, de Brecht, de Beckett, de Ionesco, de Pinter, de Yasmina Reza, de Nathalie Sarraute, d'Ariel Dorfman, de Christopher Hampton...o.k. o.k o.k o.k comme dirait Jonasz...
J'ai vu 100 fois, j'exagère... plutôt 99..., la trilogie de Pagnol - Marius - - Fanny - - César - ( pas au théâtre, hélas ! )... et je ne m'en lasse pas.
Donc, retrouver Alceste le plus droit, le plus loyal, le plus honnête et le plus rigoureux des hommes qui, dans sa vertu paroxystique, hait un monde qui est tout son contraire, un monde d'apparences, de mensonges, de fourberies, de trahisons, de compromissions et de lâchetés, c'est se confronter à une comédie de moeurs qui, si elle a troqué des rubans contre des dreadlocks, des perruques contre des implants capillaires, la céruse contre le botox, reste notre quotidien.
Ce petit salon dans lequel évoluent Célimène la coquette médisante, Arsinoé son amie et rivale faussement prude et authentiquement jalouse, Éliante sa cousine bonne et vertueuse, Philinte, l'ami dévoué d'Alceste, homme qui oppose à la misanthropie de ce dernier une antonymie qui pourrait s'apparenter à la philanthropie si elle n'était pas nimbée d'un peu trop d'indulgence et de complaisance, les petits marquis que sont Oronte "le poète" vers de terre peu reluisant, oisif dont la seule gloire est d'être de ceux qui assistent matin et soir au lever et au coucher du Roi Soleil assis sur son trône d'aisance, Acaste et Clitandre tous deux aussi superficiels qu'inutiles, ce salon n'est-il pas l'allégorie d'un monde qui, si quelques-unes de ses formes ont changé, a pour autant maladivement gardé le même fond tout autant gangrené par le côté sombre, malsain et équivoque de l'humaine nature ?
Alceste notre misanthrope a donc un talon d'Achille qui se nomme Célimène, dont il est jalousement et atrabilairement épris. Arsinoé et Éliante sont amoureuses de cet homme inflexiblement grincheux. Philinte aime Éliante et nos trois marquis se disputent les faveurs de la belle Célimène.
C'était un petit rappel pour ceux qui auraient oublié ( je n'y crois pas mais dans le doute...) ou un court résumé pour ceux qui ne connaissent pas encore la pièce... il y en a chez les jeunes lecteurs... et chez les moins jeunes.
Naturellement, pour savoir comment se dénouera l'intrigue, je vous invite à lire ce chef-d'oeuvre de Molière dont je reste persuadé qu'il continue de nous parler, de nous interroger, de nous instruire... et moi de m'émouvoir...
À titre d'exemple, prenons la scène du sonnet. Combien vois-je autour de moi sur les réseaux sociaux, agitant leurs grelots de postulants à la Pléiade ou à l'Académie, d'Oronte 2.0 ?
Savez-vous qu'il y a en France aujourd'hui plus " d'auteurs " que de lecteurs ?
Qu'en aurait pensé Molière ?
Et ces nouveaux génies de la littérature, pareils au petit marquis, ne doutent pas un seul instant de leur talent... et gare s'il se trouve un Alceste pour nuancer leurs certitudes ! Comme lui, il sera mis au ban et contraint à l'exil...
Non, le monde est bien resté ce qu'il était au temps où Jean-Baptiste Poquelin le tartuffait.
L'homme est un animal culturel complexe, écartelé entre son aspiration à la vérité incarnée par Alceste, ses vanités dont Oronte nous est une figure familière, son désir de plaire que Célimène nous renvoie à travers un miroir où nous nous mirons souvent, sa quête de l'absolu, de l'inaccessible dont la douce Éliante à la manière d'un Don Quichotte nous murmure qu'elle devrait être notre essentiel.
Mais au mieux, pouvons-nous nous estimer satisfaits lorsque nous parvenons â être des Philinte, des hommes honnêtes.
Pour conclure et pour étayer mon long propos, un quatrain dodécasyllabique que j'ai écrit avec la plume d'Oronte et la lucidité d'Alceste.
ÉCRIVAILLEURS
Tu écris, il ou elle écrit, nous écrivons
Imbus et convaincus de posséder le don
Mais de tous ces mots sans honneur qui sont légion
Sache que le dernier reviendra au pilon...
Lisez ou relisez Molière, ça fait le plus grand bien !
Rousseau détestait Molière, et singulièrement "Le Misanthrope". Cet ayatollah de jean-Jacques, si révolutionnaire par ailleurs, voulait, à cause du Misanthrope , interdire le théâtre dans sa république idéale...trouvant immoral qu'on rie d'un personnage aussi sincère et vertueux qu'Alceste, ( qui lui ressemblait tant, à lui, Rousseau..)
Alceste est malheureux, mal dans sa peau et mal dans son siècle:
trop sincère, trop d'une pièce, peu rompu aux usages d'une civilité qui frise bien souvent l'hypocrisie, et bien éloigné du type idéal de l'honnête homme tel que le concevait le siècle classique- ayant de la culture sans en faire un étendard du bon goût, courtois et mesuré dans ses propos, recherchant la compagnie des hommes sans prétendre les réformer et celle des femmes sans leur faire la morale - un pessimiste " cool" en somme...
Alceste aurait été tout à fait dans le coup deux siècles plus tard: les romantiques l'auraient adoubé sans façon, il se serait fait pote avec les deux Alfred, aurait ruminé avec l'un, soupiré avec l'autre, aurait mis son gilet rouge à la Gautier devant les rimailleurs de salon, et préféré converser gentiment confitures avec Aurore Dupin Dudevant ( plus connue sous le nom de George Sand) plutôt que d'écouter cette langue-de-pute de Célimène tailler des croupières à tous ses amis..
Ce léger décalage horaire est le drame d'une belle pièce comme "le Misanthrope". Alceste y est ridicule pour son temps et bien dans son genre , la comédie, ou pathétique, plus dans son genre et pas encore dans son temps - selon le point de vue qu'on adopte...
Le rire y est donc toujours un peu douloureux, la tristesse un peu déplacée...
Pour en comprendre toutes les subtilités il faut revoir le film "Alceste à bicyclette".
Délices du jeu de Lucchini / Wilson et échangisme virtuose des rôles d' Alceste et Philinte...
Alceste est malheureux, mal dans sa peau et mal dans son siècle:
trop sincère, trop d'une pièce, peu rompu aux usages d'une civilité qui frise bien souvent l'hypocrisie, et bien éloigné du type idéal de l'honnête homme tel que le concevait le siècle classique- ayant de la culture sans en faire un étendard du bon goût, courtois et mesuré dans ses propos, recherchant la compagnie des hommes sans prétendre les réformer et celle des femmes sans leur faire la morale - un pessimiste " cool" en somme...
Alceste aurait été tout à fait dans le coup deux siècles plus tard: les romantiques l'auraient adoubé sans façon, il se serait fait pote avec les deux Alfred, aurait ruminé avec l'un, soupiré avec l'autre, aurait mis son gilet rouge à la Gautier devant les rimailleurs de salon, et préféré converser gentiment confitures avec Aurore Dupin Dudevant ( plus connue sous le nom de George Sand) plutôt que d'écouter cette langue-de-pute de Célimène tailler des croupières à tous ses amis..
Ce léger décalage horaire est le drame d'une belle pièce comme "le Misanthrope". Alceste y est ridicule pour son temps et bien dans son genre , la comédie, ou pathétique, plus dans son genre et pas encore dans son temps - selon le point de vue qu'on adopte...
Le rire y est donc toujours un peu douloureux, la tristesse un peu déplacée...
Pour en comprendre toutes les subtilités il faut revoir le film "Alceste à bicyclette".
Délices du jeu de Lucchini / Wilson et échangisme virtuose des rôles d' Alceste et Philinte...
C'est ma première rencontre avec ce Misanthrope. Jamais lu, jamais vu. Je suis presque étonné de découvrir dans la notice qui accompagne la pièce (écrite par Georges Mongrédien, dans Molière, oeuvres complètes T3) qu'« il est, au gré des connaisseurs, du plus beau chef-d'oeuvre de Molière et marque le sommet de son oeuvre ». Mongrédien dit aussi que « le public fut manifestement désemparé par ce comique sérieux, âpre, qui ne déchaînait par les rires et les applaudissements, comme ses précédentes comédies, se contentant de faire continuellement rire dans l'âme ». Un chef-d'oeuvre, donc, en décalage avec reste de la production de l'auteur.
Je ne me qualifie certes pas de connaisseur, mais je coche volontiers la case du plaisir à la lecture de la pièce. Je confirme aussi qu'on n'y retrouve pas la farce qui anime nombre des pièces de Molière. Et j'ai l'impression que cela apporte une petite note d'amertume dans mon appréciation car, comme ce fameux public, je m'attendais à un peu plus de premier degré d'humour.
Oh, j'imagine que, sur scène, on peut jouer le personnage d'Alceste de plusieurs façons : ridicule, pathétique, voire anachroniquement romantique. A la lecture, c'est plutôt le romantique qui m'a frappé. L'homme a des principes chevillés au corps et opposés aux standards de la société. Il n'accepte pas les mensonges, la courtisanerie et les faux-semblants. Il faut être vrai dans l'âme comme dans la parole. Évidemment, cela ne peut manquer de lui causer des problèmes, par exemple lorsqu'il dit tout net à Oronte – un homme bien en cours – que ses vers sont lamentables.
Le romantique ne manque pas non plus dans l'amour qu'Alceste ressent pour Célimène qui est son opposé absolu. Pour elle les apparences sont primordiales. Elle agit et parle toujours pour se faire bien voir des personnes en face d'elles, et adore ridiculiser les absents (donnant lieu à des portraits de toute comique beauté). Elle mène par le bout du nez un nombre impressionnant de prétendants, qu'elle casse dans leur dos. Alceste n'est pas dupe, n'a de cesse de l'implorer de changer, mais ne parvient pas à faire plier ses sentiments devant sa morale.
Il est surprenant que Célimène ait cru si longtemps que son attitude n'allait pas finir par être dévoilée, que tout un chacun connaitrait finalement sa fourberie et qu'elle se retrouverait seule, aussi éloignée de la société qui la rejette qu'Alceste lui-même qui rejette la société.
En quelque sorte, les deux se retrouvent tout en étant aux antipodes.
Je ne me qualifie certes pas de connaisseur, mais je coche volontiers la case du plaisir à la lecture de la pièce. Je confirme aussi qu'on n'y retrouve pas la farce qui anime nombre des pièces de Molière. Et j'ai l'impression que cela apporte une petite note d'amertume dans mon appréciation car, comme ce fameux public, je m'attendais à un peu plus de premier degré d'humour.
Oh, j'imagine que, sur scène, on peut jouer le personnage d'Alceste de plusieurs façons : ridicule, pathétique, voire anachroniquement romantique. A la lecture, c'est plutôt le romantique qui m'a frappé. L'homme a des principes chevillés au corps et opposés aux standards de la société. Il n'accepte pas les mensonges, la courtisanerie et les faux-semblants. Il faut être vrai dans l'âme comme dans la parole. Évidemment, cela ne peut manquer de lui causer des problèmes, par exemple lorsqu'il dit tout net à Oronte – un homme bien en cours – que ses vers sont lamentables.
Le romantique ne manque pas non plus dans l'amour qu'Alceste ressent pour Célimène qui est son opposé absolu. Pour elle les apparences sont primordiales. Elle agit et parle toujours pour se faire bien voir des personnes en face d'elles, et adore ridiculiser les absents (donnant lieu à des portraits de toute comique beauté). Elle mène par le bout du nez un nombre impressionnant de prétendants, qu'elle casse dans leur dos. Alceste n'est pas dupe, n'a de cesse de l'implorer de changer, mais ne parvient pas à faire plier ses sentiments devant sa morale.
Il est surprenant que Célimène ait cru si longtemps que son attitude n'allait pas finir par être dévoilée, que tout un chacun connaitrait finalement sa fourberie et qu'elle se retrouverait seule, aussi éloignée de la société qui la rejette qu'Alceste lui-même qui rejette la société.
En quelque sorte, les deux se retrouvent tout en étant aux antipodes.
Tout homme qui a quarante ans n'est pas misanthrope n'a jamais aimé les hommes ( Nicolas de Chamfort).
Le défenseur des droits proposait des lieux sans contrôles policiers, afin de ne pas "discriminer" une minorité de résidents de cités - une autre façon de créer des zones de non- droit.
Le même jour, France Culture saluait l'initiative d'un "centre de théâtre" invitant des jeunes"auteurs" à réécrire
cinq pièces de Molière "afin de le rendre plus accessible" et de le "désacraliser".
Quel lien ? Une tragi-comédie !
" J'entre en une humeur noire, et un chagrin profond,
Quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font ;
Je ne trouve partout que lâche flatterie,
Qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie ;
Je n'y puis plus tenir, j'enrage, et mon dessein
Est de rompre en visière à tout le genre humain".
Le Misanthrope, (I, 1, v. 89-94)
Bonne lecture.
Michel.
Lien : https://fureur-de-lire.blogs..
Le défenseur des droits proposait des lieux sans contrôles policiers, afin de ne pas "discriminer" une minorité de résidents de cités - une autre façon de créer des zones de non- droit.
Le même jour, France Culture saluait l'initiative d'un "centre de théâtre" invitant des jeunes"auteurs" à réécrire
cinq pièces de Molière "afin de le rendre plus accessible" et de le "désacraliser".
Quel lien ? Une tragi-comédie !
" J'entre en une humeur noire, et un chagrin profond,
Quand je vois vivre entre eux les hommes comme ils font ;
Je ne trouve partout que lâche flatterie,
Qu'injustice, intérêt, trahison, fourberie ;
Je n'y puis plus tenir, j'enrage, et mon dessein
Est de rompre en visière à tout le genre humain".
Le Misanthrope, (I, 1, v. 89-94)
Bonne lecture.
Michel.
Lien : https://fureur-de-lire.blogs..
On associe souvent Molière à la comédie, aux rires et à la satire. Pourtant, il existe une pièce à part, une comédie marginale, celle du Misanthrope. le texte se démarque déjà. Même si d'autres pièces de Molière sont écrites en vers, le style du misanthrope est plus recherché, plus poétique. Mais c'est surtout l'histoire qui la rend particulière. Les souffrances d'Alceste d'une sincérité déconcertante et, contrairement à celles du malade imaginaire, sont vraies. Personnellement, je lis (ou j'entends) toujours les plaintes de Molière derrière les mots d'Alceste. Cette douleur authentique magnifie tout en ajoutant une pointe de nostalgie : le rire devient amer, l'amour plus réfléchi (et donc plus puissant et plus grand), et la tristesse plus poignante, cette incapacité de l'artiste à comprendre le monde et à s'y fondre, tout en le dépeignant paradoxalement avec une acuité exemplaire. Plus jeune, une première lecture m'avait tellement déconcertée par rapport à mes attentes que je ne l'avais pas appréciée. Il m'a fallu la voir au théâtre pour la découvrir véritablement. Depuis, je la relis régulièrement.
(Plus sur Instagram)
Lien : https://www.instagram.com/p/..
(Plus sur Instagram)
Lien : https://www.instagram.com/p/..
J'ai envie de reproduire l'avis de Jean-Jacques Rousseau :
"Dans toutes les autres pièces de Molière, le personnage ridicule est haïssable ou méprisable. Dans celle-là, (...) Alceste (...) ce caractère si vertueux est présenté comme ridicule."
in Classique Larousse 1965, notice G. Sablayrolles. (cette édition porte une mention étonnante : "il est interdit d'exporter le présent ouvrage au Canada, sous peine des sanctions prévues par la loi et par nos contrats". Larousse est toujours fâché avec le Canada ?)
"Dans toutes les autres pièces de Molière, le personnage ridicule est haïssable ou méprisable. Dans celle-là, (...) Alceste (...) ce caractère si vertueux est présenté comme ridicule."
in Classique Larousse 1965, notice G. Sablayrolles. (cette édition porte une mention étonnante : "il est interdit d'exporter le présent ouvrage au Canada, sous peine des sanctions prévues par la loi et par nos contrats". Larousse est toujours fâché avec le Canada ?)
Créée en juin 1666, la pièce a connu une longue gestation. Molière aurait commencé son écriture en 1663, quelques lecture d'extraits ont eu lieu au début de 1664. Mais c'est au cours de l'été 1665 qu'il va s'employer à mettre définitivement en forme les différentes éléments de sa pièce. Entre temps, il y a eu l'interdiction du Tartuffe, qui a causée des pertes d'argent à la troupe, et a provoqué un besoin de justification pour son auteur, le besoin de démontrer que ses pièces ne sont pas immorales. Achevé à l'automne 1665, la pièce devait être créée au début de l'année 1666, mais le destin s'en mêle. La mort d'Anne d'Autriche, la mère du roi, fait fermer les théâtres. Ils peuvent reprendre leur activité fin février, mais c'est peu de temps avant la relâche obligatoire de Pâques. Molière va donc attendre jusqu'en juin pour donner sa pièce, ce qui n'est pas le meilleur moment, car la cour, et donc une partie importante du public potentiel, partait à Fontainebleau. Ce qui n'a pas empêché la pièce d'attirer de nombreux spectateurs.
L'intrigue est fort mince : Alceste aimé Célimène. Il se pique de refuser d'hypocrisie, de dire aux gens ce qu'il pense d'eux, refuse toute compromission dans les rapports humains. Elle est coquette et veut séduire tout le monde ; en plus de ne pas aimer les hommes, il est jaloux. Il veut s'expliquer avec elle, mais il est en permanence interrompu, essentiellement par les gens qui viennent la voir : ses amoureux, ses amies… D'autres femmes sont attirées par le bel ombrageux : Eliante, la cousine sensée et modeste de Célimène, Arsinoé, une « prude ». Philinte, l'ami modéré d'Alceste, essaie de le mettre en face de ses contradictions, mais « La raison n'est pas ce qui règle l'amour », et Alceste va donc essayer de réformer Célimène. Cette dernière, dans son envie de plaire à tous, a écrit des lettres où elle déclare sa flamme à ses quatre soupirants, et déchire ses autres prétendants. Elles finissent par devenir publiques, et Célimène est quittée par tous, sauf Alceste, qui lui propose le mariage, à condition de quitter le monde avec lui. Elle refuse, et il part seul.
La pièce est complexe, en partie parce qu'elle a des sources et inspirations diverses. Au départ conçue comme une sorte de prolongement de ses petites comédies de salon, La critique de l'Ecole des femmes et l'Impromptu de Versailles, il s'agissait de faire des portraits typiques du temps, de faire rire à partir du comportement des hommes en société, de leurs petits ridicules. Molière a probablement emprunté le thème de la coquette, démasquée par les quatre billets qu'elle a écrit à quatre prétendants, à Mlle de Scudéry et à son roman le Grand Cyrus, où on trouve cette situation, de même que la scène où l'amie de coquette la met en garde, de façon désintéressée et sincère. le thème de la jalousie, souvent intempestive, est un des grands sujets de Molière, le jaloux étant tourné en ridicule, selon les normes galantes de l'époque. de même le défilé des personnages indésirables qui empêchent le héros de parvenir à ses fins, c'est à dire à s'approcher de son aimée, est un thème récurrent, particulièrement développé dans Les fâcheux.
Mais l'affaire Tartuffe a aussi laissé des traces, suite à l'interdiction, Molière a proclamé que le but de la comédie était de corriger les vices des hommes, en les faisant rire. Il s'agissait donc aussi d'essayer de faire entrer la nouvelle pièce dans cette logique de la dénonciation des vices du temps.
Les personnages de la pièce de Molière ne sont pas sans évoquer la pièce de Desmarets de Saint-Sorlin : chaque personnage de pièce est obsédé par une idée fixe délirante, qui le coupe du reste du monde, fausse ses rapports aux autres. Ainsi Oronte s'imagine être un poète de talent, alors qu'il ne fait que copier de façon peu inspirée les procédés poétiques en vogue. Les deux petits marquis ont une idée exagérée de leur valeur, alors qu'ils sont falots et sans véritable personnalité. Arsinoé se donne des airs de prude et sage personne et veut qu'on la voit comme telle. Célimène s'imagine pouvoir attirer et séduire tous les hommes, leur adoration lui étant indispensable pour se sentir exister. Même Alceste, avec sa représentation négative de l'espèce humaine, qu'il fait tout pour voir confirmer (par exemple dans son procès) tourne quelque peu à la manie pathologique. Or la sociabilité était considérée à l'époque comme essentielle, l'inaptitude à vivre en société était vue comme un grave défaut pour le moins.
Mais Molière arrive, à partir d'éléments disparates et de thèmes courants à faire quelque chose de singulier, pouvant donner lieu à des interprétations et lectures multiples. Ses personnages font l'expérience de la confrontation à l'autre, qui permet de se définir, de voir apparaître ses limites, ses folies, ses fragilités. Même dans un monde dont le principe est la sociabilité, derrière la façade des relations policées se formulent des jugements impitoyables, des mises à mort symboliques. D'autant plus impitoyables que les relations de façade sont charmeuses. Alceste en quittant le jeu, signifie quelque part son échec : on ne peut exister avec l'autre dans une sincérité absolue et permanente. En même temps, que signifie dire la vérité ? Prétendre la posséder est un aussi une manifestation d'orgueil : à quel point est-t-on sûr de ne pas se tromper dans son jugement de l'autre, de ne pas partir sur une idée surestimée voire délirante de sa propre infaillibilité, de sa propre personne, comme les Visionnaires.
Tous sortent d'une certaine façon amoindris et blessés de cette expérience : les petit marquis qui ont pu lire des descriptions méchantes et justes de leurs petites personnes, Oronte qui a entendu d'amères critiques de ses vers et qui a compris que Célimène se jouait de lui, Arsinoé égratignée par Célimène et rejetée par Alceste, Célimène qui a perdu ses prétendants et dont le caractère faux et les persiflages cruels ont été mis en lumière, Alceste enfin éclairé sur son amour et voué à la solitude. Même les sages Eliante et Philinte, qui vont convoler dans un mariage raisonnable, apparaissent comme trop sages justement, sans grand risque de souffrir, mais sans grand espoir de connaître des sensations, des sentiments, des passions, qui les sortent d'eux-même, de leur douce torpeur confortable. Tout le monde est finalement renvoyé à lui-même et à sa finitude, quelle qu'elle soit.
L'intrigue est fort mince : Alceste aimé Célimène. Il se pique de refuser d'hypocrisie, de dire aux gens ce qu'il pense d'eux, refuse toute compromission dans les rapports humains. Elle est coquette et veut séduire tout le monde ; en plus de ne pas aimer les hommes, il est jaloux. Il veut s'expliquer avec elle, mais il est en permanence interrompu, essentiellement par les gens qui viennent la voir : ses amoureux, ses amies… D'autres femmes sont attirées par le bel ombrageux : Eliante, la cousine sensée et modeste de Célimène, Arsinoé, une « prude ». Philinte, l'ami modéré d'Alceste, essaie de le mettre en face de ses contradictions, mais « La raison n'est pas ce qui règle l'amour », et Alceste va donc essayer de réformer Célimène. Cette dernière, dans son envie de plaire à tous, a écrit des lettres où elle déclare sa flamme à ses quatre soupirants, et déchire ses autres prétendants. Elles finissent par devenir publiques, et Célimène est quittée par tous, sauf Alceste, qui lui propose le mariage, à condition de quitter le monde avec lui. Elle refuse, et il part seul.
La pièce est complexe, en partie parce qu'elle a des sources et inspirations diverses. Au départ conçue comme une sorte de prolongement de ses petites comédies de salon, La critique de l'Ecole des femmes et l'Impromptu de Versailles, il s'agissait de faire des portraits typiques du temps, de faire rire à partir du comportement des hommes en société, de leurs petits ridicules. Molière a probablement emprunté le thème de la coquette, démasquée par les quatre billets qu'elle a écrit à quatre prétendants, à Mlle de Scudéry et à son roman le Grand Cyrus, où on trouve cette situation, de même que la scène où l'amie de coquette la met en garde, de façon désintéressée et sincère. le thème de la jalousie, souvent intempestive, est un des grands sujets de Molière, le jaloux étant tourné en ridicule, selon les normes galantes de l'époque. de même le défilé des personnages indésirables qui empêchent le héros de parvenir à ses fins, c'est à dire à s'approcher de son aimée, est un thème récurrent, particulièrement développé dans Les fâcheux.
Mais l'affaire Tartuffe a aussi laissé des traces, suite à l'interdiction, Molière a proclamé que le but de la comédie était de corriger les vices des hommes, en les faisant rire. Il s'agissait donc aussi d'essayer de faire entrer la nouvelle pièce dans cette logique de la dénonciation des vices du temps.
Les personnages de la pièce de Molière ne sont pas sans évoquer la pièce de Desmarets de Saint-Sorlin : chaque personnage de pièce est obsédé par une idée fixe délirante, qui le coupe du reste du monde, fausse ses rapports aux autres. Ainsi Oronte s'imagine être un poète de talent, alors qu'il ne fait que copier de façon peu inspirée les procédés poétiques en vogue. Les deux petits marquis ont une idée exagérée de leur valeur, alors qu'ils sont falots et sans véritable personnalité. Arsinoé se donne des airs de prude et sage personne et veut qu'on la voit comme telle. Célimène s'imagine pouvoir attirer et séduire tous les hommes, leur adoration lui étant indispensable pour se sentir exister. Même Alceste, avec sa représentation négative de l'espèce humaine, qu'il fait tout pour voir confirmer (par exemple dans son procès) tourne quelque peu à la manie pathologique. Or la sociabilité était considérée à l'époque comme essentielle, l'inaptitude à vivre en société était vue comme un grave défaut pour le moins.
Mais Molière arrive, à partir d'éléments disparates et de thèmes courants à faire quelque chose de singulier, pouvant donner lieu à des interprétations et lectures multiples. Ses personnages font l'expérience de la confrontation à l'autre, qui permet de se définir, de voir apparaître ses limites, ses folies, ses fragilités. Même dans un monde dont le principe est la sociabilité, derrière la façade des relations policées se formulent des jugements impitoyables, des mises à mort symboliques. D'autant plus impitoyables que les relations de façade sont charmeuses. Alceste en quittant le jeu, signifie quelque part son échec : on ne peut exister avec l'autre dans une sincérité absolue et permanente. En même temps, que signifie dire la vérité ? Prétendre la posséder est un aussi une manifestation d'orgueil : à quel point est-t-on sûr de ne pas se tromper dans son jugement de l'autre, de ne pas partir sur une idée surestimée voire délirante de sa propre infaillibilité, de sa propre personne, comme les Visionnaires.
Tous sortent d'une certaine façon amoindris et blessés de cette expérience : les petit marquis qui ont pu lire des descriptions méchantes et justes de leurs petites personnes, Oronte qui a entendu d'amères critiques de ses vers et qui a compris que Célimène se jouait de lui, Arsinoé égratignée par Célimène et rejetée par Alceste, Célimène qui a perdu ses prétendants et dont le caractère faux et les persiflages cruels ont été mis en lumière, Alceste enfin éclairé sur son amour et voué à la solitude. Même les sages Eliante et Philinte, qui vont convoler dans un mariage raisonnable, apparaissent comme trop sages justement, sans grand risque de souffrir, mais sans grand espoir de connaître des sensations, des sentiments, des passions, qui les sortent d'eux-même, de leur douce torpeur confortable. Tout le monde est finalement renvoyé à lui-même et à sa finitude, quelle qu'elle soit.
Le Misanthrope ne peut certainement plus être compris des lectrices de Tatiana de Rosnay et des auditeurs d'Hanouna. Cependant, c'est un vrai bonheur à tous les niveaux pour tous les observateurs attentifs de la vie en société qui se font toutes les réflexions qui traversent cette pièce géniale dans les deux sens, réflexions amères, raisonnements de bon sens (pour s'adapter tout de même au vice, à la corruption, à la putasserie, à la vanité insupportable des imbéciles, à l'hypocrisie, aux emmerdeurs gluants, aux faiseurs de procès...) Peut-être cette pièce est-elle le viatique à recommander à tous les types valables qui souffrent de vivre dans une époque où le monde anciennement "civilisé" a sombré dans une médiocrité atroce évoquant en tout point un nouveau moyen âge. C'est un chef-d'oeuvre de philosophie pratique absolu qui permet - par un humour subtil (attention, pas Coluche!) - de supporter la détresse de la condition humaine. Bref, c'est Molière, quoi. le sommet du sommet.
Je crois que nous ne pouvons pas découvrir à notre époque le Misanthrope comme les contemporains de Molière et du roi Louis XIV. Cette pièce au XVII ème siècle était classée dans la catégorie des comédies, et il était de bon ton de se moquer d'un homme qui fuyait ses semblables et s'en défiait car il était "entier" hostile au paraître et à la flagornerie. Or, dans ce XVII ème siècle de la cour du Roi Soleil, il est de bon ton de flatter à tout va en public, quitte à critiquer et à être médisant dans un cercle plus restreint. Alceste, notre Misanthrope, n'est donc pas de son époque puisqu'il souhaite la franchise, et que cette façon de se comporter lui attire les pires ennuis. Je considère que cette pièce est une tragi-comédie, et ne vois pas du tout l'aspect comique qui s'en dégageait au XVII ème siècle et faisait d'Alceste un objet de moqueries. le malheur veut qu'Alceste soit épris de Célimène, qui est tout son contraire, une femme coquette, inconstante, médisante. Cette femme veut plaire, et joue de ses soupirants avec duplicité. Aucune sincérité dans ses actes! Elle reproduit en réalité ce qu'elle voit à la Cour, une population avide de reconnaissance qui gravite autour du monarque pour en tirer honneurs et bénéfices, courtisans dans toute leur âme, qui sont les marionnettes d'un puissant qui les affaiblit.
Alceste, lui, pour son malheur, n'est pas de son temps, et est raillé parce qu'il ne se prête pas à ce jeu, souhaitant au contraire se retirer loin du paraître et de la compromission.
Finalement chaque époque et chaque régime voit naître sa génération de courtisans, et si au XXI ème siècle ils sont moins nombreux que du temps de Louis XIV, ils sont encore bien présents. Nous en avons des exemples régulièrement aux actualités... Comédie? Tragédie? Coupons la poire en deux : tragi-comédie, comme dans le Misanthrope! Avec parfois pour certains d'entre-nous, le désir de s'éloigner de la société corrompue. Alceste, notre Misanthrope était alors un précurseur.
Une pièce qui a quitté son registre, mais qui n'a pas vieilli puis qu'elle dénonce encore bien des travers des hommes.
Alceste, lui, pour son malheur, n'est pas de son temps, et est raillé parce qu'il ne se prête pas à ce jeu, souhaitant au contraire se retirer loin du paraître et de la compromission.
Finalement chaque époque et chaque régime voit naître sa génération de courtisans, et si au XXI ème siècle ils sont moins nombreux que du temps de Louis XIV, ils sont encore bien présents. Nous en avons des exemples régulièrement aux actualités... Comédie? Tragédie? Coupons la poire en deux : tragi-comédie, comme dans le Misanthrope! Avec parfois pour certains d'entre-nous, le désir de s'éloigner de la société corrompue. Alceste, notre Misanthrope était alors un précurseur.
Une pièce qui a quitté son registre, mais qui n'a pas vieilli puis qu'elle dénonce encore bien des travers des hommes.
Bien évidemment 5/5 ! Qui suis-je pour "noter" Molière...
Cela étant, en lisant cette pièce qui m'avait été imposée à l'école quand j'avais une douzaine d'années - en la lisant "vraiment" cette fois - je comprends maintenant pourquoi, à l'époque, elle ne représentait rien de plus pour moi qu'un devoir à faire.
Aujourd'hui, j'ai choisi et apprécié de la lire mais il n'en reste pas moins que cela requiert un certain effort. Le vocabulaire et le phrasé du XVIIe siècle ne sont pas si aisément accessibles que certains le prétendent et j'avoue avoir dû faire appel à toute ma concentration pour en goûter tout le sel.
Mais cela n'a pas été fastidieux car chaque mot, chaque phrase, valaient bien que j'y consacre toute mon attention.
J'ai (enfin) lu Molière et il m'a épatée !
NB : Un petit échange m'a fait sourire par sa modernité de ton :
Du Bois : Je vous dis qu'il faut quitter ce lieu.
Alceste : La cause ?
Du Bois : Il faut partir, monsieur, sans dire adieu
Alceste : Mais par quelle raison me tiens-tu ce langage ?
Du Bois : Par la raison, monsieur, qu'il faut plier bagage.
Cela étant, en lisant cette pièce qui m'avait été imposée à l'école quand j'avais une douzaine d'années - en la lisant "vraiment" cette fois - je comprends maintenant pourquoi, à l'époque, elle ne représentait rien de plus pour moi qu'un devoir à faire.
Aujourd'hui, j'ai choisi et apprécié de la lire mais il n'en reste pas moins que cela requiert un certain effort. Le vocabulaire et le phrasé du XVIIe siècle ne sont pas si aisément accessibles que certains le prétendent et j'avoue avoir dû faire appel à toute ma concentration pour en goûter tout le sel.
Mais cela n'a pas été fastidieux car chaque mot, chaque phrase, valaient bien que j'y consacre toute mon attention.
J'ai (enfin) lu Molière et il m'a épatée !
NB : Un petit échange m'a fait sourire par sa modernité de ton :
Du Bois : Je vous dis qu'il faut quitter ce lieu.
Alceste : La cause ?
Du Bois : Il faut partir, monsieur, sans dire adieu
Alceste : Mais par quelle raison me tiens-tu ce langage ?
Du Bois : Par la raison, monsieur, qu'il faut plier bagage.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Molière (150)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Le misanthrope
Que pense Alceste de la nature humaine ?
Les gens sont fourbes et méchants.
Les gens sont sincères et aimables.
19 questions
66 lecteurs ont répondu
Thème : Le Misanthrope de
MolièreCréer un quiz sur ce livre66 lecteurs ont répondu