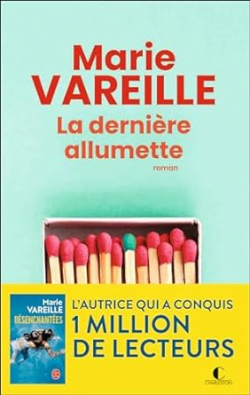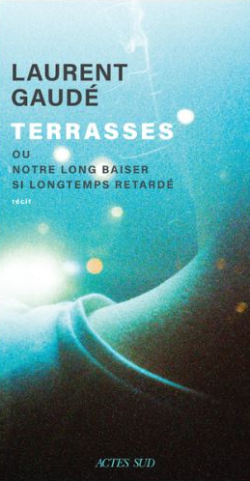Jean Malaquais/5
32 notes
Résumé :
Nous sommes quelque part en Provence, dans les années 30. Non point la Provence de Pagnol, mais celle des vieilles mines d’argent et de plomb où trime une faune rien moins que recommandable. La mer n’est pas loin, le soleil plutôt bon zigue. Quant aux mines, disons qu’elles sont tellement pourries que les ouvriers français refusent d’y descendre – alors on fait appel au bon vouloir des tordus de passage qui n’ont pas peur de s’y frotter. Ils ont tous quelques points... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Les JavanaisVoir plus
Critiques, Analyses et Avis (5)
Ajouter une critique
Ca commence dans la Pologne enneigée, où deux vagabonds repus de soupe populaire rêvent de pays chauds, de voyages et de Java. Java, justement, c'est "une île cachée au fond des bois", du côté de notre Côte d'Azur nationale. Un bidonville où cohabitent Espingouins, Ritals, Chleuhs, Rouskis, Polaks, Turcos, Arméniens, Norafs etc., et même un Nègre de la libre Amérique et un Frantsousse, et tous travaillent dans la mine d'argent dirigée par un Angliche, et partagent leur dimanche entre l'épicerie-vins de Madame Michel et le bordel d'Estève.
Dans ce récit publié en 1939, Jean Malaquais (né Jan Malacki à Varsovie) chronique le quotidien de cette communauté de Javanais, "des races sans papiers ni rien", mais avec des rêves et des idées plein la tête, du talent plein les mains, et du courage plein les tripes. Ce faisant, il rend hommage aux déracinés qui, sans attaches, ne peuvent qu'avancer, au gré de leurs espoirs, leurs révoltes, leurs défaites. Et s'il souligne leur sens de la solidarité, il pointe également leurs travers.
Cela m'a permis de (re-)découvrir le melting-pot qu'était la France de l'entre-deux-guerres. Il y avait de quoi s'en enorgueillir, même si les métèques n'étaient pas toujours bien perçus, et même si la Préfecture -déjà, et même si les cognes -déjà aussi.
J'ai beaucoup aimé le savoureux sabir franco-international pratiqué par ces Javanais, et la façon dont l'auteur malaxe la langue française, qu'elle soit pure ou argotique, pour la déchirer, l'exploser et la reconstruire de façon effrontée, vivifiante, et surtout magistrale. Quel pied !
Et bien que j'aie d'abord eu un peu de mal à m'adapter à cette Ile de Java, je n'avais plus envie de la quitter à la fin, et c'est le coeur égratigné et les larmes aux yeux que j'ai refermé ce livre. La faute à sa douceur, sa drôlerie, sa mélancolie, son exubérance, et sa dignité. Et aussi parce qu'il m'a fait penser à mon grand-père qui lui aussi, à Cracovie, faisait la queue à la soupe populaire en rêvant d'une autre vie, avant de s'en aller manger le pain des Français. Grâce à lui, je me sens un peu javanaise.
Un grand merci à Croquignol qui, avec son beau billet, m'a donné envie de découvrir ce roman. Et je reprends en écho ses propos : "Mais qu'est-ce que vous foutez, les gars ? On peut pas laisser un tel brûlot prendre la poussière sur une étagère !"
Oh oui !, il est temps de redonner à ce livre le lustre qu'il mérite.
Dans ce récit publié en 1939, Jean Malaquais (né Jan Malacki à Varsovie) chronique le quotidien de cette communauté de Javanais, "des races sans papiers ni rien", mais avec des rêves et des idées plein la tête, du talent plein les mains, et du courage plein les tripes. Ce faisant, il rend hommage aux déracinés qui, sans attaches, ne peuvent qu'avancer, au gré de leurs espoirs, leurs révoltes, leurs défaites. Et s'il souligne leur sens de la solidarité, il pointe également leurs travers.
Cela m'a permis de (re-)découvrir le melting-pot qu'était la France de l'entre-deux-guerres. Il y avait de quoi s'en enorgueillir, même si les métèques n'étaient pas toujours bien perçus, et même si la Préfecture -déjà, et même si les cognes -déjà aussi.
J'ai beaucoup aimé le savoureux sabir franco-international pratiqué par ces Javanais, et la façon dont l'auteur malaxe la langue française, qu'elle soit pure ou argotique, pour la déchirer, l'exploser et la reconstruire de façon effrontée, vivifiante, et surtout magistrale. Quel pied !
Et bien que j'aie d'abord eu un peu de mal à m'adapter à cette Ile de Java, je n'avais plus envie de la quitter à la fin, et c'est le coeur égratigné et les larmes aux yeux que j'ai refermé ce livre. La faute à sa douceur, sa drôlerie, sa mélancolie, son exubérance, et sa dignité. Et aussi parce qu'il m'a fait penser à mon grand-père qui lui aussi, à Cracovie, faisait la queue à la soupe populaire en rêvant d'une autre vie, avant de s'en aller manger le pain des Français. Grâce à lui, je me sens un peu javanaise.
Un grand merci à Croquignol qui, avec son beau billet, m'a donné envie de découvrir ce roman. Et je reprends en écho ses propos : "Mais qu'est-ce que vous foutez, les gars ? On peut pas laisser un tel brûlot prendre la poussière sur une étagère !"
Oh oui !, il est temps de redonner à ce livre le lustre qu'il mérite.
La vie continue malgré la misère.
Des baraques en bois coincées entre la mer et une voie ferrée, peuplées de femmes, d'enfants et surtout d'hommes, des étrangers.
Un train qui ralentit à peine, la course pour l'attraper et aller travailler à la mine. La mine : pourrie la mine, pas un français pour y descendre, trop dangereux. Il pourrait y avoir un accident, d'ailleurs il y en a un, un petit, deux morts, des étrangers, des qu'on ne connaissait même pas, alors on s'en fout, ce n'est pas grave.
Pour les Javanais, ceux qui vivent sur l'île de Java, joli nom donné au camp de baraques, le dimanche, c'est jour de repos. C'est aussi jour d'ennui, de cafard, on repense au pays, à la famille. Alors pour tuer le temps, il y a la buvette-épicerie de Mme Michel. Ce n'est pas qu'elle ne les aime pas ses étrangers, Madame Michel mais de là à leur faire crédit, vous comprenez avec ceux-ci, un jour ici, un jour là-bas et puis on ne comprend rien à ce qu'ils disent, ces javanais.
Il y a aussi le bordel pour tromper l'ennui et s'épancher de tous ses malheurs avec des filles toujours à l'écoute.
C'est un portrait très vivant et humain que nous dresse Jean Malaquais, un portrait de la vie quotidienne au sein de deux communautés qui se côtoient sans se mélanger. Un récit, dans une langue très fleurie, qui nous raconte une certaine misère, pas seulement sociale mais aussi psychologique face à l'indifférence, l'intolérance, le racisme ordinaire.
L'écriture est savoureuse, très vivante et le parfait reflet de la région décrite ici, véritable Babel en Provence. J'ai du relire certaines phrases bien des fois pour être bien sûr d'avoir compris, et tel ne fut pas toujours le cas.
Cette écriture singulière fait l'objet des louanges de beaucoup de membres Babelio et même d'illustres contemporains de ce prix Renaudot 1939, comme Gide par exemple. Moi, c'est exactement ce qui m'a un peu laissé au bord de l'île Java. Ma nature classique pourtant effritée avec le temps et des lectures éclectiques, a gardé trop de vernis que pour apprécier pleinement ce roman social.
J'aime pourtant Celine, et même Rabelais a qui on compare Malaquais. Ces comparaisons me paraissent un peu flatteuses. Histoire de goût, comme toujours!
Cette écriture singulière fait l'objet des louanges de beaucoup de membres Babelio et même d'illustres contemporains de ce prix Renaudot 1939, comme Gide par exemple. Moi, c'est exactement ce qui m'a un peu laissé au bord de l'île Java. Ma nature classique pourtant effritée avec le temps et des lectures éclectiques, a gardé trop de vernis que pour apprécier pleinement ce roman social.
J'aime pourtant Celine, et même Rabelais a qui on compare Malaquais. Ces comparaisons me paraissent un peu flatteuses. Histoire de goût, comme toujours!
Java, c'est une espèce de campement où s'est regroupée tout une communauté d'hommes et de familles immigrées, des étrangers sans statut social, fuyant leur misère ou leurs oppresseurs respectifs, chacun baragouinant son jargon approximatif. A côté de Java, il y a la mine, qui éreinte et nourrit vaguement son homme, il y a le village de Vaugelas, où il fait bon boire un coup - ou plusieurs - ou tirer un coup au bordel de M Estève. Ils sont acceptés "ces gens-là" tant qu'ils travaillent et ne bousculent pas, acceptant des tâches et conditions que nul autre ne subirait. Puis viendra le temps de les jeter, M le Directeur, Monsieur le gendarme, M l'adjoint au maire sont là pour protéger les honnêtes gens..
Jean Malaquais dresse un puissant portrait naturaliste de ce ghetto où les hommes vivent en cercle fermé, grandes amitiés, petites bassesses, quotidien où l'on pêche obstinément les moments consolateurs pour tenir. Il distribue son attachement respectueux pour ces êtres déboussolés et sa dérision délicieusement vachard contre les petits et moyens chefs.
Ce qui donne sa grande singularité au récit, c'est une prose d'une richesse, d'une fantaisie, d'une créativité époustouflantes. C'est ciselé, pétillant d'intelligence et d'invention, entre humour et poésie. il y a bien certains moments où cette fécondité passe à la démesure, déborde, déstabilise et fait vaciller la lectrice ("Non mais qu'est-ce qu'il raconte, là, faconde ou divagation?). Il n'en demeure pas moins que c'est brillant, brillantissime.
Jean Malaquais dresse un puissant portrait naturaliste de ce ghetto où les hommes vivent en cercle fermé, grandes amitiés, petites bassesses, quotidien où l'on pêche obstinément les moments consolateurs pour tenir. Il distribue son attachement respectueux pour ces êtres déboussolés et sa dérision délicieusement vachard contre les petits et moyens chefs.
Ce qui donne sa grande singularité au récit, c'est une prose d'une richesse, d'une fantaisie, d'une créativité époustouflantes. C'est ciselé, pétillant d'intelligence et d'invention, entre humour et poésie. il y a bien certains moments où cette fécondité passe à la démesure, déborde, déstabilise et fait vaciller la lectrice ("Non mais qu'est-ce qu'il raconte, là, faconde ou divagation?). Il n'en demeure pas moins que c'est brillant, brillantissime.
Un récit qui nous ramène au début du siècle dernier quand la France était accueillante et civilisatrice drainant de ce fait toute la misère de l'Europe , tous les pauvres hères en recherche d'un monde meilleur dont nous sommes les héritiers.
N'allant pas jusqu'à offrir généreusement gîte et couvert elle donne à chacun un petite chance d'émerger, de se maintenir à flot. Malaquais immigré lui-même nous fait le récit d'un bidonville minier dans le sud de la France une terra incognita du français moyen peuplée de polacks d'arméniens d'allemand, d' autrichiens, de Ruscofs, d'angliches et d'autres plus ou moins identifiés et de gendarmes de passage le tout cimenté par la boisson et une langue fran...quelque chose, sans parler du charbon qu'il faut aller chercher par des moyens rudimentaires au fond de la mine et sans non plus oublier les indispensables dames (aux nénés nous dit Malaquais) du lupanar pas vraiment « le Chabanais » mais correct et propre.
Selon certains Malaquais a quelque chose de Céline et de Rabelais . En cherchant bien on peut trouver une certaine truculence rabelaisienne dans les expressions mais le style évoque plutôt un mélange de langage populaire ouvrier, d'argot et inévitablement de javanais au sens de “charabia” langage simplifie au départ parlé par les Africains du nord sur lequel vient se greffer les langages des pays de l'est sans parler du yiddish : une sorte de brouet de langages. Pas grand-chose à voir avec Céline au style plus délié et surtout provocateur ni Rabelais.
Ce langage de Malaquais d'autre part est riche de connaissances de lettré et cette juxtaposition avec le langage basique des immigrants est un peu artificielle. On sent une construction très intellectuelle qui ne cadre pas bien avec le milieu décrit. La comparaison avec le style plus dru d'Alphonse Boudard aurait été plus judicieuse.
En fait ce texte a plutôt mal vieilli et on a eu du mal à suivre l'histoire qui n'est pas inintéressante mais reste très factice. On a du mal à croire qu'il a vécu cela car c'est une vision très extérieure une sorte de récit pour la petite histoire pour dire « j'y était » Prix Renaudot 1939 quand même
N'allant pas jusqu'à offrir généreusement gîte et couvert elle donne à chacun un petite chance d'émerger, de se maintenir à flot. Malaquais immigré lui-même nous fait le récit d'un bidonville minier dans le sud de la France une terra incognita du français moyen peuplée de polacks d'arméniens d'allemand, d' autrichiens, de Ruscofs, d'angliches et d'autres plus ou moins identifiés et de gendarmes de passage le tout cimenté par la boisson et une langue fran...quelque chose, sans parler du charbon qu'il faut aller chercher par des moyens rudimentaires au fond de la mine et sans non plus oublier les indispensables dames (aux nénés nous dit Malaquais) du lupanar pas vraiment « le Chabanais » mais correct et propre.
Selon certains Malaquais a quelque chose de Céline et de Rabelais . En cherchant bien on peut trouver une certaine truculence rabelaisienne dans les expressions mais le style évoque plutôt un mélange de langage populaire ouvrier, d'argot et inévitablement de javanais au sens de “charabia” langage simplifie au départ parlé par les Africains du nord sur lequel vient se greffer les langages des pays de l'est sans parler du yiddish : une sorte de brouet de langages. Pas grand-chose à voir avec Céline au style plus délié et surtout provocateur ni Rabelais.
Ce langage de Malaquais d'autre part est riche de connaissances de lettré et cette juxtaposition avec le langage basique des immigrants est un peu artificielle. On sent une construction très intellectuelle qui ne cadre pas bien avec le milieu décrit. La comparaison avec le style plus dru d'Alphonse Boudard aurait été plus judicieuse.
En fait ce texte a plutôt mal vieilli et on a eu du mal à suivre l'histoire qui n'est pas inintéressante mais reste très factice. On a du mal à croire qu'il a vécu cela car c'est une vision très extérieure une sorte de récit pour la petite histoire pour dire « j'y était » Prix Renaudot 1939 quand même
Citations et extraits (4)
Ajouter une citation
C'est arrivé tout bêtement, sans indices avant-coureurs, ou alors un déclic inaudible dans le fracas des foreuses. Toujours est-il que le plafond a dévissé, qu'il s'est affaissé d'une pièce, les gobant sec, le barbu et l'arbi et leurs outil et leurs quinquets et leurs casse-croûte de haut goût.
Une avalanche de pierraille s'ensuivit, de moraine, de caillasse menue, puis un filet d'eau gargouilla placidement la prière des morts.
Une avalanche de pierraille s'ensuivit, de moraine, de caillasse menue, puis un filet d'eau gargouilla placidement la prière des morts.
Ritals, Ruthènes, Bulgares, Turcos, allez, tous des norafs pas de chez nous.
D'accord, sont nés d'une femme eux aussi, faut bien, mais au bord de la route comme qui dirait, d'où que c'est des races sans papiers ni rien.
D'accord, sont nés d'une femme eux aussi, faut bien, mais au bord de la route comme qui dirait, d'où que c'est des races sans papiers ni rien.
Estève soignait sa calvitie de futur conseiller municipal. Quand on a le crin qui vous pousse à l'envers, long à la base et bref au sommet du caillou, il y faut un tour de main accompli.
Indolentes, d'humeur matinale, des vaguelettes humectaient le sable à ses pieds. Il écoutait la mer, le très ancien récit de la mer, chaque vague sa voix unique, infiniment juste, celle-là précisément qu'il espérait, qu'il avait besoin d'espérer.
autres livres classés : prix renaudotVoir plus
Les plus populaires : Littérature française
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Jean Malaquais (6)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3231 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3231 lecteurs ont répondu