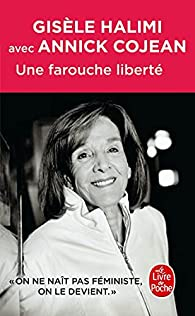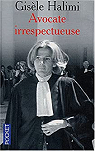Critiques filtrées sur 1 étoiles
Il est toujours étrange que sous le signe de l'égalité l'on sacralise par victimisation la condition féminine pour accabler systématiquement la condition masculine, créant d'emblée une scission et une rivalité entre les deux sexes. C'est ce double discours qui est problématique dans le féminisme. On ne trouvera dans cet essai aucune critique envers les femmes, pas la moindre, pas la plus petite trace.
Il faut rappeler que nous ne sommes pas en France, mais en Tunisie. Gisèle Halimi importe donc dans son pays des valeurs qui y sont étrangères. Soit. Elle en veut à son père et à la société patriarcale d'avoir méprisé les femmes. Les hommes dirigeaient, décidaient, nourrissaient, travaillaient comme des fous et devaient marier leurs filles et payer leur dot. Les femmes ne gagnaient pas leur vie. Sans doute que le travailleur forcené n'est victime de rien quand il s'agit d'apporter des ressources à sa famille. Et la ruse est que si les féministes veulent travailler comme un homme, à qui vont-elles donner cet argent ? A-t-on vu des femmes entretenir des hommes pauvres en si grand nombre que ces derniers ?
On voit bien que l'intérêt n'est pas envers les femmes mais de quelques femmes bourgeoises qui se servent des moins nanties pour parvenir au pouvoir. Car il faut se poser une question : quelle femme a intérêt à travailler d'arrache-pied autant qu'un homme, à s'user au travail et pour qui ? Dans quel but ? Pour quel type de société ?
Un autre point troublant est la frénésie imitative des femmes envers les hommes, de les copier et de rivaliser avec eux seulement dans certains domaines, les plus nobles. « J'étudierais, je travaillerais, j'agirais comme un homme » écrit-elle. En fait, l'ambition de Gisèle Halimi est le pouvoir, c'est-à-dire que certaines femmes fassent comme les hommes. Enfin, certains hommes. le patriarcat pour elle, c'est de croire que tous les hommes dominent et que toutes les femmes sont dominées. Et quand elle revendique que les femmes sont égales à l'homme, c'est surtout dans les bons métiers gratifiants : « Elles peuvent construire des viaducs, diriger une centrale nucléaire, piloter un avion de chasse, présider une cour d'assises, administrer une banque ou un pays. Et pourtant… »
Gisèle Halimi ne revendique pas la parité dans les pires métiers qu'elle laisse aux hommes. Sa volonté ne vise que les sphères du pouvoir.
Elle opère une sorte de synecdoque idéologique en prenant la partie pour le tout, oubliant que les hommes sont tout autant dominés, éliminant les rapports entre les classes sociales. Est-ce qu'une avocate est dominée par un vendeur de pizza ? On se demande bien pourquoi on devrait s'apitoyer sur la condition féminine (viol, violence, esclavage, etc.) en omettant comme de bien entendu la condition masculine (guerres, massacres) qui, rappelons-le, subit bien plus (79%) de violences et crimes de la part d'autres hommes que les femmes dans le monde (16%). Comme quoi, faire une telle dichotomie est absolument vain. Tout cela est tellement grossier et facilement réfutable que l'on se demande comment peut-on se laisser prendre au piège d'une telle dichotomie ?
Le plus comique est que Gisèle Halimi adopte les codes de la « femme soumise » quand cela l'arrange. Quand elle reçoit des amis (Sartre et De Beauvoir) à la maison : « Ils venaient souvent dîner à la maison. Claude allait faire le marché – il était toujours en quête du « meilleur » produit – et moi, je préparais un bon tajine ou un couscous. Attention : cela n'était en rien une régression de ma condition de femme. J'étais à la cuisine parce que j'avais choisi de l'être. C'était un plaisir que je m'accordais. » Voilà quand des femmes choisissent d'être à la cuisine ou de s'occuper de la maison, c'est de l'endoctrinement et de la soumission à l'ordre patriarcal, sauf pour Gisèle Halimi : là c'est de la liberté. Un plaisir.
Sa tolérance est sans limite. Quand elle fonde son association Choisir, elle écrit : « Au début, nous avions accepté la présence d'hommes. Mais c'était une erreur. Certaines femmes s'autocensuraient, craignant leur jugement, leur incompréhension, leur ignorance de nos maux de femmes. Après tout, on parlait de nos ventres. Que pouvaient-ils savoir ? » On admire son altérité : exclure outre que l'homme doit sans cesse comprendre la femme, mais la réciprocité n'est pas de mise. Et bien sûr, l'homme ne peut être admis que lorsqu'il est dans le bon combat. Son mari, lui, la comprenait, totalement acquis à sa cause, et dans sa grande bonté, elle écrit : « Je n'aurais d'ailleurs jamais pu vivre avec un homme qui n'aurait pas compris la cause des femmes. C'eût été impossible. »
D'autres pans entiers sont étrangement oubliés. Quand elle évoque son amitié avec Simone de Beauvoir, elle oublie de mentionner que cette dernière en tant que professeur sortait avec ses élèves dont Nathalie Sorokine, Olga Kosakiewicz ou Bianca Bienenfeld. Cette dernière à la mort de De Beauvoir publiera un livre Mémoires d'une jeune fille dérangée où elle décrit comment Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ont abusé d'elle à l'âge de seize ans. Elle écrit : « J'ai découvert que Simone de Beauvoir puisait dans ses classes de jeunes filles une chair fraîche à laquelle elle goûtait avant de la refiler, ou faut-il dire plus grossièrement encore, de la rabattre sur Sartre. » De Beauvoir ne s'est donc pas gênée de collaborer avec les nazis et de se faire embaucher à la radio de Vichy du gouvernement collaborationniste de Pétain. Elle soutint même la pédocriminalité avec Sartre dans les années 70.
Gisèle Halimi continue dérouler de totales inexactitudes concernant le travail des femmes : « Sachez qu'à la première crise économique, c'est le travail des femmes qui est toujours remis en cause. Ce sont elles, les premières victimes du chômage. Elles, les plus mal payées et le plus gros contingent (deux tiers) des smicards. Elles, à qui l'on propose en priorité le temps partiel, abusivement appelé « temps choisi » alors qu'il n'est un choix que pour une infime minorité d'entre elles. » Or, quand on consulte les chiffres, elle se trompe. « Au dernier trimestre 2018, selon l'Insee et les concepts du BIT (Bureau international du travail), le taux de chômage des femmes est de 8,7 % et celui des hommes de 8,9 % » apprend-on. Et même sur une plus longue durée . Elle falsifie les faits pour perpétuer un mythe, une représentation simpliste pour immuniser son militantisme. Et quand elle évoque le temps partiel, c'est encore faux, car la majorité des femmes prennent un travail à mi-temps car elles préfèrent (encore) avoir des enfants et les élever. Chose oubliée dans les calculs des prétendus écarts de salaire. Mais sans doute qu'il n'y a aucun choix ici, aucune liberté.
Justement, la question de l'enfant. Voilà l'infamie ! Elle écrit : « À cela, j'ajoute : refusez l'injonction millénaire de faire à tout prix des enfants. Elle est insupportable et réduit les femmes à un ventre. Dépossédées de tout pouvoir, elles n'ont longtemps eu droit qu'à ce destin : perpétuer l'humanité. » Sauf qu'il faudrait rappeler à Gisèle Halimi que seules les femmes perpétuent l'espèce.
Tout est toujours vu sous l'angle culturel sans jamais de s'interroger sur une quelconque pertinence : « La « mère » était souveraine. La littérature, les conventions sociales, la publicité, les lois en ont créé un stéréotype, que l'on met sur un piédestal, auréolé de son abnégation et de son oubli d'elle-même. » le tout d'un seul bloc sans aucune nuance.
Pour elle, « la maternité ne doit pas être l'unique horizon. Et que l'instinct maternel est un immense bobard à jeter aux poubelles de l'Histoire. Je n'y ai jamais cru. » Mais elle ne s'est pas empêchée d'en faire trois ! On se demande donc pourquoi n'a-t-elle pas renoncé ? Et de proclamer : « La maternité n'est ni un devoir ni l'unique moyen d'accomplissement d'une femme. Elle mérite réflexion, considération, sans aucune autocensure : pourquoi faire un enfant ? Sauver le monde ? Se reproduire ? Laisser une trace ? Ce doit être une décision prise en liberté, et en responsabilité, hors pressions bibliques ou conditionnement social. Un engagement réfléchi et lucide. » Bien sûr quand Gisèle Halimi fait trois enfants ou fait la cuisine, c'est de la responsabilité et de la liberté, mais quand ce sont les autres, c'est du conditionnement social. On se demande donc quand la chose est liberté d'un côté et une intolérable contrainte dans l'autre, comme si la culture ou la socialité étaient à géométrie variable selon l'idéologie à défendre.
On se dit que ces féministes ne cessent de réclamer l'égalité pour la bafouer quand il s'agit de penser à la condition masculine, de la revendiquer pour les meilleures places, et aussi de pratiquer une double pensée habituelle. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais.
Rien de nouveau sous le soleil en quelque sorte.
Il faut rappeler que nous ne sommes pas en France, mais en Tunisie. Gisèle Halimi importe donc dans son pays des valeurs qui y sont étrangères. Soit. Elle en veut à son père et à la société patriarcale d'avoir méprisé les femmes. Les hommes dirigeaient, décidaient, nourrissaient, travaillaient comme des fous et devaient marier leurs filles et payer leur dot. Les femmes ne gagnaient pas leur vie. Sans doute que le travailleur forcené n'est victime de rien quand il s'agit d'apporter des ressources à sa famille. Et la ruse est que si les féministes veulent travailler comme un homme, à qui vont-elles donner cet argent ? A-t-on vu des femmes entretenir des hommes pauvres en si grand nombre que ces derniers ?
On voit bien que l'intérêt n'est pas envers les femmes mais de quelques femmes bourgeoises qui se servent des moins nanties pour parvenir au pouvoir. Car il faut se poser une question : quelle femme a intérêt à travailler d'arrache-pied autant qu'un homme, à s'user au travail et pour qui ? Dans quel but ? Pour quel type de société ?
Un autre point troublant est la frénésie imitative des femmes envers les hommes, de les copier et de rivaliser avec eux seulement dans certains domaines, les plus nobles. « J'étudierais, je travaillerais, j'agirais comme un homme » écrit-elle. En fait, l'ambition de Gisèle Halimi est le pouvoir, c'est-à-dire que certaines femmes fassent comme les hommes. Enfin, certains hommes. le patriarcat pour elle, c'est de croire que tous les hommes dominent et que toutes les femmes sont dominées. Et quand elle revendique que les femmes sont égales à l'homme, c'est surtout dans les bons métiers gratifiants : « Elles peuvent construire des viaducs, diriger une centrale nucléaire, piloter un avion de chasse, présider une cour d'assises, administrer une banque ou un pays. Et pourtant… »
Gisèle Halimi ne revendique pas la parité dans les pires métiers qu'elle laisse aux hommes. Sa volonté ne vise que les sphères du pouvoir.
Elle opère une sorte de synecdoque idéologique en prenant la partie pour le tout, oubliant que les hommes sont tout autant dominés, éliminant les rapports entre les classes sociales. Est-ce qu'une avocate est dominée par un vendeur de pizza ? On se demande bien pourquoi on devrait s'apitoyer sur la condition féminine (viol, violence, esclavage, etc.) en omettant comme de bien entendu la condition masculine (guerres, massacres) qui, rappelons-le, subit bien plus (79%) de violences et crimes de la part d'autres hommes que les femmes dans le monde (16%). Comme quoi, faire une telle dichotomie est absolument vain. Tout cela est tellement grossier et facilement réfutable que l'on se demande comment peut-on se laisser prendre au piège d'une telle dichotomie ?
Le plus comique est que Gisèle Halimi adopte les codes de la « femme soumise » quand cela l'arrange. Quand elle reçoit des amis (Sartre et De Beauvoir) à la maison : « Ils venaient souvent dîner à la maison. Claude allait faire le marché – il était toujours en quête du « meilleur » produit – et moi, je préparais un bon tajine ou un couscous. Attention : cela n'était en rien une régression de ma condition de femme. J'étais à la cuisine parce que j'avais choisi de l'être. C'était un plaisir que je m'accordais. » Voilà quand des femmes choisissent d'être à la cuisine ou de s'occuper de la maison, c'est de l'endoctrinement et de la soumission à l'ordre patriarcal, sauf pour Gisèle Halimi : là c'est de la liberté. Un plaisir.
Sa tolérance est sans limite. Quand elle fonde son association Choisir, elle écrit : « Au début, nous avions accepté la présence d'hommes. Mais c'était une erreur. Certaines femmes s'autocensuraient, craignant leur jugement, leur incompréhension, leur ignorance de nos maux de femmes. Après tout, on parlait de nos ventres. Que pouvaient-ils savoir ? » On admire son altérité : exclure outre que l'homme doit sans cesse comprendre la femme, mais la réciprocité n'est pas de mise. Et bien sûr, l'homme ne peut être admis que lorsqu'il est dans le bon combat. Son mari, lui, la comprenait, totalement acquis à sa cause, et dans sa grande bonté, elle écrit : « Je n'aurais d'ailleurs jamais pu vivre avec un homme qui n'aurait pas compris la cause des femmes. C'eût été impossible. »
D'autres pans entiers sont étrangement oubliés. Quand elle évoque son amitié avec Simone de Beauvoir, elle oublie de mentionner que cette dernière en tant que professeur sortait avec ses élèves dont Nathalie Sorokine, Olga Kosakiewicz ou Bianca Bienenfeld. Cette dernière à la mort de De Beauvoir publiera un livre Mémoires d'une jeune fille dérangée où elle décrit comment Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ont abusé d'elle à l'âge de seize ans. Elle écrit : « J'ai découvert que Simone de Beauvoir puisait dans ses classes de jeunes filles une chair fraîche à laquelle elle goûtait avant de la refiler, ou faut-il dire plus grossièrement encore, de la rabattre sur Sartre. » De Beauvoir ne s'est donc pas gênée de collaborer avec les nazis et de se faire embaucher à la radio de Vichy du gouvernement collaborationniste de Pétain. Elle soutint même la pédocriminalité avec Sartre dans les années 70.
Gisèle Halimi continue dérouler de totales inexactitudes concernant le travail des femmes : « Sachez qu'à la première crise économique, c'est le travail des femmes qui est toujours remis en cause. Ce sont elles, les premières victimes du chômage. Elles, les plus mal payées et le plus gros contingent (deux tiers) des smicards. Elles, à qui l'on propose en priorité le temps partiel, abusivement appelé « temps choisi » alors qu'il n'est un choix que pour une infime minorité d'entre elles. » Or, quand on consulte les chiffres, elle se trompe. « Au dernier trimestre 2018, selon l'Insee et les concepts du BIT (Bureau international du travail), le taux de chômage des femmes est de 8,7 % et celui des hommes de 8,9 % » apprend-on. Et même sur une plus longue durée . Elle falsifie les faits pour perpétuer un mythe, une représentation simpliste pour immuniser son militantisme. Et quand elle évoque le temps partiel, c'est encore faux, car la majorité des femmes prennent un travail à mi-temps car elles préfèrent (encore) avoir des enfants et les élever. Chose oubliée dans les calculs des prétendus écarts de salaire. Mais sans doute qu'il n'y a aucun choix ici, aucune liberté.
Justement, la question de l'enfant. Voilà l'infamie ! Elle écrit : « À cela, j'ajoute : refusez l'injonction millénaire de faire à tout prix des enfants. Elle est insupportable et réduit les femmes à un ventre. Dépossédées de tout pouvoir, elles n'ont longtemps eu droit qu'à ce destin : perpétuer l'humanité. » Sauf qu'il faudrait rappeler à Gisèle Halimi que seules les femmes perpétuent l'espèce.
Tout est toujours vu sous l'angle culturel sans jamais de s'interroger sur une quelconque pertinence : « La « mère » était souveraine. La littérature, les conventions sociales, la publicité, les lois en ont créé un stéréotype, que l'on met sur un piédestal, auréolé de son abnégation et de son oubli d'elle-même. » le tout d'un seul bloc sans aucune nuance.
Pour elle, « la maternité ne doit pas être l'unique horizon. Et que l'instinct maternel est un immense bobard à jeter aux poubelles de l'Histoire. Je n'y ai jamais cru. » Mais elle ne s'est pas empêchée d'en faire trois ! On se demande donc pourquoi n'a-t-elle pas renoncé ? Et de proclamer : « La maternité n'est ni un devoir ni l'unique moyen d'accomplissement d'une femme. Elle mérite réflexion, considération, sans aucune autocensure : pourquoi faire un enfant ? Sauver le monde ? Se reproduire ? Laisser une trace ? Ce doit être une décision prise en liberté, et en responsabilité, hors pressions bibliques ou conditionnement social. Un engagement réfléchi et lucide. » Bien sûr quand Gisèle Halimi fait trois enfants ou fait la cuisine, c'est de la responsabilité et de la liberté, mais quand ce sont les autres, c'est du conditionnement social. On se demande donc quand la chose est liberté d'un côté et une intolérable contrainte dans l'autre, comme si la culture ou la socialité étaient à géométrie variable selon l'idéologie à défendre.
On se dit que ces féministes ne cessent de réclamer l'égalité pour la bafouer quand il s'agit de penser à la condition masculine, de la revendiquer pour les meilleures places, et aussi de pratiquer une double pensée habituelle. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais.
Rien de nouveau sous le soleil en quelque sorte.
Les Dernières Actualités
Voir plus

Les romans les mieux notés
heros_pitch
195 livres

Se battre comme une femme
PrettyYoungCat
100 livres

La Grande Librairie 2020-2021
Laurie777
124 livres
Autres livres de Gisèle Halimi (17)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1745 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1745 lecteurs ont répondu