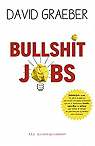Olivier CyranJulien Brygo
Note moyenne : /5 (sur 0 notes)
Note moyenne : /5 (sur 0 notes)
Résumé :
Pas un jour sans que vous entendiez quelqu’un soupirer : je fais un boulot de merde. Pas un jour peut-être sans que vous le pensiez vous-même. Ces boulots-là sont partout, dans nos emplois abrutissants ou dépourvus de sens, dans notre servitude et notre isolement, dans nos fiches de paie squelettiques et nos fins de mois embourbées. Ils se propagent à l’ensemble du monde du travail, nourris par la dégradation des métiers socialement utiles comme par la survalorisati... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Que lire après Boulots de merde !Voir plus
Critiques, Analyses et Avis (9)
Voir plus
Ajouter une critique
Qu'est-ce qu' un « boulot de merde » ? La définition est à la fois équivoque et multiple, et ne saurait en tout cas tenir compte de la perception subjective que le travailleur en souffrance a de son labeur – définition psychologisante. Disons que la définition retenue dans cette enquête se décline en trois volets complémentaires, afin d'une inclusivité maximale et malgré qu'elle soit éventuellement contestable par vice d'idéologie.
1. « Certains critères sautent aux yeux : la rémunération rachitique, la précarité, les contrats dégradés ou inexistants, la dureté de la tâche, l'isolement, l'entrave aux droits syndicaux, les discriminations (en fonction notamment du sexe, de la religion ou de la couleur de peau), le despotisme patronal ou managérial, le non-respect de la dignité humaine. Ces attributs forment en quelque sorte le noyau des boulots de merde, selon la manière dont ils s'additionnent et se combinent. » (p. 11). Notons que l'ensemble du texte révélera que la « merditude » de ces métiers s'avère être surtout un caractère dynamique, lié à la dégradation des conditions de travail, souvent assez récente ou accélérée, et non nécessairement intrinsèque à la profession.
2. La notion introduite par l'anthropologue américain David Graeber (2013) de « bullshit job », qui renferme les professions aliénantes, dépourvues de sens pour celui ou celle qui les exerce, lui provoquant un surcroît d'ennui, quel que soit son niveau de rémunération et sa position dans la pyramide sociale et salariale. Lorsque la presse française a eu un éphémère engouement pour ce phénomène (avril-mai 2016), elle l'a désigné de « jobs à la con » ; contrairement aux auteurs, j'estime que, bien qu'il y ait de la « merde » dans « bullshit », cette traduction était meilleure pour désigner le concept en question, et qu'il ne s'agissait pas d'un euphémisme. Donc, on dira que les « jobs à la con », souvent des pensums de cadres dépressifs [perso, je ne peux m'empêcher de songer à fonctionnaire de la Commission européenne (en plus, chez les Anglais, il va y avoir un sacré plan social !)...], constituent un sous-ensemble des « boulots de merde » ; je souscris entièrement à cette inclusion.
3. le regretté philosophe André Gorz, tellement novateur à plusieurs égards, a été le premier à se pencher sur l'utilité, inutilité et surtout l'éventuelle nocivité sociale du travail. (Pour des ex. de cette dernière, cf. les marchants d'armes et les experts en « optimisation fiscale »...). En 2009, les chercheuses britanniques Eilis Lawlor, Helen Kersley et Susan Steed, de la New Economic Foundation de Londres, ont mis au point une grille de quantification sans doute très complexe et multi-paramètres afin de calculer le « retour social sur investissement » de chaque unité numéraire de la rémunération d'un métier en fonction de ses effets positifs ou négatifs sur la collectivité. Ainsi, « elles établissent par exemple que l'agente de nettoyage en milieu hospitalier produit 10 livres sterling de valeur sociale pour chaque livre absorbée par son misérable salaire […]
[…] l'étude conclut que les cadres du secteur publicitaire détruisent une valeur de 11,50 livres à chaque fois qu'ils engendrent une livre de valeur. » (pp. 25-26). Il va sans dire que, dans ce livre, la légitimité à qualifier cette catégorie d'emplois de « boulots de merde » découle de la comptabilité qui les estime comme socialement néfastes, d'où l'inclusion dans l'ouvrage et dans le sous-titre du métier de trader.
Comme je l'ai précisé, il s'agit là non d'un essai de sociologie du travail mais d'une enquête menée par deux journalistes indépendants (et passablement précaires). Elle s'organise autour d'entretiens plus ou moins longs, avec une bonne dizaine de représentants de ce qu'ils ont pressenti comme des « boulots de merde », souvent à l'encontre du ressenti de ceux-là mêmes qui s'y dédient, suivis par des approfondissements très intéressants et fort opportuns sur certains secteurs d'activité dont l'évolution est assurément critique dans ce qu'elle a de néfaste : 1. les salons des « petits boulots de merde », 2. le service civique, 3. les cireurs de souliers, 4. la distribution de prospectus, 5. les contrôles aux frontières, 6. le commerce de luxe, 7. la toyotisation des hôpitaux, 8. les gestionnaires de patrimoine, 9. la Poste. D'autres entretiens non suivis d'approfondissements, rapportés presque verbatim, et qui s'alternent aux chapitres sus-cités, concernent : « Léa, 24 ans, plante verte dans un palace parisien », « Yasmine, 30 ans, préparatrice de sandwiches dans une multinationale alimentaire », « Michel, 42 ans, enquêteur dans un institut de sondages », « Abel, 30 ans, livreur à vélo pour une 'appli' de repas à domicile », « Alain, 54 ans, ouvrier sous-traitant dans une usine de farine », « Jessica, 38 ans, responsable santé dans une usine Seveso », « Thomas, 30 ans, contrôleur dans une société d'audit financier ».
Généralement, j'adhère à l'amplitude de la définition proposée par les auteurs. J'ai apprécié la variété des secteurs analysés et des travailleurs interviewés, même si, bien entendu, dans ce genre de recherche, l'on a toujours le sentiment que d'autres professions, qui nous paraissent absolument nécessaires, ont été délaissées (pour moi, ça aurait été le cas des gardiens de prison, ainsi que des cadres d'entreprises d'État ou récemment privatisées). le style du texte est enlevé, vivace, pétillant : la lecture en est particulièrement agréable.
1. « Certains critères sautent aux yeux : la rémunération rachitique, la précarité, les contrats dégradés ou inexistants, la dureté de la tâche, l'isolement, l'entrave aux droits syndicaux, les discriminations (en fonction notamment du sexe, de la religion ou de la couleur de peau), le despotisme patronal ou managérial, le non-respect de la dignité humaine. Ces attributs forment en quelque sorte le noyau des boulots de merde, selon la manière dont ils s'additionnent et se combinent. » (p. 11). Notons que l'ensemble du texte révélera que la « merditude » de ces métiers s'avère être surtout un caractère dynamique, lié à la dégradation des conditions de travail, souvent assez récente ou accélérée, et non nécessairement intrinsèque à la profession.
2. La notion introduite par l'anthropologue américain David Graeber (2013) de « bullshit job », qui renferme les professions aliénantes, dépourvues de sens pour celui ou celle qui les exerce, lui provoquant un surcroît d'ennui, quel que soit son niveau de rémunération et sa position dans la pyramide sociale et salariale. Lorsque la presse française a eu un éphémère engouement pour ce phénomène (avril-mai 2016), elle l'a désigné de « jobs à la con » ; contrairement aux auteurs, j'estime que, bien qu'il y ait de la « merde » dans « bullshit », cette traduction était meilleure pour désigner le concept en question, et qu'il ne s'agissait pas d'un euphémisme. Donc, on dira que les « jobs à la con », souvent des pensums de cadres dépressifs [perso, je ne peux m'empêcher de songer à fonctionnaire de la Commission européenne (en plus, chez les Anglais, il va y avoir un sacré plan social !)...], constituent un sous-ensemble des « boulots de merde » ; je souscris entièrement à cette inclusion.
3. le regretté philosophe André Gorz, tellement novateur à plusieurs égards, a été le premier à se pencher sur l'utilité, inutilité et surtout l'éventuelle nocivité sociale du travail. (Pour des ex. de cette dernière, cf. les marchants d'armes et les experts en « optimisation fiscale »...). En 2009, les chercheuses britanniques Eilis Lawlor, Helen Kersley et Susan Steed, de la New Economic Foundation de Londres, ont mis au point une grille de quantification sans doute très complexe et multi-paramètres afin de calculer le « retour social sur investissement » de chaque unité numéraire de la rémunération d'un métier en fonction de ses effets positifs ou négatifs sur la collectivité. Ainsi, « elles établissent par exemple que l'agente de nettoyage en milieu hospitalier produit 10 livres sterling de valeur sociale pour chaque livre absorbée par son misérable salaire […]
[…] l'étude conclut que les cadres du secteur publicitaire détruisent une valeur de 11,50 livres à chaque fois qu'ils engendrent une livre de valeur. » (pp. 25-26). Il va sans dire que, dans ce livre, la légitimité à qualifier cette catégorie d'emplois de « boulots de merde » découle de la comptabilité qui les estime comme socialement néfastes, d'où l'inclusion dans l'ouvrage et dans le sous-titre du métier de trader.
Comme je l'ai précisé, il s'agit là non d'un essai de sociologie du travail mais d'une enquête menée par deux journalistes indépendants (et passablement précaires). Elle s'organise autour d'entretiens plus ou moins longs, avec une bonne dizaine de représentants de ce qu'ils ont pressenti comme des « boulots de merde », souvent à l'encontre du ressenti de ceux-là mêmes qui s'y dédient, suivis par des approfondissements très intéressants et fort opportuns sur certains secteurs d'activité dont l'évolution est assurément critique dans ce qu'elle a de néfaste : 1. les salons des « petits boulots de merde », 2. le service civique, 3. les cireurs de souliers, 4. la distribution de prospectus, 5. les contrôles aux frontières, 6. le commerce de luxe, 7. la toyotisation des hôpitaux, 8. les gestionnaires de patrimoine, 9. la Poste. D'autres entretiens non suivis d'approfondissements, rapportés presque verbatim, et qui s'alternent aux chapitres sus-cités, concernent : « Léa, 24 ans, plante verte dans un palace parisien », « Yasmine, 30 ans, préparatrice de sandwiches dans une multinationale alimentaire », « Michel, 42 ans, enquêteur dans un institut de sondages », « Abel, 30 ans, livreur à vélo pour une 'appli' de repas à domicile », « Alain, 54 ans, ouvrier sous-traitant dans une usine de farine », « Jessica, 38 ans, responsable santé dans une usine Seveso », « Thomas, 30 ans, contrôleur dans une société d'audit financier ».
Généralement, j'adhère à l'amplitude de la définition proposée par les auteurs. J'ai apprécié la variété des secteurs analysés et des travailleurs interviewés, même si, bien entendu, dans ce genre de recherche, l'on a toujours le sentiment que d'autres professions, qui nous paraissent absolument nécessaires, ont été délaissées (pour moi, ça aurait été le cas des gardiens de prison, ainsi que des cadres d'entreprises d'État ou récemment privatisées). le style du texte est enlevé, vivace, pétillant : la lecture en est particulièrement agréable.
Si les revenus de la nettoyeuse et de l'ouvrier étaient indexés sur l'utilité sociale, ils mèneraient la vie de château qui leur est due et l'on cesserait sur le champ d'assimiler leurs métiers à des boulots de merde
L'essai boulots de merde enquête sur l utilité sociale dresse différents portraits de travailleurs. Une partie prend l'allure des témoignages de la campagne on vaut mieux que ça en plus développé.
Les dérogations du code du travail:
Un service civique qui doit aller faire du porte à porte pour servir aux gens le discours de la Lyonnaise des eaux. Aussi dur qu'un vrai boulot sans la protection du code du travail.
La préquantification des heures de travail dans le cadre de la la distribution de prospectus ne correspond pas à la réalité. ça donne des heures travaillées non payées.
"La patronne me faisait signer à la fin de chaque mois des avenant à mon contrat pour éviter de me payer les heures supplémentaires. Elle me disait que tout ça était légal et s'en référait à la convention collective de la restauration rapide. Cette convention, c'est la pire de toutes. Pas de majoration le soir, la nuit, les week-ends, rien!"
Besoin de travail pour vivre, alors le respect est une option facultative. Voire inconnue.
"Pour ta paie, ils ne prennent la peine de te l'envoyer: ils te disent de venir la chercher à l'agence! C'est beaucoup d'énergie dépensée pour quelques heures payées au smic, parfois pas plus de trois, pour quarante euros.."
Derrière l'envers du décors des restaurants de luxe, la courtoisie exclut les employés.
Le lendemain, je l'ai appelé pour lui signaler que ça ne se faisait pas de ne pas regarder les gens dans les yeux , il m'a répondu que c'était "comme ça dans l'hôtellerie" , que j'étais "pas habituée ", que " j'étais jeune ", que je ne comprenais rien
Et si on n'est pas content on n'a qu'à aller ailleurs. C'est l'avantage du chômage. Faire accepter le rabais aux salariés.
La santé est aussi une option.
Ses mots d'esprit prennent une saveur toute particulière deux ans plus tard, lorsque Raymond, un colporteur de soixante-quinze ans payé 280 euros par mois pour vingt-six heures de travail par semaine, meurt foudroyé par une crise cardiaque au milieu d'une tournée de distribution à Noisy-le-Grand. Atteint d'un diabète et déjà victime d'un infarctus quelques années plus tôt, il charriait ce jour-là vingt-cinq cartons d'imprimés pesant chacun 12,5 kilos. Adrexo avait jugé inutile de lui faire passer une visite médicale. « Bien qu'avertie le 30 août 2011 du décès de Raymond par la police, la société a continué à émettre chaque mois des bulletins de paie à son nom à zéro euro jusqu'en avril 2012, où elle a établi la fin du contrat pour « absence injustifiée ». Ce qui donne une vague idée de l'attention qu'elle porte à ses salariés », note l'auteur de l'un des très rares articles consacrés à cette affaire⁹ . La famille de Raymond attendra cinq ans pour obtenir « justice » : en mars 2016, le conseil des prud'hommes de Bobigny a condamné Adrexo à lui verser... 6 200 euros pour solde de tout compte
Restructurations impitoyables du service courrier, avec des tournées de plus en plus assurées par un personnel de plus en plus lessivé . Recours intensif aux contrats précaires. Instauration d'un management par le stress qui génère maladies professionnelles, accidents du travail, dépressions et suicides.
Il y a le travail au service des riches comme les cireurs de chaussures à la Défense.
A la faveur de l'entassement des richesses dans les mains d'une élite de plus en plus dodue et capricieuse, le secteur des tâches domestiques où l'on s'abaisse devant son maître se répand.
Les métiers d 'utilité sociale voient leur raison d'être sociale rabotée pour " des économies". Tant pis pour les malades.
La gestion entreprise appliquée à l hôpital: réduction de ce qui n est pas rentable. La qualité de soin amoindrie . Vive l ambulatoire.
Tant pis pour les personnes âgées qui vivent seules au milieu rural. Et si ces dernières années veulent avoir de la causette, il faut payer. Ce qui était gratuit avant devient payant. Rentabilité!
On n' a plus le temps de rendre les services qu'on rendait autrefois, comme de voir la mamie pour prendre de ses nouvelles ou lui apporter ses médicaments, tous ces petites choses qu'on était contents de faire naturellement. Ces tâches-là,la Poste nous interdit de les fournir quand elles sont gratuites, pour mieux nous les imposer sous leur forme commerciale, marchande, payante. En fait la Poste n'a rien inventé, ces fameux "service à la personne" dont elle fait la promotion aujourd'hui existaient pour la plupart depuis toujours, sauf qu'ils ne rapportaient rien, car les facteurs s'en acquittaient librement et sans en faire un plat.
L'agent de nettoyage hospitalier - travail pénible , invisible, peu considéré, mal payé et généralement sous-traité - produit plus de dix livres sterling de valeur sociale pour chaque livre qu'il absorbe en salaire. A l'inverse le banquier d'affaires travail de fauteuil survalorisé et gratifié de revenus colossaux -détruit sept livres de valeur sociale pour chaque livre de valeur financière créée. Quand au conseiller fiscal, dont la fonction consiste à priver la collectivité du produit de l'impôt, il détruit quarante-sept fois plus de valeur qu'il n'en crée. New Economic Foundation
Ne faudrait-il pas un mouvement de clients et de consommateurs réclamant des conditions de travail décent pour les gens qui travaillent à leur service.? Ne faudrait-il pas un urgence du retour de l'humain dans cette société? Les relations humaines, les services publics, la santé ne doivent pas être considérés comme des pompes à fric mais comme des biens communs de l'humanité.
L'essai boulots de merde enquête sur l utilité sociale dresse différents portraits de travailleurs. Une partie prend l'allure des témoignages de la campagne on vaut mieux que ça en plus développé.
Les dérogations du code du travail:
Un service civique qui doit aller faire du porte à porte pour servir aux gens le discours de la Lyonnaise des eaux. Aussi dur qu'un vrai boulot sans la protection du code du travail.
La préquantification des heures de travail dans le cadre de la la distribution de prospectus ne correspond pas à la réalité. ça donne des heures travaillées non payées.
"La patronne me faisait signer à la fin de chaque mois des avenant à mon contrat pour éviter de me payer les heures supplémentaires. Elle me disait que tout ça était légal et s'en référait à la convention collective de la restauration rapide. Cette convention, c'est la pire de toutes. Pas de majoration le soir, la nuit, les week-ends, rien!"
Besoin de travail pour vivre, alors le respect est une option facultative. Voire inconnue.
"Pour ta paie, ils ne prennent la peine de te l'envoyer: ils te disent de venir la chercher à l'agence! C'est beaucoup d'énergie dépensée pour quelques heures payées au smic, parfois pas plus de trois, pour quarante euros.."
Derrière l'envers du décors des restaurants de luxe, la courtoisie exclut les employés.
Le lendemain, je l'ai appelé pour lui signaler que ça ne se faisait pas de ne pas regarder les gens dans les yeux , il m'a répondu que c'était "comme ça dans l'hôtellerie" , que j'étais "pas habituée ", que " j'étais jeune ", que je ne comprenais rien
Et si on n'est pas content on n'a qu'à aller ailleurs. C'est l'avantage du chômage. Faire accepter le rabais aux salariés.
La santé est aussi une option.
Ses mots d'esprit prennent une saveur toute particulière deux ans plus tard, lorsque Raymond, un colporteur de soixante-quinze ans payé 280 euros par mois pour vingt-six heures de travail par semaine, meurt foudroyé par une crise cardiaque au milieu d'une tournée de distribution à Noisy-le-Grand. Atteint d'un diabète et déjà victime d'un infarctus quelques années plus tôt, il charriait ce jour-là vingt-cinq cartons d'imprimés pesant chacun 12,5 kilos. Adrexo avait jugé inutile de lui faire passer une visite médicale. « Bien qu'avertie le 30 août 2011 du décès de Raymond par la police, la société a continué à émettre chaque mois des bulletins de paie à son nom à zéro euro jusqu'en avril 2012, où elle a établi la fin du contrat pour « absence injustifiée ». Ce qui donne une vague idée de l'attention qu'elle porte à ses salariés », note l'auteur de l'un des très rares articles consacrés à cette affaire⁹ . La famille de Raymond attendra cinq ans pour obtenir « justice » : en mars 2016, le conseil des prud'hommes de Bobigny a condamné Adrexo à lui verser... 6 200 euros pour solde de tout compte
Restructurations impitoyables du service courrier, avec des tournées de plus en plus assurées par un personnel de plus en plus lessivé . Recours intensif aux contrats précaires. Instauration d'un management par le stress qui génère maladies professionnelles, accidents du travail, dépressions et suicides.
Il y a le travail au service des riches comme les cireurs de chaussures à la Défense.
A la faveur de l'entassement des richesses dans les mains d'une élite de plus en plus dodue et capricieuse, le secteur des tâches domestiques où l'on s'abaisse devant son maître se répand.
Les métiers d 'utilité sociale voient leur raison d'être sociale rabotée pour " des économies". Tant pis pour les malades.
La gestion entreprise appliquée à l hôpital: réduction de ce qui n est pas rentable. La qualité de soin amoindrie . Vive l ambulatoire.
Tant pis pour les personnes âgées qui vivent seules au milieu rural. Et si ces dernières années veulent avoir de la causette, il faut payer. Ce qui était gratuit avant devient payant. Rentabilité!
On n' a plus le temps de rendre les services qu'on rendait autrefois, comme de voir la mamie pour prendre de ses nouvelles ou lui apporter ses médicaments, tous ces petites choses qu'on était contents de faire naturellement. Ces tâches-là,la Poste nous interdit de les fournir quand elles sont gratuites, pour mieux nous les imposer sous leur forme commerciale, marchande, payante. En fait la Poste n'a rien inventé, ces fameux "service à la personne" dont elle fait la promotion aujourd'hui existaient pour la plupart depuis toujours, sauf qu'ils ne rapportaient rien, car les facteurs s'en acquittaient librement et sans en faire un plat.
L'agent de nettoyage hospitalier - travail pénible , invisible, peu considéré, mal payé et généralement sous-traité - produit plus de dix livres sterling de valeur sociale pour chaque livre qu'il absorbe en salaire. A l'inverse le banquier d'affaires travail de fauteuil survalorisé et gratifié de revenus colossaux -détruit sept livres de valeur sociale pour chaque livre de valeur financière créée. Quand au conseiller fiscal, dont la fonction consiste à priver la collectivité du produit de l'impôt, il détruit quarante-sept fois plus de valeur qu'il n'en crée. New Economic Foundation
Ne faudrait-il pas un mouvement de clients et de consommateurs réclamant des conditions de travail décent pour les gens qui travaillent à leur service.? Ne faudrait-il pas un urgence du retour de l'humain dans cette société? Les relations humaines, les services publics, la santé ne doivent pas être considérés comme des pompes à fric mais comme des biens communs de l'humanité.
Rappelons en préambule que l'homme travaille non pas pour permettre à quelques nantis de se la couler douce sous les palmiers d'iles enchantées (patrons, actionnaires, rentiers…). Pas plus pour faire « chauffer la marmite et payer son loyer ». Tout cela ne sont que les conséquences d'un dur labeur.
Avant tout, l'homme vivant en société, travaille pour son prochain, la communauté, afin d'améliorer son quotidien.
Voilà pour la théorie.
En pratique, c'est autre chose.
Tout est parti de travers dès lors qu'a eu lieu l'invention du travail, lié au développement de l'industrie et la consommation de masse qui s'ensuit. Avant le XVIIIème siècle, on n'utilisait d'ailleurs pas le terme de travail, réservé à un tout autre usage.
Le « travail » était, au temps béni du moyen-âge, une sorte de roue où l'on attachait les quelques récalcitrants à la doctrine en cours en les écartelant gentiment. On retrouve ce sens premier lorsqu'on indique que le bois « travaille » - qu'il se déforme sous l'action de l'humidité.
Les deux journalistes ont donc enquêté sur le monde du travail aujourd'hui. Et le mot est parfaitement choisi. Il n'est point question, ici, de métier : un savoir ou savoir-faire qui nous accompagne toute notre vie, dans lequel on s'engage afin de donner le meilleur de soi-même dans le but d'offrir ses compétences à la société tout en y gagnant une reconnaissance et un plaisir.
Lorsqu'on parle de travail précaire, déqualifié, subi, on pense naturellement à la grande distribution et sa partie émergée de l'iceberg : la caissière de supermarché. On va vite s'apercevoir, à la lecture de cet édifiant reportage, que scanner des caddies bondés ne représente pas forcément la pire des conditions.
Otons-nous d'emblée une idée de la tête : les boulots de merde ne sont pas spécialement ceux qui sont les moins bien payés. On rencontre ainsi des cadres et des fonctionnaires pour qui le quotidien ne rime pas exactement avec épanouissement garanti.
Plus grave : ces activités au rabais (pas que pécuniairement s'entend, mais aussi et surtout dans leurs conditions d'exécution) s'étendent à des secteurs plus sensibles : la sécurité et la santé. Qu'on Taylorise (les fameuses cadences infernales dénoncées par les syndicats) dans les usines, passons, mais qu'on applique cette rationalisation et optimisation du travail au sein même de l'emblème des rapports humains – l'hôpital -, voilà qui fait froid dans le dos. le patient se transforme vite en client et le personnel, restreint et donc stressé, se transforme en robots effectuant les tâches élémentaires et devant laisser de côté l'essentiel : l'échange.
Au fil des pages et des témoignages de ceux « qui se lèvent tôt », on se rend compte que notre société libérale considère ses rouages (ceux qui la font tourner) comme des billes qui ne doivent avoir ni état d'âme ni pensée propre, à part celle d'oeuvrer pour l'Entreprise. Cette marchandisation à tout va et à tous les niveaux nuit forcément à ce qui fait l'essence même d'une vie en société.
D'autre part, le terme boulot de merde offre deux connotations : d'abord, celui de travail précaire où l'employé n'est considéré que comme un pion, le plus docile, le moins cher et le plus rentable possible. Mais aussi dans l'essence même de cette activité et son empreinte sur l'environnement et les hommes. Cette utilité sociale du travail – ou, à l'inverse, sa nuisance - n'est quasiment pas évoqué dans cet essai. Ce thème cher à David Graeber, dont on soulignera l'ouvrage homonyme (bullshit jobs) ne sera abordé que dans l'antépénultième chapitre, où il est question de la finance. On se rend compte alors que le noeud du problème se situe justement là.
Le terme boulot à la con s'applique aussi à toutes ces activités qui nuisent à la société : on pense naturellement aux fermes tellement immenses qu'on parlera d'entreprises agricoles ne se souciant pas davantage du bien être de leurs cohortes d'ouvriers que de leur bétail sans parler des blessures qu'elles infligent à la Terre, pourtant la mère de leur raison d'être. Tous les travaux qui mettent en péril la biodiversité (pétrole, usines chimiques, mono cultures), la santé et le bien-être d'autrui (pas seulement la répression, mais aussi toutes ces activités autour de la publicité, du marketing, bref, le conditionnement des masses).
Ce qui a profondément changé depuis trente ans, c'est qu'avant les années Tapie (fric roi et culte de l'entreprise), on pouvait à la rigueur supporter un boulot ennuyeux et/ou dégradant pour peu que l'on ait la possibilité de travailler dans une ambiance bon enfant en compagnie de collègue qui devenaient parfois (souvent ?) des amis. Depuis les balbutiements du siècle nouveau, on parvient au paradoxe que, même un métier choisi et intéressant où l'on peut s'épanouir en s'appuyant sur ses compétences, s'avère glisser lentement vers des conditions qui le rendent moins attractif, en vertu du principe de rentabilité à tout prix.
Un petit livre édifiant qui ne donnera pas forcément envie aux chômeurs, toujours plus nombreux dans ce monde où un homme n'est plus qu'un matricule, de retrouver du travail et à ceux qui, ô cruel privilège, possèdent un emploi d'espérer au plus vite que vienne l'âge de la retraite. Et encore… Ne faudra-t-il pas, comme ce couple septuagénaire interviewé dans ce petit livre rouge (rapport à sa couverture), se lever aux aurores pour aller inonder les boites à lettres de prospectus vantant les mérites d'un monde consumériste basé sur une nouvelle idée de l'esclavage moderne.
Avant tout, l'homme vivant en société, travaille pour son prochain, la communauté, afin d'améliorer son quotidien.
Voilà pour la théorie.
En pratique, c'est autre chose.
Tout est parti de travers dès lors qu'a eu lieu l'invention du travail, lié au développement de l'industrie et la consommation de masse qui s'ensuit. Avant le XVIIIème siècle, on n'utilisait d'ailleurs pas le terme de travail, réservé à un tout autre usage.
Le « travail » était, au temps béni du moyen-âge, une sorte de roue où l'on attachait les quelques récalcitrants à la doctrine en cours en les écartelant gentiment. On retrouve ce sens premier lorsqu'on indique que le bois « travaille » - qu'il se déforme sous l'action de l'humidité.
Les deux journalistes ont donc enquêté sur le monde du travail aujourd'hui. Et le mot est parfaitement choisi. Il n'est point question, ici, de métier : un savoir ou savoir-faire qui nous accompagne toute notre vie, dans lequel on s'engage afin de donner le meilleur de soi-même dans le but d'offrir ses compétences à la société tout en y gagnant une reconnaissance et un plaisir.
Lorsqu'on parle de travail précaire, déqualifié, subi, on pense naturellement à la grande distribution et sa partie émergée de l'iceberg : la caissière de supermarché. On va vite s'apercevoir, à la lecture de cet édifiant reportage, que scanner des caddies bondés ne représente pas forcément la pire des conditions.
Otons-nous d'emblée une idée de la tête : les boulots de merde ne sont pas spécialement ceux qui sont les moins bien payés. On rencontre ainsi des cadres et des fonctionnaires pour qui le quotidien ne rime pas exactement avec épanouissement garanti.
Plus grave : ces activités au rabais (pas que pécuniairement s'entend, mais aussi et surtout dans leurs conditions d'exécution) s'étendent à des secteurs plus sensibles : la sécurité et la santé. Qu'on Taylorise (les fameuses cadences infernales dénoncées par les syndicats) dans les usines, passons, mais qu'on applique cette rationalisation et optimisation du travail au sein même de l'emblème des rapports humains – l'hôpital -, voilà qui fait froid dans le dos. le patient se transforme vite en client et le personnel, restreint et donc stressé, se transforme en robots effectuant les tâches élémentaires et devant laisser de côté l'essentiel : l'échange.
Au fil des pages et des témoignages de ceux « qui se lèvent tôt », on se rend compte que notre société libérale considère ses rouages (ceux qui la font tourner) comme des billes qui ne doivent avoir ni état d'âme ni pensée propre, à part celle d'oeuvrer pour l'Entreprise. Cette marchandisation à tout va et à tous les niveaux nuit forcément à ce qui fait l'essence même d'une vie en société.
D'autre part, le terme boulot de merde offre deux connotations : d'abord, celui de travail précaire où l'employé n'est considéré que comme un pion, le plus docile, le moins cher et le plus rentable possible. Mais aussi dans l'essence même de cette activité et son empreinte sur l'environnement et les hommes. Cette utilité sociale du travail – ou, à l'inverse, sa nuisance - n'est quasiment pas évoqué dans cet essai. Ce thème cher à David Graeber, dont on soulignera l'ouvrage homonyme (bullshit jobs) ne sera abordé que dans l'antépénultième chapitre, où il est question de la finance. On se rend compte alors que le noeud du problème se situe justement là.
Le terme boulot à la con s'applique aussi à toutes ces activités qui nuisent à la société : on pense naturellement aux fermes tellement immenses qu'on parlera d'entreprises agricoles ne se souciant pas davantage du bien être de leurs cohortes d'ouvriers que de leur bétail sans parler des blessures qu'elles infligent à la Terre, pourtant la mère de leur raison d'être. Tous les travaux qui mettent en péril la biodiversité (pétrole, usines chimiques, mono cultures), la santé et le bien-être d'autrui (pas seulement la répression, mais aussi toutes ces activités autour de la publicité, du marketing, bref, le conditionnement des masses).
Ce qui a profondément changé depuis trente ans, c'est qu'avant les années Tapie (fric roi et culte de l'entreprise), on pouvait à la rigueur supporter un boulot ennuyeux et/ou dégradant pour peu que l'on ait la possibilité de travailler dans une ambiance bon enfant en compagnie de collègue qui devenaient parfois (souvent ?) des amis. Depuis les balbutiements du siècle nouveau, on parvient au paradoxe que, même un métier choisi et intéressant où l'on peut s'épanouir en s'appuyant sur ses compétences, s'avère glisser lentement vers des conditions qui le rendent moins attractif, en vertu du principe de rentabilité à tout prix.
Un petit livre édifiant qui ne donnera pas forcément envie aux chômeurs, toujours plus nombreux dans ce monde où un homme n'est plus qu'un matricule, de retrouver du travail et à ceux qui, ô cruel privilège, possèdent un emploi d'espérer au plus vite que vienne l'âge de la retraite. Et encore… Ne faudra-t-il pas, comme ce couple septuagénaire interviewé dans ce petit livre rouge (rapport à sa couverture), se lever aux aurores pour aller inonder les boites à lettres de prospectus vantant les mérites d'un monde consumériste basé sur une nouvelle idée de l'esclavage moderne.
Lorsque j'ai vu le titre de ce livre la première fois j'ai été tout de suite attirée, car le thème du travail et sa transformation dans notre société actuelle est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Ici les auteurs prennent un prisme particulier : celui des «bullshit jobs», notion apparue il y a quelques années : comprenez les métiers de m*rde dépourvus de sens et relativement nuisibles à la société.
Maintenant que je l'ai lu je peux dire que, bien que j'ai trouvé l'ouvrage fascinant, je ne m'attendais pas tout à fait à cette forme. J'ai été assez étonnée par le fait que livre se présente comme un enchainement de témoignages plus qu'une analyse de ces situations. Malgré tout j'ai été prise par les histoires de toutes ces personnes interrogées grâce à la façon dont les auteurs ont retranscrit leurs échanges, de manière vivante et dynamique. Une écriture également souvent teinté de sarcasme et d'humour noir, on constate clairement que les auteurs, Julien Brygo et Oivier Cyran, ne sont pas distanciés de leurs propos, ça aussi je ne m'y attendais pas et certes j'aurais préféré un analyse objective ou neutre, mais je me suis rendue compte que parfois ce n'est pas plus mal de lire un ouvrage de société dans lequel le ou les auteurs sont engagés !
Car effectivement, les deux journalistes n'hésiterons pas à plusieurs reprises de mentionner leur propres situations, leurs galères et la précarité de leur métier (ils s'incluent d'ailleurs dans ces bullshit jobs).
Avant de commencer les différents témoignages, les deux auteurs commencent par une longue introduction où ils expliquent le cheminement et le questionnement qui les a amenés à écrire ce livre, ils vont aussi expliquer et recontextualiser le terme de "bullshit jobs" en citant notamment David Graeber. Cette introduction était si passionnante que j'en aurais même aimé davantage.
Ensuite on va, comme énoncé plus haut, s'immerger dans le témoignage de différentes personnes qu'ils ont interrogés. Et avant qu'on ne s'y trompe : non le bullshit job ce n'est pas seulement le trader ou le banquier. Ça peut être l'hôtesse d'accueil d'un palace parisien, l'enquêteur d'un institut de sondage ou la chargée de communication d'un grand hôpital.
C'était tout bonnement sidérant de réaliser la quantité de métiers qui ont perdus leur sens à cause de la course effrénée au management et au résultat qui caractérise notre système économique. Tout en apprenant que, paradoxalement, le secteur tertiaire et surtout celui du service à la personne, connait un boum extraordinaire ces dernières années et a favorisé une nouvelle forme de précarité du travail...
En plus des exemples cités plus hauts, nos deux auteurs iront aussi en immersion auprès d'un distributeur de prospectus, de contrôleurs aux frontières chargé de repousser les migrants, et ils iront même interviewer Jean-Pierre Gaillard, un grand journaliste boursier ayant fait fortune en répétant inlassablement les chiffre de la bourse à la radio.
Toutes ces personnes, les deux chercheurs vont tenter de les pousser dans leur retranchements en leur posant des questions sur leur métier, sur leur utilité, sur leur rapport à eux même. Des questions pas toujours facile à entendre mais qui étaient le coeur de leur démarche.
Même si un chapitre de conclusion aurait été le bienvenu pour terminer cet ouvrage, ce n'est pas grave car on comprend que c'est un livre qui ne se lit pas comme un essai mais comme une sorte de reportage, de documentaire. Fascinant, immersif.
Révoltant également lorsqu'on le referme et qu'on a la sensation que notre société entière est dépourvue de sens...
À lire !
Maintenant que je l'ai lu je peux dire que, bien que j'ai trouvé l'ouvrage fascinant, je ne m'attendais pas tout à fait à cette forme. J'ai été assez étonnée par le fait que livre se présente comme un enchainement de témoignages plus qu'une analyse de ces situations. Malgré tout j'ai été prise par les histoires de toutes ces personnes interrogées grâce à la façon dont les auteurs ont retranscrit leurs échanges, de manière vivante et dynamique. Une écriture également souvent teinté de sarcasme et d'humour noir, on constate clairement que les auteurs, Julien Brygo et Oivier Cyran, ne sont pas distanciés de leurs propos, ça aussi je ne m'y attendais pas et certes j'aurais préféré un analyse objective ou neutre, mais je me suis rendue compte que parfois ce n'est pas plus mal de lire un ouvrage de société dans lequel le ou les auteurs sont engagés !
Car effectivement, les deux journalistes n'hésiterons pas à plusieurs reprises de mentionner leur propres situations, leurs galères et la précarité de leur métier (ils s'incluent d'ailleurs dans ces bullshit jobs).
Avant de commencer les différents témoignages, les deux auteurs commencent par une longue introduction où ils expliquent le cheminement et le questionnement qui les a amenés à écrire ce livre, ils vont aussi expliquer et recontextualiser le terme de "bullshit jobs" en citant notamment David Graeber. Cette introduction était si passionnante que j'en aurais même aimé davantage.
Ensuite on va, comme énoncé plus haut, s'immerger dans le témoignage de différentes personnes qu'ils ont interrogés. Et avant qu'on ne s'y trompe : non le bullshit job ce n'est pas seulement le trader ou le banquier. Ça peut être l'hôtesse d'accueil d'un palace parisien, l'enquêteur d'un institut de sondage ou la chargée de communication d'un grand hôpital.
C'était tout bonnement sidérant de réaliser la quantité de métiers qui ont perdus leur sens à cause de la course effrénée au management et au résultat qui caractérise notre système économique. Tout en apprenant que, paradoxalement, le secteur tertiaire et surtout celui du service à la personne, connait un boum extraordinaire ces dernières années et a favorisé une nouvelle forme de précarité du travail...
En plus des exemples cités plus hauts, nos deux auteurs iront aussi en immersion auprès d'un distributeur de prospectus, de contrôleurs aux frontières chargé de repousser les migrants, et ils iront même interviewer Jean-Pierre Gaillard, un grand journaliste boursier ayant fait fortune en répétant inlassablement les chiffre de la bourse à la radio.
Toutes ces personnes, les deux chercheurs vont tenter de les pousser dans leur retranchements en leur posant des questions sur leur métier, sur leur utilité, sur leur rapport à eux même. Des questions pas toujours facile à entendre mais qui étaient le coeur de leur démarche.
Même si un chapitre de conclusion aurait été le bienvenu pour terminer cet ouvrage, ce n'est pas grave car on comprend que c'est un livre qui ne se lit pas comme un essai mais comme une sorte de reportage, de documentaire. Fascinant, immersif.
Révoltant également lorsqu'on le referme et qu'on a la sensation que notre société entière est dépourvue de sens...
À lire !
Quels sont les 3 métiers les plus utiles à la société ? Les moins utiles à la société ?
Dans cette enquête savoureuse et courageuse, les auteurs ont tenté de définir les critères objectifs du boulot de merde à travers des portraits, des témoignages et des recherches chiffrées. Dans un style volontiers cynique fait de phrases qui tuent, ils montrent la dégradation constante des conditions de travail et soulignent que tous les métiers n'ont pas la même utilité sociale.
[...] La lecture de cet ouvrage a été savoureuse et étonnante à plusieurs égards. J'aime beaucoup lire les témoignages et les portraits, et il faut souligner d'emblée que Julien Brygo et Olivier Cyran ont une certaine plume : ils décrivent leurs démarches et les gens qu'ils rencontrent avec une bonne dose de cynisme (envers les métiers, pas forcément envers les gens), déjouant à tour de bras les discours de langue de bois, car comme ils le disent, eux aussi connaissent bien le boulot de merde des journalistes précaires. Leur style enlevé est ponctué de phrases qui tuent, du genre « l'homme respire la joie de vivre d'un formulaire administratif », sans toutefois mettre de côté le sérieux de l'enquête. Si les auteurs ne se sont pas fait que des amis en publiant cette enquête, ils ont toute ma sympathie !
Voilà une lecture audacieuse que je vous recommande vivement, car le travail est au coeur de nos sociétés. C'est ce qui occupe la majeure partie de notre temps et c'est ce qui fonde nos sociétés : il est essentiel de s'interroger à son propos. [...]
L'article entier sur Bibliolingus :
http://www.bibliolingus.fr/boulots-de-merde-julien-brygo-et-olivier-cyran-a127887404
Lien : http://www.bibliolingus.fr/b..
Dans cette enquête savoureuse et courageuse, les auteurs ont tenté de définir les critères objectifs du boulot de merde à travers des portraits, des témoignages et des recherches chiffrées. Dans un style volontiers cynique fait de phrases qui tuent, ils montrent la dégradation constante des conditions de travail et soulignent que tous les métiers n'ont pas la même utilité sociale.
[...] La lecture de cet ouvrage a été savoureuse et étonnante à plusieurs égards. J'aime beaucoup lire les témoignages et les portraits, et il faut souligner d'emblée que Julien Brygo et Olivier Cyran ont une certaine plume : ils décrivent leurs démarches et les gens qu'ils rencontrent avec une bonne dose de cynisme (envers les métiers, pas forcément envers les gens), déjouant à tour de bras les discours de langue de bois, car comme ils le disent, eux aussi connaissent bien le boulot de merde des journalistes précaires. Leur style enlevé est ponctué de phrases qui tuent, du genre « l'homme respire la joie de vivre d'un formulaire administratif », sans toutefois mettre de côté le sérieux de l'enquête. Si les auteurs ne se sont pas fait que des amis en publiant cette enquête, ils ont toute ma sympathie !
Voilà une lecture audacieuse que je vous recommande vivement, car le travail est au coeur de nos sociétés. C'est ce qui occupe la majeure partie de notre temps et c'est ce qui fonde nos sociétés : il est essentiel de s'interroger à son propos. [...]
L'article entier sur Bibliolingus :
http://www.bibliolingus.fr/boulots-de-merde-julien-brygo-et-olivier-cyran-a127887404
Lien : http://www.bibliolingus.fr/b..
Citations et extraits (32)
Voir plus
Ajouter une citation
p.118.
Ses mots d'esprit prennent une saveur toute particulière deux ans plus tard, lorsque Raymond, un colporteur de soixante-quinze ans payé 280 euros par mois pour vingt-six heures de travail par semaine, meurt foudroyé par une crise cardiaque au milieu d’une tournée de distribution à Noisy-le-Grand. Atteint d'un diabète et déjà victime d'un infarctus quelques années plus tôt, il charriait ce jour-là vingt-cinq cartons d'imprimés pesant chacun 12,5 kilos. Adrexo avait jugé inutile de lui faire passer une visite médicale. « Bien qu'avertie le 30 août 2011 du décès de Raymond par la police, la société a continué à émettre chaque mois des bulletins de paie à son nom à zéro euro jusqu'en avril 2012, où elle a établi la fin du contrat pour « absence injustifiée ». Ce qui donne une vague idée de l'attention qu'elle porte à ses salariés », note l'auteur de l'un des très rares articles consacrés à cette affaire⁹ . La famille de Raymond attendra cinq ans pour obtenir « justice » : en mars 2016, le conseil des prud'hommes de Bobigny a condamné Adrexo à lui verser... 6 200 euros pour solde de tout compte¹⁰ .
9 Michaël HAJDENBERG, « Adrexo condamné après la mort d'un salarié de 75 ans », Mediapart, 25 Mars 2016.
10 Dont 2 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et 3 000 euros pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail. La mort d'un salarié, c'est donné.
Ses mots d'esprit prennent une saveur toute particulière deux ans plus tard, lorsque Raymond, un colporteur de soixante-quinze ans payé 280 euros par mois pour vingt-six heures de travail par semaine, meurt foudroyé par une crise cardiaque au milieu d’une tournée de distribution à Noisy-le-Grand. Atteint d'un diabète et déjà victime d'un infarctus quelques années plus tôt, il charriait ce jour-là vingt-cinq cartons d'imprimés pesant chacun 12,5 kilos. Adrexo avait jugé inutile de lui faire passer une visite médicale. « Bien qu'avertie le 30 août 2011 du décès de Raymond par la police, la société a continué à émettre chaque mois des bulletins de paie à son nom à zéro euro jusqu'en avril 2012, où elle a établi la fin du contrat pour « absence injustifiée ». Ce qui donne une vague idée de l'attention qu'elle porte à ses salariés », note l'auteur de l'un des très rares articles consacrés à cette affaire⁹ . La famille de Raymond attendra cinq ans pour obtenir « justice » : en mars 2016, le conseil des prud'hommes de Bobigny a condamné Adrexo à lui verser... 6 200 euros pour solde de tout compte¹⁰ .
9 Michaël HAJDENBERG, « Adrexo condamné après la mort d'un salarié de 75 ans », Mediapart, 25 Mars 2016.
10 Dont 2 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale et 3 000 euros pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité au travail. La mort d'un salarié, c'est donné.
p.30-1.
Interrogé sur cette main-d’œuvre invisibilisée qui représentait 88% de son personnel, le mammouth du BTP Francis Bouygues déclarait en 1970 : « Les conditions de travail que nous offrons sur le marché de la main d’œuvre sont telles que les Français préfèrent travailler en usine ou dans les bureaux. Par contre ces conditions restent attractives pour une main d’œuvre relativement frustre qui vient de pays étrangers. Sur un chantier, en effet, on travaille dehors, il fait chaud, il fait froid, il pleut, il y a de la neige, il n'y a pas d'installations très confortables pour les vestiaires, pas de restaurant, les travaux sont souvent sales, le lieu de travail n'est pas fixe et peut se trouver fort loin du domicile.
- Comment feriez-vous sans cette main-d'oeuvre étrangère ?
La profession serait obligée d'offrir des conditions de travail telles que la main-d’œuvre française s'y intéresse.
Elle ne pourrait pas le faire sans y être obligée ?
Je ne crois pas que l'on fasse beaucoup de choses sans y être obligé. […] Nous ne pouvons pas former [la main d’œuvre étrangère] car si nous la formons, nous n'avons pas l'espoir que nous pourrons la conserver. Ces gens-là sont venus en France pour gagner de l'argent. Et à partir de là il leur est égal de travailleur douze heures par jour ou même seize heures quand ils le peuvent ¹⁷, »
17 Interview extraite de Étranges étrangers , film documentaire de Marcel Trillat et Frédéric Variot, diffusé dans le magazine « Certifié Exact », 1970.
Interrogé sur cette main-d’œuvre invisibilisée qui représentait 88% de son personnel, le mammouth du BTP Francis Bouygues déclarait en 1970 : « Les conditions de travail que nous offrons sur le marché de la main d’œuvre sont telles que les Français préfèrent travailler en usine ou dans les bureaux. Par contre ces conditions restent attractives pour une main d’œuvre relativement frustre qui vient de pays étrangers. Sur un chantier, en effet, on travaille dehors, il fait chaud, il fait froid, il pleut, il y a de la neige, il n'y a pas d'installations très confortables pour les vestiaires, pas de restaurant, les travaux sont souvent sales, le lieu de travail n'est pas fixe et peut se trouver fort loin du domicile.
- Comment feriez-vous sans cette main-d'oeuvre étrangère ?
La profession serait obligée d'offrir des conditions de travail telles que la main-d’œuvre française s'y intéresse.
Elle ne pourrait pas le faire sans y être obligée ?
Je ne crois pas que l'on fasse beaucoup de choses sans y être obligé. […] Nous ne pouvons pas former [la main d’œuvre étrangère] car si nous la formons, nous n'avons pas l'espoir que nous pourrons la conserver. Ces gens-là sont venus en France pour gagner de l'argent. Et à partir de là il leur est égal de travailleur douze heures par jour ou même seize heures quand ils le peuvent ¹⁷, »
17 Interview extraite de Étranges étrangers , film documentaire de Marcel Trillat et Frédéric Variot, diffusé dans le magazine « Certifié Exact », 1970.
p.199.
« Au bout du compte, on devient maltraitant », confie Marthe, une aide-soignante. « Ce week-end, par exemple, j'ai eu cinq fiches d'incidents. Je l'ai signalé à ma cadre. On devait faire les toilettes au lit [soins hygiène] très vite pour finir à midi, l'heure du repas. Je n'ai fait aucun rasage ni aucun soin de bouche, je n'ai mis aucun patient en fauteuil et je ne leur ai pas lavé les pieds non plus. Parce que je n'avais pas le temps. Puis on a pris nos repas, en dix minutes au lieu des vingt prévues. On a un travail technique, mais aussi relationnel : le patient veut vider son sac, mais on lui dit qu'on n'a pas le temps et on ferme la porte. On le laisse seul avec sa souffrance et puis c'est tout. »
« Au bout du compte, on devient maltraitant », confie Marthe, une aide-soignante. « Ce week-end, par exemple, j'ai eu cinq fiches d'incidents. Je l'ai signalé à ma cadre. On devait faire les toilettes au lit [soins hygiène] très vite pour finir à midi, l'heure du repas. Je n'ai fait aucun rasage ni aucun soin de bouche, je n'ai mis aucun patient en fauteuil et je ne leur ai pas lavé les pieds non plus. Parce que je n'avais pas le temps. Puis on a pris nos repas, en dix minutes au lieu des vingt prévues. On a un travail technique, mais aussi relationnel : le patient veut vider son sac, mais on lui dit qu'on n'a pas le temps et on ferme la porte. On le laisse seul avec sa souffrance et puis c'est tout. »
p.236-7.
Pour mieux lui faire comprendre le sens de notre question, on lui parle de l'enquête de la New Economic Foundation, dont les auteurs ont évalué les métiers en fonctions des bénéfices qu'ils apportent ou des dégâts qu'ils infligent en termes de santé, d'environnement, d'éducation ou de services collectifs. On lui explique que, selon cette étude, l'agent de nettoyage hospitalier – travail pénible, invisible, peu considéré, mal payé et généralement sous-traité - « produit plus de dix livres sterling de valeur sociale pour chaque livre qu'il absorbe en salaire ». À l'inverse, le banquier d'affaires – travail de fauteuil, survalorisé et gratifié de revenus colossaux – détruit sept livres de valeur sociale pour chaque livre de valeur financière créée. Quant au conseiller fiscal, dont la fonction consiste à priver la collectivité du produit de l'impôt, il détruit quarante sept fois plus de valeur qu'il n'en crée.
Pour mieux lui faire comprendre le sens de notre question, on lui parle de l'enquête de la New Economic Foundation, dont les auteurs ont évalué les métiers en fonctions des bénéfices qu'ils apportent ou des dégâts qu'ils infligent en termes de santé, d'environnement, d'éducation ou de services collectifs. On lui explique que, selon cette étude, l'agent de nettoyage hospitalier – travail pénible, invisible, peu considéré, mal payé et généralement sous-traité - « produit plus de dix livres sterling de valeur sociale pour chaque livre qu'il absorbe en salaire ». À l'inverse, le banquier d'affaires – travail de fauteuil, survalorisé et gratifié de revenus colossaux – détruit sept livres de valeur sociale pour chaque livre de valeur financière créée. Quant au conseiller fiscal, dont la fonction consiste à priver la collectivité du produit de l'impôt, il détruit quarante sept fois plus de valeur qu'il n'en crée.
p.14-5.
Dans un article paru en août 2013 dans la revue britannique Strike !, cet enseignant hétérodoxe de la London School of Economics – l'une des couveuses à cols blancs les plus huppées de la planète – mettait en garde contre l'aliénation de masse provoquée par la multiplication des tâches vaines et dépourvues de sens. Pour David Graeber, le bulsshit job ne se définit pas par des critères de rémunérations, de précarité ou d'amputation des droits, mais par son déficit d'utilité sociale et par l'ennui végétatif dans lequel il plonge ses victimes. Alors que la robotisation a permis d'alléger la charge de travail dans de nombreux domaines, la technologie, avance-t-il, « a été manipulée pour trouver des moyens de nous faire travailler plus ». « Pour y arriver, des emplois ont dû être créés qui sont par définition inutiles », explique-t-il, en prenant comme exemple « le gonflement des industries de service et du secteur administratif, mais aussi d'industries nouvelles comme les services financiers et le télémarketing, ou encore la croissance sans précédent de secteurs comme le droit des affaires, les ressources humaines ou les relations publiques. C'est comme si quelqu'un inventait tout un tas d'emplois inutiles pour continuer à nous faire travailler ».
Dans un article paru en août 2013 dans la revue britannique Strike !, cet enseignant hétérodoxe de la London School of Economics – l'une des couveuses à cols blancs les plus huppées de la planète – mettait en garde contre l'aliénation de masse provoquée par la multiplication des tâches vaines et dépourvues de sens. Pour David Graeber, le bulsshit job ne se définit pas par des critères de rémunérations, de précarité ou d'amputation des droits, mais par son déficit d'utilité sociale et par l'ennui végétatif dans lequel il plonge ses victimes. Alors que la robotisation a permis d'alléger la charge de travail dans de nombreux domaines, la technologie, avance-t-il, « a été manipulée pour trouver des moyens de nous faire travailler plus ». « Pour y arriver, des emplois ont dû être créés qui sont par définition inutiles », explique-t-il, en prenant comme exemple « le gonflement des industries de service et du secteur administratif, mais aussi d'industries nouvelles comme les services financiers et le télémarketing, ou encore la croissance sans précédent de secteurs comme le droit des affaires, les ressources humaines ou les relations publiques. C'est comme si quelqu'un inventait tout un tas d'emplois inutiles pour continuer à nous faire travailler ».
Video de Olivier Cyran (1)
Voir plusAjouter une vidéo
«Espace de travail»: faites-vous un «boulot de merde» ? .Julien Brygo et Olivier Cyran sont les auteurs de Boulots de merde ! du cireur au trader, recueil de reportages ayant pour fil rouge la question de l?utilité sociale des métiers. L?un des deux journalistes est l?invité de notre émission « Espace de travail ».
Les plus populaires : Non-fiction
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Olivier Cyran (2)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philosophes au cinéma
Ce film réalisé par Derek Jarman en 1993 retrace la vie d'un philosophe autrichien né à Vienne en 1889 et mort à Cambridge en 1951. Quel est son nom?
Ludwig Wittgenstein
Stephen Zweig
Martin Heidegger
8 questions
160 lecteurs ont répondu
Thèmes :
philosophie
, philosophes
, sociologie
, culture générale
, cinema
, adapté au cinéma
, adaptation
, littératureCréer un quiz sur ce livre160 lecteurs ont répondu