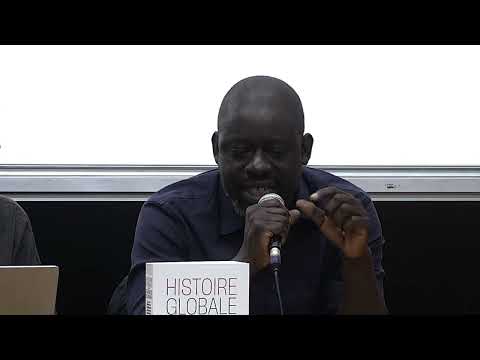Né(e) le : 02/07/1964
Pascal Blanchard est un historien français.
Chercheur au Laboratoire Communication et Politique du CNRS , ancien chercheur au GDR 2322 du CNRS Anthropologie des représentations du corps (à Marseille), Pascal Blanchard co-dirige le Groupe de recherche ACHAC | Colonisation, immigrations et postcolonialisme depuis 1989 (www.achac.com).
Il a réalisé plusieurs expositions sur le thème de la colonisation et de l'immigration, dont Images d'empire (1996), L'appel à l'empire (1997), Images et Colonies (1993). En 2012, il a été le co-commissaire d'exposition avec Nanette Snoep et Lilian Thuram de Exhibitions. L'invention du sauvage au Musée du quai Branly (prix Cristal de la meilleure exposition de l'année).
Il a publié ou co-dirigé une quarantaine d'ouvrages collectifs aux éditions La Découverte dont Zoos Humains (2002), la Fracture coloniale (2005), Ruptures post-coloniales (2010), le Grand Repli (2015) et Vers la guerre des identités ? (2016).
Il a réalisé plusieurs documentaires télévisés (Les Zoos humains (Arte, 2002) ; Paris couleurs (France 3, 2005) ; Des noirs en couleur. L’histoire des joueurs afro-antillais et néo-calédoniens en équipe de France de football, (Canal +, 2008), Noirs de France (France Télévision, 2012) et a collaboré à plus d’une dizaine de films de fiction ou documentaires. Il a également co-réalisé avec Rachid Bouchareb les séries Frères d'Armes, puis Champions de France (France Télévision, 2014 à 2016), deux séries retraçant le parcours de combattants et de sportifs issus de la diversité.
Outre son activité de chercheur et d’historien (docteur en histoire de l’Université Paris I en 1994), il assure une expertise dans le domaine des médias, de la production audiovisuelle et de la communication en tant que concepteur-réalisateur de musées aussi bien en France qu’à l’étranger.
En 2014, il publie avec les journalistes Claude Askolovitch, Renaud Dély et Yvan Gastaut "Les années 30 sont de retour".
Ajouter des informations
Carte blanche à l'ACHAC Modération: Emmanuel LAURENTIN, journaliste et producteur à France Culture Intervenants: Quentin DELUERMOZ, professeur à l'université de Paris Cité, Laurent JEANPIERRE, professeur à l'université Paris 1, Eugénia PALIERAKI, maîtresse de conférences à Cergy Paris Université À l'occasion de la publication de l'ouvrage : Une Histoire globale de la France coloniale dirigé par Nicolas Bancel, Pascal Blanchard, Sandrine Lemaire et Dominic Thomas (Éditions Philippe Rey) Les travaux sur l'histoire coloniale de la France se sont multipliés ces vingt dernières années. Après la publication l'ouvrage Une Histoire globale de la France coloniale, quels sont les enjeux historiographiques et épistémologiques d'une histoire coloniale (et postcoloniale) saisi au prisme de l'histoire transnationale et globale et au regard des enjeux dans les autres en puissances coloniales en Europe ? Comment articuler les différentes trajectoires des empires et les connections multiples qui les lient aux métropoles coloniales et aux autres aires géographiques ? Comment apprécier les flux – hommes, idées, produits – qui circulent au sein et entre ces espaces ?
[La grande librairie, 20 octobre 2021]
(page 95)
(Leïla Slimani, dans "Regard sur une image")
Abandon
Sentir sa raison qui paresse
Et petit à petit s'abaisse
Devant les assauts du cœur
Sentir depuis les profondeurs
Jaillir un torrent de chaleur
Vouloir que jamais il ne cesse
Sentir un ruisseau de tendresse
Déferler en vagues de caresses
Avoir le cœur qui déraisonne
La raison qui s'abandonne
Et tout à coup s'étonne
Devant le cœur qui se donne
Comment ne pas penser que deux siècles d'esclavage et un siècle de colonisation ne sont pas en grande partie responsables du présent ? C'est en encourageant la recherche sur l'anthropologie et la sociologie de ces sociétés , sur la ligne de couleur qui traverse l'identité nationale, sur la survivance d'inégalités dans le foncier, dans l'accès au capital, à l'entreprise, etc., c'est en cessant de traiter ces sociétés comme des sociétés de mendiants que l'esclavage colonial prendra sa place comme organisant le passé sans occulter le présent et l'avenir.

La Grande Librairie 2021-2022
Laurie777
125 livres

Joséphine Baker
Pecosa
30 livres
Démasqué ! 🎭
"Le Masque de la mort rouge" est le titre d'une nouvelle écrite par ...
10 lecteurs ont répondu