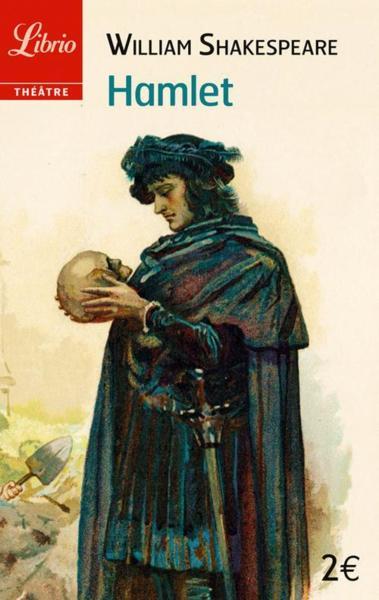>
Critique de Nastasia-B
Que valent nos avis ? Pas grand-chose !...
Ma première rencontre avec le grand Shakespeare remonte aux temps chéris — autant que révolus — de ma fragile innocence, de ma fringante jeunesse sous le ciel immaculé de mes vingt-deux ans. Ce fut avec Hamlet que la rencontre se fit et je lus Hamlet, donc, et il ne me plut point. J'en gardais alors le souvenir d'une déconvenue, de beaucoup de bruit pour rien, d'un texte aux couleurs fades et aux contours ampoulés, bref, d'un redoutable ennui.
Je ne me sentais pourtant pas moins vive en ce temps-là, ni moins prompte à m'enflammer, ni moins sensible aux choses du verbe que je ne le suis actuellement, or — oui or, car il y a un or — or, donc, je ne fus point séduite par le verbe de naguère, qui n'est point si distant, je crois, du verbe de maintenant. Seule ma culture dramatique était à un seuil dramatiquement bas.
Aujourd'hui, forte de quelques plis supplémentaires au coin des yeux et de deux ou trois tragédies ramassées deci-delà sur mon parcours, prise d'un légitime regret je me relance à l'abordage de cette oeuvre.
Certes j'ai pris quelque temps et mis quelque zèle à choisir une traduction qui puisse me convenir. C'est sur celle d'André Marcowicz que j'ai jeté mon dévolu cette fois (l'autre fois c'était celle de François-Victor Hugo).
Et alors ? C'est le jour et la nuit. (Chapeau pour cette traduction Monsieur Marcowicz !) Je n'en reviens pas. Comment peut-on, étant la même personne, ressentir les choses aussi différemment à quelques années d'écart ?
J'ai adoré la légèreté, l'humour, la finesse, la profondeur, la qualité d'écriture de l'ensemble de la pièce (pas trop le final cependant). C'était un autre Hamlet et celui-là j'en garderai un souvenir ému et chaleureux.
Comment vous dire ?... Il y a des poussières d'Hamlet disséminées tellement partout que c'est à peine si j'ose, que je ne sais par où le prendre. Peut-être par le plus futile de tous ? Pourquoi pas ?
Les clins d'oeil à Hamlet sont fréquents dans les oeuvres destinées à la jeunesse.
Goscinny s'en donne à coeur joie dans l'album La Grande Traversée (Parodiant la réplique de Marcelus de l'acte I, le chef viking Øbsen dit en regardant un crâne : « Il y a quelque chøse de pøurri dåns mon røyåume… » Kerøsen quant à lui dit : « Suis-je un décøuvreur øu ne le suis-je pas ?... Être øu ne pås être, telle est lå questiøn… »). de même, tout le scénario du film de Walt Disney le Roi Lion est une resucée quasi-intégrale de la trame d'Hamlet. Même le fantôme du vieil Hamlet apparaissant à son fils a son pendant dans le film. Chez les écrivains un peu plus chevronnés, on peut mentionner que Rudyard Kipling, dans son ouvrage destiné à la jeunesse Histoires Comme Ça, a inséré le fameux poème « IF » qui est très largement inspiré de la tirade de Polonius (Acte I, Scène 3).
Dans la littérature dite adulte, Hamlet, en époux volage, a aussi fait des petits un peu partout (par exemple, la fameuse scène hilarante du chapitre XXXI des Grandes Espérances de Charles Dickens). Mais c'est quoi Hamlet ? À quoi ou à qui peut-il nous faire penser ?
Tout d'abord, si l'on s'intéresse à sa filiation, et l'on sait à quel point Shakespeare était féru de tragédie grecque, on y voit une ascendance très nette en la personne d'Oreste. Lui aussi est fils d'un roi qui s'est fait trucider et dont la mère s'est remariée au nouveau souverain usurpateur. (Oreste, fils d'Agamemnon et de Clytemnestre, frère d'Électre ne supporte pas l'assassinat de son père et décide de devenir le meurtrier de sa mère qui a fomenté le régicide.)
Le thème de la trahison, du doublage par un frère (le vieil Hamlet est assassiné par son frère Claudius) est un thème qui semble fort et important pour l'auteur (cf. Le Roi Lear, Jules César, etc.), c'est d'ailleurs le corps de l'ultime drame de Shakespeare, La Tempête, où Prospero a échappé in extremis à la mort et s'est fait subtiliser le trône par son frère.
Le thème de la mort, ou plus particulièrement de l'inutilité de la vie, est également un sujet de prédilection du grand dramaturge anglais et qui figure au coeur d'Hamlet, d'où cette fameuse tirade du « être ou ne pas être ».
Mais si tout cela est vrai et fort, ce qui me semble plus fort et plus évident que tout — et qui m'avait totalement échappé à la première lecture — c'est la réflexion sur le théâtre qui est contenue dans cette tragi-comédie et c'est la théorie que je vais défendre ci-dessous.
Pour bien analyser la question, observons l'architecture, la structure de l'oeuvre :
Acte I — révélation du meurtre de son père à Hamlet et de l'usurpation de son trône. Hamlet est par conséquent renvoyé à un rôle subalterne.
Acte II — la « folie » d'Hamlet, prise de position sur le théâtre et mise en abîme (le théâtre montre le théâtre). Révélation du stratagème du « théâtre » du roi et de la reine pour cerner Hamlet dans ses amours. Mise en évidence d'un double discours dans ce « théâtre ». Incompréhension d'Hamlet et d'Ophélie.
Acte III — Hamlet, à son tour, utilise le stratagème du théâtre. le théâtre apparaît alors en tant que révélateur de la vérité de l'âme humaine derrière les apparences. Révélation de leur propre trahison au roi et à la reine. Assassinat par Hamlet de Polonius, le courtisan intéressé et qui s'était caché.
Acte IV — le pouvoir veut emmener Hamlet en Angleterre pour le tuer. Réapparition de Laërte, fils de Polonius, sorte de dédoublement d'Hamlet, qui lui aussi veut venger la mort de son père.
Acte V — On en a oublié Ophélie qui meurt sans qu'on s'en soit trop occupé, on ne sait que la pleurer. Réflexion sur la mort à l'occasion de l'enterrement d'Ophélie. Combat organisé par le roi entre Hamlet et Laërte. Mort des deux opposants qui entraînent dans leur fin celle du roi.
Voilà, très grossièrement l'ossature de la pièce. Permettez-moi simplement maintenant de vous dire ce que ces personnages m'évoquent :
Hamlet, C'EST le théâtre, dans l'acception la plus noble du terme. C'est lui le révélateur, c'est lui qui voit clair dans le jeu orchestré par le roi et c'est lui qui est déchu par la vilenie du pouvoir.
Le roi symbolise évidemment le pouvoir, en tant qu'autorité qui muselle l'activité artistique de peur qu'elle ne montre trop explicitement ses propres exactions.
Laërte, c'est l'autre théâtre, le théâtre d'état, le théâtre qui dit ce que le roi veut entendre, celui qui est aux bottes du pouvoir.
Les deux théâtres se livrent une lutte à mort, et qui est sacrifié au milieu d'eux ? le public, évidemment, et ici le public est symbolisé par Ophélie, qui devient folle.
La reine représente la conscience, la morale à qui l'on a tordu le cou pour avaler des couleuvres.
Polonius représente les seconds couteaux, le peuple nombreux des courtisans hypocrites qui lèchent les savates de tout pouvoir, quel qu'il soit, et qui se font étriller par le théâtre (pensez aux bourgeois, aux savants ou aux religieux chez Molière, par exemple) car si l'on ne peut taper sur le pouvoir, on peut tout de même se faire la main sur les courtisans. Mais on peut aussi (et surtout) voir dans Polonius, l'archétype du puritain (voir les conseils qu'il donne à son fils), très en vogue et toujours plus près du pouvoir à l'époque de Shakespeare.
Et la moralité de tout cela, c'est qu'un pouvoir qui n'est pas capable de se regarder en face sous le révélateur, sous le miroir de vérité qu'est le théâtre, tellement il a honte de lui-même est voué à disparaître.
Pour conclure, si l'on recontextualise la genèse de cette pièce avec les événements historiques dont l'auteur était le témoin, ce qu'il faut voir dans Hamlet, ce n'est ni une tragédie (ou tragi-comédie), ni un quelconque message métaphysique, mais bien plutôt une supplique politique pour maintenir les théâtres publics élisabéthains et leur liberté d'expression face aux attaques toujours plus virulentes des puritains qui essaient d'imposer leur théâtre moralisateur. On sait par ailleurs que les craintes de Shakespeare étaient fondées car les puritains obtiendront gain de cause avec la fermeture des théâtres publics en 1642 (notamment le Théâtre du Globe où était joué Shakespeare).
Vu comme cela, cette pièce est absolument lumineuse, forte, pleine de sens et de désillusions, bref, essentielle. Une oeuvre, donc, qu'il faut absolument lire, mais, comme je l'ai expérimenté moi-même, peut-être pas trop tôt et pas sans s'être muni au préalable d'une petite patine en matière de théâtre, du moins c'est mon minuscule avis face à cette immense pièce, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Ma première rencontre avec le grand Shakespeare remonte aux temps chéris — autant que révolus — de ma fragile innocence, de ma fringante jeunesse sous le ciel immaculé de mes vingt-deux ans. Ce fut avec Hamlet que la rencontre se fit et je lus Hamlet, donc, et il ne me plut point. J'en gardais alors le souvenir d'une déconvenue, de beaucoup de bruit pour rien, d'un texte aux couleurs fades et aux contours ampoulés, bref, d'un redoutable ennui.
Je ne me sentais pourtant pas moins vive en ce temps-là, ni moins prompte à m'enflammer, ni moins sensible aux choses du verbe que je ne le suis actuellement, or — oui or, car il y a un or — or, donc, je ne fus point séduite par le verbe de naguère, qui n'est point si distant, je crois, du verbe de maintenant. Seule ma culture dramatique était à un seuil dramatiquement bas.
Aujourd'hui, forte de quelques plis supplémentaires au coin des yeux et de deux ou trois tragédies ramassées deci-delà sur mon parcours, prise d'un légitime regret je me relance à l'abordage de cette oeuvre.
Certes j'ai pris quelque temps et mis quelque zèle à choisir une traduction qui puisse me convenir. C'est sur celle d'André Marcowicz que j'ai jeté mon dévolu cette fois (l'autre fois c'était celle de François-Victor Hugo).
Et alors ? C'est le jour et la nuit. (Chapeau pour cette traduction Monsieur Marcowicz !) Je n'en reviens pas. Comment peut-on, étant la même personne, ressentir les choses aussi différemment à quelques années d'écart ?
J'ai adoré la légèreté, l'humour, la finesse, la profondeur, la qualité d'écriture de l'ensemble de la pièce (pas trop le final cependant). C'était un autre Hamlet et celui-là j'en garderai un souvenir ému et chaleureux.
Comment vous dire ?... Il y a des poussières d'Hamlet disséminées tellement partout que c'est à peine si j'ose, que je ne sais par où le prendre. Peut-être par le plus futile de tous ? Pourquoi pas ?
Les clins d'oeil à Hamlet sont fréquents dans les oeuvres destinées à la jeunesse.
Goscinny s'en donne à coeur joie dans l'album La Grande Traversée (Parodiant la réplique de Marcelus de l'acte I, le chef viking Øbsen dit en regardant un crâne : « Il y a quelque chøse de pøurri dåns mon røyåume… » Kerøsen quant à lui dit : « Suis-je un décøuvreur øu ne le suis-je pas ?... Être øu ne pås être, telle est lå questiøn… »). de même, tout le scénario du film de Walt Disney le Roi Lion est une resucée quasi-intégrale de la trame d'Hamlet. Même le fantôme du vieil Hamlet apparaissant à son fils a son pendant dans le film. Chez les écrivains un peu plus chevronnés, on peut mentionner que Rudyard Kipling, dans son ouvrage destiné à la jeunesse Histoires Comme Ça, a inséré le fameux poème « IF » qui est très largement inspiré de la tirade de Polonius (Acte I, Scène 3).
Dans la littérature dite adulte, Hamlet, en époux volage, a aussi fait des petits un peu partout (par exemple, la fameuse scène hilarante du chapitre XXXI des Grandes Espérances de Charles Dickens). Mais c'est quoi Hamlet ? À quoi ou à qui peut-il nous faire penser ?
Tout d'abord, si l'on s'intéresse à sa filiation, et l'on sait à quel point Shakespeare était féru de tragédie grecque, on y voit une ascendance très nette en la personne d'Oreste. Lui aussi est fils d'un roi qui s'est fait trucider et dont la mère s'est remariée au nouveau souverain usurpateur. (Oreste, fils d'Agamemnon et de Clytemnestre, frère d'Électre ne supporte pas l'assassinat de son père et décide de devenir le meurtrier de sa mère qui a fomenté le régicide.)
Le thème de la trahison, du doublage par un frère (le vieil Hamlet est assassiné par son frère Claudius) est un thème qui semble fort et important pour l'auteur (cf. Le Roi Lear, Jules César, etc.), c'est d'ailleurs le corps de l'ultime drame de Shakespeare, La Tempête, où Prospero a échappé in extremis à la mort et s'est fait subtiliser le trône par son frère.
Le thème de la mort, ou plus particulièrement de l'inutilité de la vie, est également un sujet de prédilection du grand dramaturge anglais et qui figure au coeur d'Hamlet, d'où cette fameuse tirade du « être ou ne pas être ».
Mais si tout cela est vrai et fort, ce qui me semble plus fort et plus évident que tout — et qui m'avait totalement échappé à la première lecture — c'est la réflexion sur le théâtre qui est contenue dans cette tragi-comédie et c'est la théorie que je vais défendre ci-dessous.
Pour bien analyser la question, observons l'architecture, la structure de l'oeuvre :
Acte I — révélation du meurtre de son père à Hamlet et de l'usurpation de son trône. Hamlet est par conséquent renvoyé à un rôle subalterne.
Acte II — la « folie » d'Hamlet, prise de position sur le théâtre et mise en abîme (le théâtre montre le théâtre). Révélation du stratagème du « théâtre » du roi et de la reine pour cerner Hamlet dans ses amours. Mise en évidence d'un double discours dans ce « théâtre ». Incompréhension d'Hamlet et d'Ophélie.
Acte III — Hamlet, à son tour, utilise le stratagème du théâtre. le théâtre apparaît alors en tant que révélateur de la vérité de l'âme humaine derrière les apparences. Révélation de leur propre trahison au roi et à la reine. Assassinat par Hamlet de Polonius, le courtisan intéressé et qui s'était caché.
Acte IV — le pouvoir veut emmener Hamlet en Angleterre pour le tuer. Réapparition de Laërte, fils de Polonius, sorte de dédoublement d'Hamlet, qui lui aussi veut venger la mort de son père.
Acte V — On en a oublié Ophélie qui meurt sans qu'on s'en soit trop occupé, on ne sait que la pleurer. Réflexion sur la mort à l'occasion de l'enterrement d'Ophélie. Combat organisé par le roi entre Hamlet et Laërte. Mort des deux opposants qui entraînent dans leur fin celle du roi.
Voilà, très grossièrement l'ossature de la pièce. Permettez-moi simplement maintenant de vous dire ce que ces personnages m'évoquent :
Hamlet, C'EST le théâtre, dans l'acception la plus noble du terme. C'est lui le révélateur, c'est lui qui voit clair dans le jeu orchestré par le roi et c'est lui qui est déchu par la vilenie du pouvoir.
Le roi symbolise évidemment le pouvoir, en tant qu'autorité qui muselle l'activité artistique de peur qu'elle ne montre trop explicitement ses propres exactions.
Laërte, c'est l'autre théâtre, le théâtre d'état, le théâtre qui dit ce que le roi veut entendre, celui qui est aux bottes du pouvoir.
Les deux théâtres se livrent une lutte à mort, et qui est sacrifié au milieu d'eux ? le public, évidemment, et ici le public est symbolisé par Ophélie, qui devient folle.
La reine représente la conscience, la morale à qui l'on a tordu le cou pour avaler des couleuvres.
Polonius représente les seconds couteaux, le peuple nombreux des courtisans hypocrites qui lèchent les savates de tout pouvoir, quel qu'il soit, et qui se font étriller par le théâtre (pensez aux bourgeois, aux savants ou aux religieux chez Molière, par exemple) car si l'on ne peut taper sur le pouvoir, on peut tout de même se faire la main sur les courtisans. Mais on peut aussi (et surtout) voir dans Polonius, l'archétype du puritain (voir les conseils qu'il donne à son fils), très en vogue et toujours plus près du pouvoir à l'époque de Shakespeare.
Et la moralité de tout cela, c'est qu'un pouvoir qui n'est pas capable de se regarder en face sous le révélateur, sous le miroir de vérité qu'est le théâtre, tellement il a honte de lui-même est voué à disparaître.
Pour conclure, si l'on recontextualise la genèse de cette pièce avec les événements historiques dont l'auteur était le témoin, ce qu'il faut voir dans Hamlet, ce n'est ni une tragédie (ou tragi-comédie), ni un quelconque message métaphysique, mais bien plutôt une supplique politique pour maintenir les théâtres publics élisabéthains et leur liberté d'expression face aux attaques toujours plus virulentes des puritains qui essaient d'imposer leur théâtre moralisateur. On sait par ailleurs que les craintes de Shakespeare étaient fondées car les puritains obtiendront gain de cause avec la fermeture des théâtres publics en 1642 (notamment le Théâtre du Globe où était joué Shakespeare).
Vu comme cela, cette pièce est absolument lumineuse, forte, pleine de sens et de désillusions, bref, essentielle. Une oeuvre, donc, qu'il faut absolument lire, mais, comme je l'ai expérimenté moi-même, peut-être pas trop tôt et pas sans s'être muni au préalable d'une petite patine en matière de théâtre, du moins c'est mon minuscule avis face à cette immense pièce, c'est-à-dire, pas grand-chose.