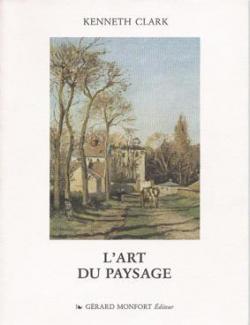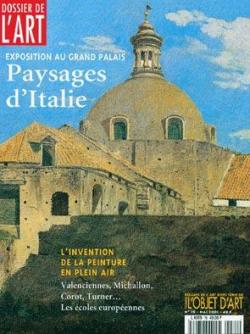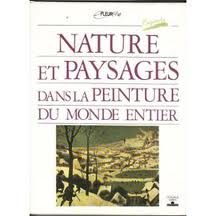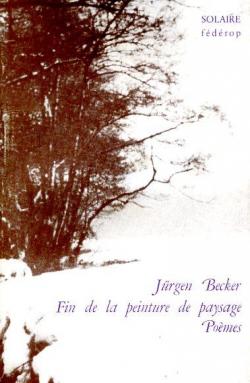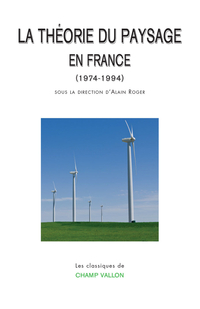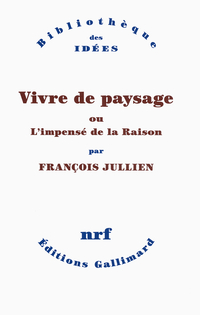Grandeur Nature : le Paysage
57 livres. Thèmes et genres : nature , paysages , histoire de l'art , beaux-arts , philosophie
Lectures où il est question de la nature et du paysage ; de l'évolution de la représentation du paysage présent dans les arts depuis l'antiquité (peinture, littérature), d'abord à l'arrière-plan et utilisé comme décor dans le tableau, le paysage n'en devient le sujet principal que très tardivement. Le genre "paysage", consacré par la littérature, n'a définitivement conquis ses lettres de noblesse qu'au début du XIXe siècle avec le romantisme et l'école de Barbizon. Le paysage classique puis le paysage sublime finissent par déserter peu à peu la peinture. Les impressionnistes puis les Nabis se ressaisissent du genre pour le reformuler. Avec l'art moderne l'intérêt pour le paysage trouve une nouvelle fortune au XXe siècle.
L'histoire qui lui accorde une dimension patrimoniale (Pierre Nora), et une autre tendance plus récente, sous la pression écologique, voit l'émergence d'une conscience paysagère amenant de nouvelles manières de penser et de traiter le paysage dans les espaces contemporains. Une très grande diversité de livres sont parus sur le sujet, ces dernières années. Des beaux-arts aux sciences humaines ou sociales : le paysage, une quête éternelle de la nature, entre reconquête et recomposition.
(Image : Gustave Doré, Lac en Ecosse après l'orage, 1875-1878, musée de Grenoble)
Alain Mérot
Kenneth Clark
Palais des Beaux-arts de Lille
Bernard Biard
Bernard Biard
Jean-Michel Croisille
Patrick Lhot
L'Objet d'Art
Janine Bailly-Herzberg
Nicole Garnier-Pelle
Aline François-Colin
Piero Camporesi
Galeries Nationales du Grand Palais
Dossier de l'art
Yvon Le Scanff
Caspar David Friedrich
Claude Fournet
Michel Collot
Arlette Bouloumié
Musée des Beaux-Arts - Paris
Musées de Strasbourg
Nils Büttner
Patrick Ringgenberg
Norbert Wolf
Michel Baridon
Jack Richardson
Christophe Domino
Jean Mottet
Eric Costeix
Serge Meitinger
Anne Cauquelin
Joachim Ritter
Raffaele Milani
Alain Roger
Alain Roger
Gilles Clément
Jean-Robert Pitte
Augustin Berque
Catherine Grout
François Jullien
Michel Racine
Michel Racine
Michel Collot
Michel Godron
Jean-Pierre Le Dantec
Christian Carle
Michel Corajoud
Augustin Berque
Anne Fortier-Kriegel
Pierre Sansot
José-Luis de Los Llanos
Jean Bouret
Manola Antonioli
Guy Cogeval
Pierre Wat