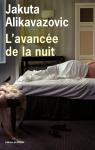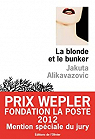Critiques de Jakuta Alikavazovic (105)
Serait-il tendance de passer la nuit dans un musée ? Après Leila Slimani et son séjour nocturne dans un musée vénitien, c’est Jakuta Alikavazovic qui prend le relais en choisissant cette fois le Louvre.
A partir de quelques œuvres choisies en raison de ce qu’elles représentent dans l’imaginaire de l’auteur, et des représentations issues de ce que ces oeuvres signifiaient pour son père, l’auteur revient sur son enfance, celle d’une fillette réfugiée, dont l’institutrice affirma qu’elle ne parlerait jamais le français ! Belle revanche, des années plus tard, que l’obtention d’un Goncourt du premier roman !
Les souvenirs affluent donc, dressant le portrait du père, esthète et voleur, une sorte de gentleman cambrioleur …
Mais au-delà de cet hommage, se cachent les motivations de cet enfermement volontaire : et la petite phrase qui revient :
« Et toi, comment tu t’y prendrais, pour voler la Joconde ? », occasion pour l’auteur de revenir sur ce fait divers du début du vingtième siècle, qui fut une des raisons du futur succès de cette oeuvre de de Vinci.
Mais il faudra attendre les dernières pages pour en savoir plus ….
Hormis les qualités de conteuse de Jakuta Alikavazovic, et ce bel hommage à son père, j’ai trouvé assez peu d’intérêt au récit, d’autant que Le parfum des fleurs la nuit avait déjà utilisé le même procédé pour évoquer des souvenirs d’enfance.
Lien : https://kittylamouette.blogs..
A partir de quelques œuvres choisies en raison de ce qu’elles représentent dans l’imaginaire de l’auteur, et des représentations issues de ce que ces oeuvres signifiaient pour son père, l’auteur revient sur son enfance, celle d’une fillette réfugiée, dont l’institutrice affirma qu’elle ne parlerait jamais le français ! Belle revanche, des années plus tard, que l’obtention d’un Goncourt du premier roman !
Les souvenirs affluent donc, dressant le portrait du père, esthète et voleur, une sorte de gentleman cambrioleur …
Mais au-delà de cet hommage, se cachent les motivations de cet enfermement volontaire : et la petite phrase qui revient :
« Et toi, comment tu t’y prendrais, pour voler la Joconde ? », occasion pour l’auteur de revenir sur ce fait divers du début du vingtième siècle, qui fut une des raisons du futur succès de cette oeuvre de de Vinci.
Mais il faudra attendre les dernières pages pour en savoir plus ….
Hormis les qualités de conteuse de Jakuta Alikavazovic, et ce bel hommage à son père, j’ai trouvé assez peu d’intérêt au récit, d’autant que Le parfum des fleurs la nuit avait déjà utilisé le même procédé pour évoquer des souvenirs d’enfance.
Lien : https://kittylamouette.blogs..
Paul rencontre Amélia , une égérie rousse, sur les bancs de l’université.
Fasciné par l’enigmatique créature, il en tombe immédiatement amoureux plus par amour des contraires : ils n’ont rien de commun, que de l’ombre, de la peur, des doutes et de l’injustice...
Étudiant le jour , il est gardien dans un hôtel la nuit.
Elle est tout ce qu’il n’est pas : un père fortuné, une éducation soignée, une mère poétesse, aventurière, exploratrice , une voyageuse disparue. Elle avait quitté sa province à la fin des années 60 comme on quitte une robe trop petite .....Amélia faisait preuve, dans ce tohu-bohu, d’une indépendance inouïe .
Chaque soir Paul la retrouve à la réception...
Ils s’aiment passionnément.
« Lui voulait absorber sa vie, ses humeurs, voir ce qu’elle voyait, savoir ce qu’elle savait ... »
Les phrases mêlent le doute, l’hésitation, les retours, ce roman se mérite par une lecture extrêmement exigeante, abordant mille et un sujets , complexes, nombreux, à l’aide d’un style serré,dense, unique .
Le lecteur doit se concentrer au risque de recommencer sa page , au début, cela s’avère compliqué et aventureux ....
Amélia est sophistiquée, érudite , richissime , héritière des hôtels Élisse, élevée dans une espèce de chaos , résultat de l'absence maternelle.
Paul est un garçon de peu, veilleur de nuit, faute de transmission.Il avait honte de l’endroit d'où il venait : un désastre urbain, dangers ,jungle, disfonctionnements .
Ces deux- là se repoussent, s’aimantent , manipulés par leurs propres fantômes : lui, ses peurs et ses hontes , sa difficulté à exister et son rapport aux femmes , : elle , qui mène la danse et déserte pour partir subitement à Sarajevo, à la recherche de sa mère, dans la brutalité de la mort, de la fuite et de la guerre .Je n’en dirai pas plus ...
L’auteur brasse mille et un thèmes au sein d’un récit ardu,mystérieux , sur le fil, sinueux , à l’affut d’une femme rétive et fantasque et celui d’un couple tumultueux ..
Difficile à lire et à critiquer :
« Leur amour: un souvenir, un fantôme , le champ d’une force encore inconnue ...Une issue peut- être ... »
« Elle était de ces gens qui détruisent tout et appellent ça de l’art .. »
Une lecture casse- cou qui ne peut laisser personne indiffèrent ou pas,...
Fasciné par l’enigmatique créature, il en tombe immédiatement amoureux plus par amour des contraires : ils n’ont rien de commun, que de l’ombre, de la peur, des doutes et de l’injustice...
Étudiant le jour , il est gardien dans un hôtel la nuit.
Elle est tout ce qu’il n’est pas : un père fortuné, une éducation soignée, une mère poétesse, aventurière, exploratrice , une voyageuse disparue. Elle avait quitté sa province à la fin des années 60 comme on quitte une robe trop petite .....Amélia faisait preuve, dans ce tohu-bohu, d’une indépendance inouïe .
Chaque soir Paul la retrouve à la réception...
Ils s’aiment passionnément.
« Lui voulait absorber sa vie, ses humeurs, voir ce qu’elle voyait, savoir ce qu’elle savait ... »
Les phrases mêlent le doute, l’hésitation, les retours, ce roman se mérite par une lecture extrêmement exigeante, abordant mille et un sujets , complexes, nombreux, à l’aide d’un style serré,dense, unique .
Le lecteur doit se concentrer au risque de recommencer sa page , au début, cela s’avère compliqué et aventureux ....
Amélia est sophistiquée, érudite , richissime , héritière des hôtels Élisse, élevée dans une espèce de chaos , résultat de l'absence maternelle.
Paul est un garçon de peu, veilleur de nuit, faute de transmission.Il avait honte de l’endroit d'où il venait : un désastre urbain, dangers ,jungle, disfonctionnements .
Ces deux- là se repoussent, s’aimantent , manipulés par leurs propres fantômes : lui, ses peurs et ses hontes , sa difficulté à exister et son rapport aux femmes , : elle , qui mène la danse et déserte pour partir subitement à Sarajevo, à la recherche de sa mère, dans la brutalité de la mort, de la fuite et de la guerre .Je n’en dirai pas plus ...
L’auteur brasse mille et un thèmes au sein d’un récit ardu,mystérieux , sur le fil, sinueux , à l’affut d’une femme rétive et fantasque et celui d’un couple tumultueux ..
Difficile à lire et à critiquer :
« Leur amour: un souvenir, un fantôme , le champ d’une force encore inconnue ...Une issue peut- être ... »
« Elle était de ces gens qui détruisent tout et appellent ça de l’art .. »
Une lecture casse- cou qui ne peut laisser personne indiffèrent ou pas,...
Voilà un livre bien intéressant et diablement bien écrit.
Jakuta Alikavazovic – un nom imprononçable comme l’aurait dit l’un des jurés d’un prix littéraire à l’autrice (votre livre est très bon, mais j’aurais trop peur de ne pas savoir le prononcer, aurait-il dit) – accepte l’invitation des Editions Stock de passer une nuit dans un musée et d’en rendre compte par l’écrit.
Pour elle ce sera le Louvre. Une nuit donc pour parcourir à nouveau les galeries du Louvre et spécifiquement le salon qui accueille la Joconde, et celui de la Vénus de Milo. Parcourir à nouveau parce que ce trajet l’autrice l’a fait de très nombreuses fois quand, enfant, son père peintre l’emmenait avec lui et lui posait une question rituelle : « Et toi, comment t’y prendrais-tu, pour voler la Joconde ? ». Une nuit pour évoquer ses souvenirs, une nuit pour revivre une enfance qu’elle revisite pendant ces quelques heures seules face aux œuvres qu’elle connaît bien.
Cette nuit au musée est donc notamment l’occasion pour l’autrice de faire le portrait de son père, ce père yougoslave arrivé en France à l’âge de vingt ans, ce père peintre – mais « peintre en bâtiment » comme les gens le pensent facilement dans ces années là pour un « Yougo » émigré en France, un père énigme pour sa fille qui lui faisait passer des tests pour voir si elle avait tout vu à l’intérieur d’un tableau, et qu’elle avait enregistré la configuration des salons dans l’idée de voler le célèbre tableau.
La Joconde d’ailleurs, comme l’autrice nous le rappelle, qui fit l’objet d’un vol par un peintre en bâtiment (cette fois-là un vrai) italien, un certain Vincenzo Peruggia dont le nom sera mal orthographié sur sa fiche de police, qui voulait « ramener la peinture à sa patrie ». Il se passera deux ans avant que la police ne découvre l’auteur du vol, et c’est l’occasion pour Jakuta Alikavazovic de s’interroger sur "ce que cela fait", de dormir en ayant le précieux tableau caché sous son lit.
Dans « Comme un ciel en nous » nous suivons donc l’autrice dans son introspection sur les traces de l’énigme de ce père admiré puis honni par sa fille : l’autrice traite du thème de l’exil – peut-on tout oublier de sa vie d’avant dans un contexte de guerre pour se fondre dans une vie parisienne – de son rapport à l’art, de littérature, de solitude et même d’un éventuel vol de tableau auquel son père aurait pu être mêlé.
Au passage elle raconte cette anecdote au cours de laquelle, petite, son père l’avait conduite au Louvre et l’avait laissé pendant quelques temps au pied de la Joconde, lui intimant de l’attendre. Mais ce père ne revenait pas et les gardiens s’étaient émus de cette fille qui ne voulait pour rien au monde quitter l’endroit où elle était censée retrouver son paternel. Celui-ci avait fini par arriver, au moment où la petite s’arcboutait sur son ancrage au près du célèbre tableau – pas question de faillir au serment de ne pas bouger en l’attendant.
Avec beaucoup de style, l’autrice dresse aussi un portrait de cette France des années 70 où les émigrés yougoslaves tentent de se fondre dans la masse, de se faire oublier, et où les enfants tentent de jouer la partition que leur propose la République en réussissant à l’école malgré les paroles calamiteuses d’une institutrice qui déclarera devant son père « Cette petite ne parlera jamais français ». Et de raconter le dilemme de ce père, tenu d’oublier sa propre langue, ses souvenirs, son deuil des parents laissés là-bas, pour se consacrer à l’apprentissage d’une langue dans laquelle il ne pourra que maladroitement transmettre ses émotions intimes à sa propre fille.
Jakuta Alikavazovic livre ici un récit plein de pudeur et de tendresse pour un père un père disparu, examinant le temps d’une nuit tous les malentendus et incompréhensions mutuels qu’ils ont pu entretenir.
Il restera une dernière énigme à nous livrer : l’autrice a réussi à introduire un objet caché dans son sac de voyage, un objet qu’elle ne nous dévoilera pas, qui lui servira pourtant a laissé une trace sur place, nous bornant à quelques conjonctures sur sa nature, mais avec l’intuition qu’il lui aura permis d’adresser un dernier signe à ce père disparu.
On peut comprendre à la fin que ce récit est une ultime tentative pour le rejoindre par le truchement de l’écriture - et c'est magistralement réussi.
Jakuta Alikavazovic – un nom imprononçable comme l’aurait dit l’un des jurés d’un prix littéraire à l’autrice (votre livre est très bon, mais j’aurais trop peur de ne pas savoir le prononcer, aurait-il dit) – accepte l’invitation des Editions Stock de passer une nuit dans un musée et d’en rendre compte par l’écrit.
Pour elle ce sera le Louvre. Une nuit donc pour parcourir à nouveau les galeries du Louvre et spécifiquement le salon qui accueille la Joconde, et celui de la Vénus de Milo. Parcourir à nouveau parce que ce trajet l’autrice l’a fait de très nombreuses fois quand, enfant, son père peintre l’emmenait avec lui et lui posait une question rituelle : « Et toi, comment t’y prendrais-tu, pour voler la Joconde ? ». Une nuit pour évoquer ses souvenirs, une nuit pour revivre une enfance qu’elle revisite pendant ces quelques heures seules face aux œuvres qu’elle connaît bien.
Cette nuit au musée est donc notamment l’occasion pour l’autrice de faire le portrait de son père, ce père yougoslave arrivé en France à l’âge de vingt ans, ce père peintre – mais « peintre en bâtiment » comme les gens le pensent facilement dans ces années là pour un « Yougo » émigré en France, un père énigme pour sa fille qui lui faisait passer des tests pour voir si elle avait tout vu à l’intérieur d’un tableau, et qu’elle avait enregistré la configuration des salons dans l’idée de voler le célèbre tableau.
La Joconde d’ailleurs, comme l’autrice nous le rappelle, qui fit l’objet d’un vol par un peintre en bâtiment (cette fois-là un vrai) italien, un certain Vincenzo Peruggia dont le nom sera mal orthographié sur sa fiche de police, qui voulait « ramener la peinture à sa patrie ». Il se passera deux ans avant que la police ne découvre l’auteur du vol, et c’est l’occasion pour Jakuta Alikavazovic de s’interroger sur "ce que cela fait", de dormir en ayant le précieux tableau caché sous son lit.
Dans « Comme un ciel en nous » nous suivons donc l’autrice dans son introspection sur les traces de l’énigme de ce père admiré puis honni par sa fille : l’autrice traite du thème de l’exil – peut-on tout oublier de sa vie d’avant dans un contexte de guerre pour se fondre dans une vie parisienne – de son rapport à l’art, de littérature, de solitude et même d’un éventuel vol de tableau auquel son père aurait pu être mêlé.
Au passage elle raconte cette anecdote au cours de laquelle, petite, son père l’avait conduite au Louvre et l’avait laissé pendant quelques temps au pied de la Joconde, lui intimant de l’attendre. Mais ce père ne revenait pas et les gardiens s’étaient émus de cette fille qui ne voulait pour rien au monde quitter l’endroit où elle était censée retrouver son paternel. Celui-ci avait fini par arriver, au moment où la petite s’arcboutait sur son ancrage au près du célèbre tableau – pas question de faillir au serment de ne pas bouger en l’attendant.
Avec beaucoup de style, l’autrice dresse aussi un portrait de cette France des années 70 où les émigrés yougoslaves tentent de se fondre dans la masse, de se faire oublier, et où les enfants tentent de jouer la partition que leur propose la République en réussissant à l’école malgré les paroles calamiteuses d’une institutrice qui déclarera devant son père « Cette petite ne parlera jamais français ». Et de raconter le dilemme de ce père, tenu d’oublier sa propre langue, ses souvenirs, son deuil des parents laissés là-bas, pour se consacrer à l’apprentissage d’une langue dans laquelle il ne pourra que maladroitement transmettre ses émotions intimes à sa propre fille.
Jakuta Alikavazovic livre ici un récit plein de pudeur et de tendresse pour un père un père disparu, examinant le temps d’une nuit tous les malentendus et incompréhensions mutuels qu’ils ont pu entretenir.
Il restera une dernière énigme à nous livrer : l’autrice a réussi à introduire un objet caché dans son sac de voyage, un objet qu’elle ne nous dévoilera pas, qui lui servira pourtant a laissé une trace sur place, nous bornant à quelques conjonctures sur sa nature, mais avec l’intuition qu’il lui aura permis d’adresser un dernier signe à ce père disparu.
On peut comprendre à la fin que ce récit est une ultime tentative pour le rejoindre par le truchement de l’écriture - et c'est magistralement réussi.
[Acquis 10 octobre 2021 / Librairie Caractères- Issy-les-Moulineaux ]
Un nouveau texte acquis dans cette excellente collection que j’affectionne spécialement… »Ma nuit au musée » !
Ouvrage poignant aux multiples récits et tons, intime essentiellement mais aussi historique, sociologique , philosophique, mêlant gravité, tendresse, et quelque cocasserie avec un brin de « provoc. » et d’esprit de transgression !
Une nuit entière, seule au Louvre est proposée à notre auteure… ce qui la réjouit et la ramène à son amour pour son père, qui adorait ce musée-ville et rêvait de « voler » la Joconde !!!
La phrase-jeu de son père quand ils arrivaient au Louvre : « Et toi, comment tu t’y prendrais, pour voler la Joconde ? Dans cet amour pour ce père, il y a tant et tant de sentiments intenses et contrastés.
Un « papa » yougoslave qui a dû se reconstruire, se réinventer totalement ; Père ayant fui son pays pour rejoindre Paris avec sa bien-aimée, fuite aussi d’un service militaire, et puis la guerre fratricide… qui détruira en profondeur cette famille, dont la mère de l’auteure, écrasée par le chagrin des proches assassinés… qu’elle n’a pu sauver !
Un hommage à un père, figure vénérée et adorée… des souvenirs tristes ou joyeux, le plus souvent reliés à ce Musée du Louvre ! Que le père étudie le français, seul, en lisant des biographies de peintres ou livres sur l’Art … ou qu’il emmène sa fille , voir les œuvres, dont cette « Joconde » tant convoitée !!!, ou même qu’il l’oublie dans ce même Louvre, lieu absolu des rêves paternels…Le lieu central est ce Gigantesque Louvre, consolation et refuge car espace consacré à la Beauté, où le père s’évade !
« Un jour, je devais avoir huit ou dix ans, mon père m'a oubliée au Louvre. Curieusement, ce n'est pas un mauvais souvenir. Reste avec elle, d'accord, j'ai un coup de téléphone à passer, je reviens. -Elle- c'était la Vénus de Milo. Elle faisait partie de la famille.
Je me suis assise et j'ai attendu. Ce n'était pas difficile pour moi d'attendre et je n'y pensais même pas en ces termes. J'aurais sans doute dit que je regardais. Je regardais les oeuvres. Je regardais les gens. (p. 79)”
Une nuit d’instrospection de Yakuta Alikavazovic sur sa vie, ses rapports passionnés au père, ses questionnements sur les Pouvoirs de l’Art, tant pour les personnes, intimement , que sur le pouvoir brut ,de beaucoup de pays belligérants , au fil des siècles, s’affirmant ainsi, un peu plus, sur les pays annexés , pillant, ou dérobant des œuvres dans les musées…, des observations fréquentes sur l’exil de sa terre d’origine,les guerres fratricides, le racisme ordinaire vécu, et enfin, la Culture, la Beauté de l’Art, facteurs de « baumes guérisseurs » et d’intégration…
« Que transmet-on à sa fille, sa fille unique, quand on a renié son passé ? Quand on a pu ou cru pouvoir se réinventer, dans un autre pays, une autre langue ? Mon père m'emmenait au Louvre. L'histoire de l'art est une histoire de fantômes pour grandes personnes, me disait-il. L'histoire de l'art, c'est ce qu'il m'a transmis à la place de son histoire à lui, savamment effacée et redessinée au gré du temps. (p. 34)”
Un moment très fort de lecture qui m’a fait connaître pour la première fois cette auteure, qui offre à son père, au-delà de l’absence, un texte magnifique de tendresse et d’admiration, même si il y a eu , à une période donnée, des moments de tangage pour construire sa vie de femme ! Nécessité de s’éloigner… pour mieux revenir vers ce père atypique et très aimant !
Quelle belle revanche , de surplus, en lisant que cette petite fille, à qui une institutrice peu bienveillante, avait prédit de ne jamais pouvoir apprendre le Français…est devenue une écrivaine talentueuse et reconnue !
Un style énergique, fluide, mêlant gravité et légèreté…Toutefois on sent très fort que ce « papa » déraciné , a dû sûrement être très seul intérieurement ; cela ne l’a pas freiné pour tout faire, afin de transmettre le meilleur à sa fille unique !
« Rien de tel chez mon père; au contraire, la maison qu'il professait s'être choisie, c'était le Louvre, justement; si tant est que l'on puisse choisir de s'établir non dans un pays mais dans un art, non dans une nation mais dans la beauté. Et malgré cela, malgré tout, la question de l'appartenance finit un jour ou l'autre par nous rattraper. » (p. 119)
Un nouveau texte acquis dans cette excellente collection que j’affectionne spécialement… »Ma nuit au musée » !
Ouvrage poignant aux multiples récits et tons, intime essentiellement mais aussi historique, sociologique , philosophique, mêlant gravité, tendresse, et quelque cocasserie avec un brin de « provoc. » et d’esprit de transgression !
Une nuit entière, seule au Louvre est proposée à notre auteure… ce qui la réjouit et la ramène à son amour pour son père, qui adorait ce musée-ville et rêvait de « voler » la Joconde !!!
La phrase-jeu de son père quand ils arrivaient au Louvre : « Et toi, comment tu t’y prendrais, pour voler la Joconde ? Dans cet amour pour ce père, il y a tant et tant de sentiments intenses et contrastés.
Un « papa » yougoslave qui a dû se reconstruire, se réinventer totalement ; Père ayant fui son pays pour rejoindre Paris avec sa bien-aimée, fuite aussi d’un service militaire, et puis la guerre fratricide… qui détruira en profondeur cette famille, dont la mère de l’auteure, écrasée par le chagrin des proches assassinés… qu’elle n’a pu sauver !
Un hommage à un père, figure vénérée et adorée… des souvenirs tristes ou joyeux, le plus souvent reliés à ce Musée du Louvre ! Que le père étudie le français, seul, en lisant des biographies de peintres ou livres sur l’Art … ou qu’il emmène sa fille , voir les œuvres, dont cette « Joconde » tant convoitée !!!, ou même qu’il l’oublie dans ce même Louvre, lieu absolu des rêves paternels…Le lieu central est ce Gigantesque Louvre, consolation et refuge car espace consacré à la Beauté, où le père s’évade !
« Un jour, je devais avoir huit ou dix ans, mon père m'a oubliée au Louvre. Curieusement, ce n'est pas un mauvais souvenir. Reste avec elle, d'accord, j'ai un coup de téléphone à passer, je reviens. -Elle- c'était la Vénus de Milo. Elle faisait partie de la famille.
Je me suis assise et j'ai attendu. Ce n'était pas difficile pour moi d'attendre et je n'y pensais même pas en ces termes. J'aurais sans doute dit que je regardais. Je regardais les oeuvres. Je regardais les gens. (p. 79)”
Une nuit d’instrospection de Yakuta Alikavazovic sur sa vie, ses rapports passionnés au père, ses questionnements sur les Pouvoirs de l’Art, tant pour les personnes, intimement , que sur le pouvoir brut ,de beaucoup de pays belligérants , au fil des siècles, s’affirmant ainsi, un peu plus, sur les pays annexés , pillant, ou dérobant des œuvres dans les musées…, des observations fréquentes sur l’exil de sa terre d’origine,les guerres fratricides, le racisme ordinaire vécu, et enfin, la Culture, la Beauté de l’Art, facteurs de « baumes guérisseurs » et d’intégration…
« Que transmet-on à sa fille, sa fille unique, quand on a renié son passé ? Quand on a pu ou cru pouvoir se réinventer, dans un autre pays, une autre langue ? Mon père m'emmenait au Louvre. L'histoire de l'art est une histoire de fantômes pour grandes personnes, me disait-il. L'histoire de l'art, c'est ce qu'il m'a transmis à la place de son histoire à lui, savamment effacée et redessinée au gré du temps. (p. 34)”
Un moment très fort de lecture qui m’a fait connaître pour la première fois cette auteure, qui offre à son père, au-delà de l’absence, un texte magnifique de tendresse et d’admiration, même si il y a eu , à une période donnée, des moments de tangage pour construire sa vie de femme ! Nécessité de s’éloigner… pour mieux revenir vers ce père atypique et très aimant !
Quelle belle revanche , de surplus, en lisant que cette petite fille, à qui une institutrice peu bienveillante, avait prédit de ne jamais pouvoir apprendre le Français…est devenue une écrivaine talentueuse et reconnue !
Un style énergique, fluide, mêlant gravité et légèreté…Toutefois on sent très fort que ce « papa » déraciné , a dû sûrement être très seul intérieurement ; cela ne l’a pas freiné pour tout faire, afin de transmettre le meilleur à sa fille unique !
« Rien de tel chez mon père; au contraire, la maison qu'il professait s'être choisie, c'était le Louvre, justement; si tant est que l'on puisse choisir de s'établir non dans un pays mais dans un art, non dans une nation mais dans la beauté. Et malgré cela, malgré tout, la question de l'appartenance finit un jour ou l'autre par nous rattraper. » (p. 119)
"Tu as sauvé quelque chose de moi qui ne méritait pas d'être sauvé, j'ai détruit quelque chose de toi qui ne méritait pas d'être détruit."
Paul, étudiant le jour et concierge d'hôtel la nuit, rencontre Amélia.
Lui, depuis son enfance modeste, peine à comprendre son monde à elle, "une femme comme Amélia, qui avait plus souvent traversé l'océan que le périphérique."
Lui étudie l'urbanisme, "la ville de demain" et elle, elle s'intéresse aux photos soviétiques où certaines personnes sont effacées...
L'amour naît entre eux, improbable, inoubliable, fusionnel.
Puis Amélia disparaît.
Le secret de sa disparition est à chercher dans ses souvenirs d'enfance, de fille d'une artiste errante qui a inventé la "poésie documentaire", et qui va planter là son enfant pour aller secourir les victimes pendant le siège de Sarajevo.
C'est le roman de la disparition.
C'est aussi le roman de la peur, empli de violence et d'effroi tout autant qu'empli d'amour. Car l'amour, c'est aussi la déchirante peur de perdre.
Chose rarissime, une fois terminé ce roman, aussitôt je l'ai recommencé. Il fallait bien deux lectures à la suite pour tenter de saisir l'impalpable beauté de cette rencontre, la puissance de l'écriture, de ses métaphores, de ses réitérations.
"À tout instant il lui semblait qu'elle disait plus que ce qu'elle disait, mais ce plus, le sens caché, lui échappait sans cesse, se dérobait."
Sans conteste, un immense coup de cœur.
Paul, étudiant le jour et concierge d'hôtel la nuit, rencontre Amélia.
Lui, depuis son enfance modeste, peine à comprendre son monde à elle, "une femme comme Amélia, qui avait plus souvent traversé l'océan que le périphérique."
Lui étudie l'urbanisme, "la ville de demain" et elle, elle s'intéresse aux photos soviétiques où certaines personnes sont effacées...
L'amour naît entre eux, improbable, inoubliable, fusionnel.
Puis Amélia disparaît.
Le secret de sa disparition est à chercher dans ses souvenirs d'enfance, de fille d'une artiste errante qui a inventé la "poésie documentaire", et qui va planter là son enfant pour aller secourir les victimes pendant le siège de Sarajevo.
C'est le roman de la disparition.
C'est aussi le roman de la peur, empli de violence et d'effroi tout autant qu'empli d'amour. Car l'amour, c'est aussi la déchirante peur de perdre.
Chose rarissime, une fois terminé ce roman, aussitôt je l'ai recommencé. Il fallait bien deux lectures à la suite pour tenter de saisir l'impalpable beauté de cette rencontre, la puissance de l'écriture, de ses métaphores, de ses réitérations.
"À tout instant il lui semblait qu'elle disait plus que ce qu'elle disait, mais ce plus, le sens caché, lui échappait sans cesse, se dérobait."
Sans conteste, un immense coup de cœur.
Une nuit. Une nuit enfermée au musée. le plus grand, le plus beau, le plus chargé d'histoire et de légendes, le plus mystérieux aussi. Une nuit d'enfermée volontaire au Louvre. Une nuit passée à convoquer ses souvenirs et ses peurs. Une nuit sous la seule lumière bienveillante du père absent. Une nuit passée à questionner l'art et son rapport à la construction des êtres. Une nuit passée à ajouter sa propre part aux secrets du lieu.
Prenant - comme d'autres avant elle – son tour dans la collection éponyme pour raconter sa nuit au musée, c'est en fait un énorme cri d'amour à son père que Jakuta Alikavazovic nous livre dans Comme un ciel en nous, le Louvre faisant ici office de trait d'union entre passé et présent, entre père et fille.
Un père à la vie de personnage de roman, qui a fui l'ex-Yougoslavie pour Paris par amour de sa femme, pour échapper au service militaire, pour l'attrait du Louvre, « lieu où la beauté l'emporte ». Et aussi, un peu, « pour le steak tartare ».
Un père qui tout petit entraîne sa fille au musée, capable de citer de tête le nombre de colonnes du Panthéon, d'arcades du Louvre, de cils de Marat dans le tableau de David ou de ceux de la Joconde. Un père qui « collectionnait les gens » et les fréquentations glorieuses ou douteuses, discret et fantasque à la fois, réservé autant qu'accorte.
Un père marqué par les séquelles de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, réfugié en France sans jamais s'y sentir étranger, constamment soucieux d'afficher sa joie d'y vivre et de soigner les apparences, celles qui « comptaient davantage que le reste, davantage que le confort ; c'est déjà beaucoup d'être étranger, si en plus on fait pauvre, on est fichu ».
Alors que transmet-on à sa fille, à sa fille unique quand on a renié son passé ? Jakuta aura une vie et une nuit pour y répondre. Et dans cette réponse, l'art figure en place de choix. Dans l'obscurité de la salle des Cariatides, entre Venus de Milo et Hermaphrodite Borghese, elle peut enfin mieux les voir. « Eux : les lieux, les oeuvres. Eux : les souvenirs. »
Car l'obscurité change tout, éloigne les faux reflets, dépouille les artifices, libère les questionnements. de quoi parle t-on quand on parle d'art ? Qu'est-ce qui fait un chef d'oeuvre ? Quelle est la valeur et l'authenticité d'un souvenir, d'une perception ? Et toi, comment t'y prendrais-tu pour voler la Joconde ?
Des questionnements systématiquement brouillés par des fulgurances issues de sa propre histoire ou de celle du lieu. « Je voulais parler d'art, seuls des crimes arrivaient ». Mais aussi un sac, des voyages, un rapport particulier au langage et à la langue.
Comme un ciel en nous est un essai intime mais pudique, instantané d'une nuit où l'art sert de fil rouge au récit d'un parcours et d'une construction. Et même si « ce qu'on appelle grandir est une série de trahisons », Jakuta Alikavazovic retrouve le temps d'une nuit au musée, l'occasion d'un rendez-vous touchant avec son père et son enfance.
Un régal de style chez une auteure que je ne connaissais que de nom, mais dont je vais m'empresser d'explorer les livres précédents !
Prenant - comme d'autres avant elle – son tour dans la collection éponyme pour raconter sa nuit au musée, c'est en fait un énorme cri d'amour à son père que Jakuta Alikavazovic nous livre dans Comme un ciel en nous, le Louvre faisant ici office de trait d'union entre passé et présent, entre père et fille.
Un père à la vie de personnage de roman, qui a fui l'ex-Yougoslavie pour Paris par amour de sa femme, pour échapper au service militaire, pour l'attrait du Louvre, « lieu où la beauté l'emporte ». Et aussi, un peu, « pour le steak tartare ».
Un père qui tout petit entraîne sa fille au musée, capable de citer de tête le nombre de colonnes du Panthéon, d'arcades du Louvre, de cils de Marat dans le tableau de David ou de ceux de la Joconde. Un père qui « collectionnait les gens » et les fréquentations glorieuses ou douteuses, discret et fantasque à la fois, réservé autant qu'accorte.
Un père marqué par les séquelles de la guerre dans l'ex-Yougoslavie, réfugié en France sans jamais s'y sentir étranger, constamment soucieux d'afficher sa joie d'y vivre et de soigner les apparences, celles qui « comptaient davantage que le reste, davantage que le confort ; c'est déjà beaucoup d'être étranger, si en plus on fait pauvre, on est fichu ».
Alors que transmet-on à sa fille, à sa fille unique quand on a renié son passé ? Jakuta aura une vie et une nuit pour y répondre. Et dans cette réponse, l'art figure en place de choix. Dans l'obscurité de la salle des Cariatides, entre Venus de Milo et Hermaphrodite Borghese, elle peut enfin mieux les voir. « Eux : les lieux, les oeuvres. Eux : les souvenirs. »
Car l'obscurité change tout, éloigne les faux reflets, dépouille les artifices, libère les questionnements. de quoi parle t-on quand on parle d'art ? Qu'est-ce qui fait un chef d'oeuvre ? Quelle est la valeur et l'authenticité d'un souvenir, d'une perception ? Et toi, comment t'y prendrais-tu pour voler la Joconde ?
Des questionnements systématiquement brouillés par des fulgurances issues de sa propre histoire ou de celle du lieu. « Je voulais parler d'art, seuls des crimes arrivaient ». Mais aussi un sac, des voyages, un rapport particulier au langage et à la langue.
Comme un ciel en nous est un essai intime mais pudique, instantané d'une nuit où l'art sert de fil rouge au récit d'un parcours et d'une construction. Et même si « ce qu'on appelle grandir est une série de trahisons », Jakuta Alikavazovic retrouve le temps d'une nuit au musée, l'occasion d'un rendez-vous touchant avec son père et son enfance.
Un régal de style chez une auteure que je ne connaissais que de nom, mais dont je vais m'empresser d'explorer les livres précédents !
Trio de femmes avec homme au milieu.
Pas simple de chroniquer un livre aussi dense, une lecture aussi exigeante, une pensée aussi riche que celle exprimée par Jakuta Alikavazovic dans L’Avancée de la nuit. Il faudrait pour cela avoir beaucoup de place ou l’art de la synthèse sans omission, ni réduction. Pas simple…
Sous la narration de Paul, défile la vie d’Amélia, jeune fille riche et rousse et seule, rencontrée puis aimée passionnément. Sauf que Paul n’a pas suffisamment écouté les Rita, sinon il saurait que ces histoires-là, ça finit mal. En général…
Car Amélia n’est que souffrances. Souffrances individuelles nées de la tragédie collective du conflit yougoslave qui fit s’éloigner sa mère Nadia et brisa toute notion de racines familiales.
« Elle, elle écrivait. Elle était persuadée que l’échec du processus de paix était son échec à elle, l’échec de sa poésie. De la poésie tout entière. Au bout de trois ans, elle a fini par se rendre à l’évidence : ce qu’elle voulait révéler au monde, le monde le savait déjà. Le savait depuis le début. Et s’en moquait. Ce n’était ni la faute des mots, ni de ceux qui s’en servaient ; c’était la faute de la nature humaine. »
Souffrances que même la reconstruction rapide des villes détruites ne pourra apaiser lorsqu’elle finira par s’y rendre. Comment dès lors réussir à reconstruire sa propre ville ? Sa propre vie ? Et même une famille avec Paul et Louise, l’enfant qu’ils auront ensemble ?
Amélia avance et fuit avec ses contradictions, à défaut de les faire comprendre aux autres. Qu’elle épuise : « Refuser l’amour était pour elle une façon de l’accepter, d’en réclamer davantage, mais il n’en pouvait plus ».
Dans un livre sans dialogues, ponctué de lancinantes et quasi-envoutantes répétitions et riche d’une idée ou d’une réflexion par phrase, Jakuta Alikavazovic écrit la complexité de vivre une vie invivable quand celle-ci n’est que nuit, même si Amélia se bat pour tenter d’avancer quand même dans sa pénombre.
Déroulant le fil complexe de la vie de ses personnages, l’auteure ne se prive pas pour distiller, l’air de rien, quelques fulgurances sur l’époque : les drames nés du conflit yougoslave bien sûr ; mais aussi la mort de Zyed et Bouna ; les drones invasifs ; et demain, les puces suiveuses sous-cutanées.
À travers Nadia, Amélia et Louise, lignée de femmes qui ne peuvent être en ligne, elle dit la complexité des rapports mères-filles quand celles-ci ne peuvent ou ne veulent être ce que l’on attend d’elles.
L’Avancée de la nuit est un livre flou, un livre fou, sur les villes et les vies assiégées, ravagées, qu’on ne peut malheureusement jamais reconstruire rapidement. Un livre où le passé de l’auteure ne semble jamais loin, à l’évocation d’un grand-père transmettant la langue maternelle, des hôtels de chaine aseptisés et rassurants, d’un oiseau recueilli…
Un livre que je n’ai probablement pas totalement compris mais suffisamment pour qu’il me parle ; un livre douloureux dont on connaît l’issue fatale dès les premières pages, mais où l’on se prend quand même à rêver à une possibilité d’autre chose. Un livre mal chroniqué ce qui ne lui rend pas justice, mais votre lecture saura y remédier.
Pas simple de chroniquer un livre aussi dense, une lecture aussi exigeante, une pensée aussi riche que celle exprimée par Jakuta Alikavazovic dans L’Avancée de la nuit. Il faudrait pour cela avoir beaucoup de place ou l’art de la synthèse sans omission, ni réduction. Pas simple…
Sous la narration de Paul, défile la vie d’Amélia, jeune fille riche et rousse et seule, rencontrée puis aimée passionnément. Sauf que Paul n’a pas suffisamment écouté les Rita, sinon il saurait que ces histoires-là, ça finit mal. En général…
Car Amélia n’est que souffrances. Souffrances individuelles nées de la tragédie collective du conflit yougoslave qui fit s’éloigner sa mère Nadia et brisa toute notion de racines familiales.
« Elle, elle écrivait. Elle était persuadée que l’échec du processus de paix était son échec à elle, l’échec de sa poésie. De la poésie tout entière. Au bout de trois ans, elle a fini par se rendre à l’évidence : ce qu’elle voulait révéler au monde, le monde le savait déjà. Le savait depuis le début. Et s’en moquait. Ce n’était ni la faute des mots, ni de ceux qui s’en servaient ; c’était la faute de la nature humaine. »
Souffrances que même la reconstruction rapide des villes détruites ne pourra apaiser lorsqu’elle finira par s’y rendre. Comment dès lors réussir à reconstruire sa propre ville ? Sa propre vie ? Et même une famille avec Paul et Louise, l’enfant qu’ils auront ensemble ?
Amélia avance et fuit avec ses contradictions, à défaut de les faire comprendre aux autres. Qu’elle épuise : « Refuser l’amour était pour elle une façon de l’accepter, d’en réclamer davantage, mais il n’en pouvait plus ».
Dans un livre sans dialogues, ponctué de lancinantes et quasi-envoutantes répétitions et riche d’une idée ou d’une réflexion par phrase, Jakuta Alikavazovic écrit la complexité de vivre une vie invivable quand celle-ci n’est que nuit, même si Amélia se bat pour tenter d’avancer quand même dans sa pénombre.
Déroulant le fil complexe de la vie de ses personnages, l’auteure ne se prive pas pour distiller, l’air de rien, quelques fulgurances sur l’époque : les drames nés du conflit yougoslave bien sûr ; mais aussi la mort de Zyed et Bouna ; les drones invasifs ; et demain, les puces suiveuses sous-cutanées.
À travers Nadia, Amélia et Louise, lignée de femmes qui ne peuvent être en ligne, elle dit la complexité des rapports mères-filles quand celles-ci ne peuvent ou ne veulent être ce que l’on attend d’elles.
L’Avancée de la nuit est un livre flou, un livre fou, sur les villes et les vies assiégées, ravagées, qu’on ne peut malheureusement jamais reconstruire rapidement. Un livre où le passé de l’auteure ne semble jamais loin, à l’évocation d’un grand-père transmettant la langue maternelle, des hôtels de chaine aseptisés et rassurants, d’un oiseau recueilli…
Un livre que je n’ai probablement pas totalement compris mais suffisamment pour qu’il me parle ; un livre douloureux dont on connaît l’issue fatale dès les premières pages, mais où l’on se prend quand même à rêver à une possibilité d’autre chose. Un livre mal chroniqué ce qui ne lui rend pas justice, mais votre lecture saura y remédier.
Sur les bancs de l'université Paul va rencontrer Amélia. Il vient d'un milieu modeste, elle vient d'un milieu aisé. Il travaille comme gardien de nuit à l'hôtel Elisse. C'est là qu'elle y vit chambre 313.
le nouveau roman de l'auteur de La Blonde et le Bunker se mérite par son exigence, et aborde des problématiques , nombreuses et complexes. liées intimement à l'auteur , des questions qui tiennent à l'histoire de sa famille et à l'histoire de l'ex Yougoslavie
Une intrigue particulièrement retorse qui se construit pour se déconstruire inlassablement et qui sollicite la grande capacité de concentration d'un lecteur qui ne pourra pas rater des pages au risque de ne plus rien comprendre.
Un texte dense, précis et et exigeant qui demandera certes au lecteur une grande attention mais celle ci sera récompensée tant le roman est aussi intelligent que de grande qualité littéraire .
le nouveau roman de l'auteur de La Blonde et le Bunker se mérite par son exigence, et aborde des problématiques , nombreuses et complexes. liées intimement à l'auteur , des questions qui tiennent à l'histoire de sa famille et à l'histoire de l'ex Yougoslavie
Une intrigue particulièrement retorse qui se construit pour se déconstruire inlassablement et qui sollicite la grande capacité de concentration d'un lecteur qui ne pourra pas rater des pages au risque de ne plus rien comprendre.
Un texte dense, précis et et exigeant qui demandera certes au lecteur une grande attention mais celle ci sera récompensée tant le roman est aussi intelligent que de grande qualité littéraire .
La quatrième de couverture indique au lecteur non averti un aperçu de qui est l'auteure . Cette dernière , à cheval sur plusieurs cultures use d'une écriture singulière qui convient merveilleusement bien à l'analyse du personnage principal ( Paul ) de ses peurs , de sa difficulté d'être , de son rapport aux femmes . J'ai eu l'impression au fil de la lecture de découvrir un style nouveau mais qui ne serait pas le résultat d'une volonté de se démarquer d'une tournure plus classique , quelques chose de naturel à cet écrivaine , son style . N'ayant rien lu d'autre d'elle , je ne puis être affirmatif la dessus . Voilà pour la forme . Résumer ce livre a déjà été fait , inutile donc , de se répéter . Le fond est , quant à lui , intéressant du point de vue de la vision de l'auteure sur les troubles d'un jeune homme à s'affirmer socialement , à se construire en dehors de références posées . Donc 4 étoiles me semblent méritées pour la nouveauté du style et l'originalité des analyses sur un sujet pas souvent abordé par une auteure .
Voilà bien un livre qui ne peut pas laisser indifférent. On adore, ou on déteste. Et, parfois, sans doute, on fait un peu les deux en même temps.
Pour ma part, pendant les 150 premières pages, j’ai vraiment souffert. Paul est bizarre, Amélia pas très nette. Et, surtout, la progression de leur histoire nous est racontée à coup de phrases longues et alambiquées, qui accumulent les réitérations. J’ai eu un mal à rentrer dans l’histoire ! J’ai été totalement insensible à la poésie de cette langue, qui m’a semblé à la fois trop alambiquée et, surtout, excessivement artificielle.
Et puis on entre dans une autre phase. Paul élève seul sa fille, et l’on a alors une description de ses angoisses. Il veut évidemment protéger sa fille, de tout, de tous, et surtout d’elle-même. Il va tout de même jusqu’à lui faire poser une puce électronique, à son insu, pour pouvoir la retrouver où qu’elle puisse être. Une angoisse de père assez extrême, n’est-ce pas, mais que l’on peut presque comprendre, sinon partager.
Le plus beau passage, pour moi, est peut-être celui où la petite Louise, avec son grand-père, libère les oiseaux qu’ils élevaient ensemble. Ici, la poésie est parvenue à prendre le dessus…
Mais il reste une série de passages pour lesquels je ne comprend pas réellement – voire pas du tout – de quoi l’auteure parle. Par exemple, lorsqu’elle évoque le sable :
« Plus elle s’enfonce dans le cœur contemporain des ténèbres, plus les hommes lui semblent usés, du sable niché profondément dans les rides du visage, les plis de la peau, des grains à jamais collés à la commissure des lèvres, au coin des yeux, formant des larmes qui ne coulent pas, à jamais captives de la paupière, des pleurs mécaniques mais perpétuels et perpétuellement retenus qui sont, qui pourraient être en ces lieux désolés, un instrument d’optique. »
Le paragraphe dont est tiré cette – longue ! – phrase se termine alors par :
« Et tous ces hommes sont las, et tous s’appuient sur des fusils, qui sont parfois la somme de trois armes différentes. »
Du coup, des passages entiers m’ont semblé être excessivement travaillés, purs exercices de style dont je ne perçois pas l’apport à l’histoire. Et il faut ensuite attendre les sept dernières pages pour retrouver un passage émouvant, une très jolie fin, d’ailleurs.
Le thème qui m’a le plus parlé, c’est celui de la parentalité. Qu’est-ce que cela veut dire, être parent ? Que transmet-on, volontairement et involontairement ? Et que nous transmettent nos enfants, dans le même temps ? Ce n’est pas forcément le sujet de ce livre, mais cela m’a parlé…
Clairement, ce livre m’a laissé sur le quai. À quelques fulgurances près, je n’ai pas réussi à entrer dans cette histoire, dont la poésie m’a semblé un peu forcée par moments. En même temps, il essaye de dire quelque chose de l’ordre de l’indicible, sur l’amour, la nuit et la peur dans nos sociétés, dans nos villes, ce qui ne peut pas lui être reproché. Toujours est-il qu’à l’exception des deux passages signalés, je n’y ai pas pris de plaisir, sans en tirer non plus de grand message sur la guerre ou la peur, parmi les sujets évoqués. De ce « grand roman d’amour et d’épuisement », comme le définit le Monde, c’est essentiellement l’épuisement qui m’est échu…
Lien : https://ogrimoire.wordpress...
Pour ma part, pendant les 150 premières pages, j’ai vraiment souffert. Paul est bizarre, Amélia pas très nette. Et, surtout, la progression de leur histoire nous est racontée à coup de phrases longues et alambiquées, qui accumulent les réitérations. J’ai eu un mal à rentrer dans l’histoire ! J’ai été totalement insensible à la poésie de cette langue, qui m’a semblé à la fois trop alambiquée et, surtout, excessivement artificielle.
Et puis on entre dans une autre phase. Paul élève seul sa fille, et l’on a alors une description de ses angoisses. Il veut évidemment protéger sa fille, de tout, de tous, et surtout d’elle-même. Il va tout de même jusqu’à lui faire poser une puce électronique, à son insu, pour pouvoir la retrouver où qu’elle puisse être. Une angoisse de père assez extrême, n’est-ce pas, mais que l’on peut presque comprendre, sinon partager.
Le plus beau passage, pour moi, est peut-être celui où la petite Louise, avec son grand-père, libère les oiseaux qu’ils élevaient ensemble. Ici, la poésie est parvenue à prendre le dessus…
Mais il reste une série de passages pour lesquels je ne comprend pas réellement – voire pas du tout – de quoi l’auteure parle. Par exemple, lorsqu’elle évoque le sable :
« Plus elle s’enfonce dans le cœur contemporain des ténèbres, plus les hommes lui semblent usés, du sable niché profondément dans les rides du visage, les plis de la peau, des grains à jamais collés à la commissure des lèvres, au coin des yeux, formant des larmes qui ne coulent pas, à jamais captives de la paupière, des pleurs mécaniques mais perpétuels et perpétuellement retenus qui sont, qui pourraient être en ces lieux désolés, un instrument d’optique. »
Le paragraphe dont est tiré cette – longue ! – phrase se termine alors par :
« Et tous ces hommes sont las, et tous s’appuient sur des fusils, qui sont parfois la somme de trois armes différentes. »
Du coup, des passages entiers m’ont semblé être excessivement travaillés, purs exercices de style dont je ne perçois pas l’apport à l’histoire. Et il faut ensuite attendre les sept dernières pages pour retrouver un passage émouvant, une très jolie fin, d’ailleurs.
Le thème qui m’a le plus parlé, c’est celui de la parentalité. Qu’est-ce que cela veut dire, être parent ? Que transmet-on, volontairement et involontairement ? Et que nous transmettent nos enfants, dans le même temps ? Ce n’est pas forcément le sujet de ce livre, mais cela m’a parlé…
Clairement, ce livre m’a laissé sur le quai. À quelques fulgurances près, je n’ai pas réussi à entrer dans cette histoire, dont la poésie m’a semblé un peu forcée par moments. En même temps, il essaye de dire quelque chose de l’ordre de l’indicible, sur l’amour, la nuit et la peur dans nos sociétés, dans nos villes, ce qui ne peut pas lui être reproché. Toujours est-il qu’à l’exception des deux passages signalés, je n’y ai pas pris de plaisir, sans en tirer non plus de grand message sur la guerre ou la peur, parmi les sujets évoqués. De ce « grand roman d’amour et d’épuisement », comme le définit le Monde, c’est essentiellement l’épuisement qui m’est échu…
Lien : https://ogrimoire.wordpress...
Extrêmement fortement conseillé par ma libraire -et par le magazine Lire aussi du reste- , je n'ai pas dépassé les cinquante premières pages.
J'ai trouvé le style pédant, le propos pas du tout enthousiasmant, le style mal fichu, je reste certainement aux premières marches de ce qui doit être un monument littéraire à ce que j'entends. Bien sûr, je ne suis pas très littérature française contemporaine, mais z'enfin, je pense aimer les belles écritures, ce qui n'est pas le cas, à mon humble estime.
Destination la prochaine "book box" où assurément ce livre pourra trouver lecteur plus complaisant que moi.
J'ai trouvé le style pédant, le propos pas du tout enthousiasmant, le style mal fichu, je reste certainement aux premières marches de ce qui doit être un monument littéraire à ce que j'entends. Bien sûr, je ne suis pas très littérature française contemporaine, mais z'enfin, je pense aimer les belles écritures, ce qui n'est pas le cas, à mon humble estime.
Destination la prochaine "book box" où assurément ce livre pourra trouver lecteur plus complaisant que moi.
Dans la collection « Ma nuit au musée » que j’aime beaucoup, voici Jakuta Alikavazovic au Louvre.
« Et toi, comment t’y prendrais-tu pour voler la Joconde ? » : la phrase d’un père à sa fille, un jeu bien sûr, une énigme, ou bien plus encore…
Une phrase à multiples strates. Des pensées révélées, auprès de la Vénus de Milo.
L’obscurité aidant aux confidences, se retrouver, la nuit tombée, dans la Section des Antiques, Salle des Cariatides, laisse libre court à l’imagination… une histoire autour de toute une symbolique.
“Le Louvre est la première ville française où je me suis senti chez moi, disait mon père”.
Déambulation et introspection en cette nuit. La nuit transporte dans une autre dimension, parallèle.
« La ligne de démarcation entre réel et fiction n’est pas la même pour chacun de nous ».
Une nuit pour redevenir la fille de son père.
Une nuit chargée d’ombres, des mystères de l’art, et des zones d’ombres et de souffrances laissées par la guerre de 1990 en ex-Yougoslavie.
Un père, venu en France pour sa beauté, et par amour, à l’âge de vingt ans, depuis la Yougoslavie et son Monténégro natal. Un père et l’exil vécu. Se réapprendre à vivre après avoir tout quitté. Est-il déjà trop tard, lorsqu’on part ?
Des souvenirs, parfois douloureux, surgiront librement de cette nuit entière au Louvre, la magie de l’art invoquant de profondes réflexions.
« Qu’est-ce qui fait un chef-d’œuvre ?»
Je trouve un côté mystérieux, curiosité et sens en éveil, à s’imaginer seule la nuit au Louvre. Excitant et un peu effrayant aussi.
Une obscurité, une atmosphère chargée de merveilles, des milliers d’années d’histoires, une ambiance presque mystique… Des conditions appropriées pour explorer ses pensées profondes.
Je découvre l’auteure dans ce récit autobiographique, d’une légèreté qu’apparente et très enrichissant, à la fois intime et pudique. Douceur et émotions.
« L’histoire de l’art, c’est une histoire de fantômes pour grandes personnes ».
J’ai trouvé l’idée passionnante, se retrouver seule au milieu de ces œuvres d’art, c’est séduisant, paradoxal et intrigant ; et je m’y serais retrouvée ou perdue là-bas, bien volontiers !
« (…) l’amour. Un sentiment comme un ciel en nous. Et comme un ciel, toujours changeant. L’amour et les formes que nous essayons de lui donner. (…) Parfois l’amour subsiste, seul ».
« Et toi, comment t’y prendrais-tu pour voler la Joconde ? » : la phrase d’un père à sa fille, un jeu bien sûr, une énigme, ou bien plus encore…
Une phrase à multiples strates. Des pensées révélées, auprès de la Vénus de Milo.
L’obscurité aidant aux confidences, se retrouver, la nuit tombée, dans la Section des Antiques, Salle des Cariatides, laisse libre court à l’imagination… une histoire autour de toute une symbolique.
“Le Louvre est la première ville française où je me suis senti chez moi, disait mon père”.
Déambulation et introspection en cette nuit. La nuit transporte dans une autre dimension, parallèle.
« La ligne de démarcation entre réel et fiction n’est pas la même pour chacun de nous ».
Une nuit pour redevenir la fille de son père.
Une nuit chargée d’ombres, des mystères de l’art, et des zones d’ombres et de souffrances laissées par la guerre de 1990 en ex-Yougoslavie.
Un père, venu en France pour sa beauté, et par amour, à l’âge de vingt ans, depuis la Yougoslavie et son Monténégro natal. Un père et l’exil vécu. Se réapprendre à vivre après avoir tout quitté. Est-il déjà trop tard, lorsqu’on part ?
Des souvenirs, parfois douloureux, surgiront librement de cette nuit entière au Louvre, la magie de l’art invoquant de profondes réflexions.
« Qu’est-ce qui fait un chef-d’œuvre ?»
Je trouve un côté mystérieux, curiosité et sens en éveil, à s’imaginer seule la nuit au Louvre. Excitant et un peu effrayant aussi.
Une obscurité, une atmosphère chargée de merveilles, des milliers d’années d’histoires, une ambiance presque mystique… Des conditions appropriées pour explorer ses pensées profondes.
Je découvre l’auteure dans ce récit autobiographique, d’une légèreté qu’apparente et très enrichissant, à la fois intime et pudique. Douceur et émotions.
« L’histoire de l’art, c’est une histoire de fantômes pour grandes personnes ».
J’ai trouvé l’idée passionnante, se retrouver seule au milieu de ces œuvres d’art, c’est séduisant, paradoxal et intrigant ; et je m’y serais retrouvée ou perdue là-bas, bien volontiers !
« (…) l’amour. Un sentiment comme un ciel en nous. Et comme un ciel, toujours changeant. L’amour et les formes que nous essayons de lui donner. (…) Parfois l’amour subsiste, seul ».
L'automne arrive, c'est l'occasion de revisiter des récits avec des créatures fantastiques.
Ce recueil de nouvelles contiennent les propositions de 9 écrivains français contemporains autour de la figure du vampire. On s'éloigne souvent de la figure du marginal (immortel qui plus est) pour retenir surtout des aspects comme la luxure et le sang, traits les plus marquants retenus par la pop culture. En soit, pourquoi pas. Mais si ces propositions ont le mérite d'exister, pour la plupart d'entre elles, elles ne fonctionnent pas. La majorité proposent des scénarii ridicules ou plus simplement ennuyeux. A l'exception toutefois de celles de Thomas B. Reverdy et Jean-Michel Guenassia, deux romanciers dont je n'avais rien lu jusqu'ici et qui m'ont donné envie de remédier à cela tant les plumes fluides et le fond intelligent étaient intéressants.
Dans un autre genre, celle de Philipe Janeada (romancier dont j'ai découvert la plume à cette occasion également) était intéressante et reprenait plusieurs éléments assez classiques. C'est sans doute l'originalité des deux suivantes qui les rendent plus marquantes pour moi. Enfin, cette lecture m'aura au moins motivée pour découvrir des écrivains contemporains français.
Ce recueil de nouvelles contiennent les propositions de 9 écrivains français contemporains autour de la figure du vampire. On s'éloigne souvent de la figure du marginal (immortel qui plus est) pour retenir surtout des aspects comme la luxure et le sang, traits les plus marquants retenus par la pop culture. En soit, pourquoi pas. Mais si ces propositions ont le mérite d'exister, pour la plupart d'entre elles, elles ne fonctionnent pas. La majorité proposent des scénarii ridicules ou plus simplement ennuyeux. A l'exception toutefois de celles de Thomas B. Reverdy et Jean-Michel Guenassia, deux romanciers dont je n'avais rien lu jusqu'ici et qui m'ont donné envie de remédier à cela tant les plumes fluides et le fond intelligent étaient intéressants.
Dans un autre genre, celle de Philipe Janeada (romancier dont j'ai découvert la plume à cette occasion également) était intéressante et reprenait plusieurs éléments assez classiques. C'est sans doute l'originalité des deux suivantes qui les rendent plus marquantes pour moi. Enfin, cette lecture m'aura au moins motivée pour découvrir des écrivains contemporains français.
Je découvre l'écriture de Jakuta Alikavazovic avec ce très beau roman.
Paul et Amélia sont deux jeunes étudiants venant de milieux sociaux très différents. Paul travaille comme gardien de nuit dans l'hôtel du père d'Amélia. Leurs destins vont se croiser et se lier intrinsèquement.
C'est un très beau roman de par son sujet mais aussi son écriture.
Un roman intense difficile à classer par les multiples sujets qu'il aborde: l'amour, la filiation, la guerre, l'art mais aussi la peur.
L'écriture est belle, dense et il faut rester l'esprit vif pour suivre le récit. Mais l'effort qu'il nous demande en vaut la peine et j'ai refermé ce livre avec le désir de retrouver cette auteure dont la plume et la pensée m'ont profondément touchée.
Paul et Amélia sont deux jeunes étudiants venant de milieux sociaux très différents. Paul travaille comme gardien de nuit dans l'hôtel du père d'Amélia. Leurs destins vont se croiser et se lier intrinsèquement.
C'est un très beau roman de par son sujet mais aussi son écriture.
Un roman intense difficile à classer par les multiples sujets qu'il aborde: l'amour, la filiation, la guerre, l'art mais aussi la peur.
L'écriture est belle, dense et il faut rester l'esprit vif pour suivre le récit. Mais l'effort qu'il nous demande en vaut la peine et j'ai refermé ce livre avec le désir de retrouver cette auteure dont la plume et la pensée m'ont profondément touchée.
Paul, étudiant en architecture, travaille comme gardien de nuit à l'hôtel Elisse. C'est le lieu qu'a choisi Amélia Dehr pour vivre, chambre 313. Dans son sillage, la jeune fille laisse planer sur elle mille légendes, mille rumeurs. On ne sait pas vraiment qui elle est : peut-être une étudiante richissime, héritière des hôtels Elisse, peut-être une femme à hommes… On dit que « quand elle entre dans une pièce, quelqu'un sort en pleurant. » On en dit tellement sur elle qu'elle en est devenue « une métastase de clichés ».
Si bien que la première fois que Paul voit Amélia (de la même façon qu'Aurélien vit Bérénice chez Aragon), il la trouve « plus petite et moins symétrique, les traits moins légendaires... » « C'est ça, Amélia Dehr ? » s'étonne-t-il. Bref, Paul est un peu déçu. Mais bon, peut-être, est-ce comme cela que naissent les belles histoires d'amour…
Paul, de son poste, observe via les caméras de surveillance de l'hôtel celle qu'il va aimer, l'amour de sa vie.
Ils suivent ensemble les cours d'une certaine Anton Albers, auteur d'une thèse « d'histoire sur la nuit, et d'une thèse d'économie sur la nuit, et d'une thèse d'urbanisme sur la nuit... » Dans les années 60, Anton Albers a fréquenté des artistes, rencontré et peut-être même aimé la mère d'Amélia… Son cours a pour sujet « la ville de demain » mais finalement, l'essentiel de son propos porte sur un sentiment : la peur. Peut-être les deux thèmes sont-ils intrinsèquement liés…
Paul n'est pas bien sûr de comprendre le sens des propos d'Albers, de ses digressions infinies sur la nuit. Amélia, elle, est toujours présente et attentive, certainement parce qu'Anton Albers est le seul lien qui lui reste avec sa mère disparue, une mère qui l'a abandonnée pour « empêcher une guerre » et qui en est morte. Une femme qui a quitté son pays « comme on quitte une robe trop petite » et au moment où a éclaté la guerre en ex-Yougoslavie, elle s'est installée à l'Elisse de Sarajevo parce qu'elle considérait que « sa place était là ». Elle voulait dire au monde ce qu'elle voyait, et écrivait de la « poésie documentaire » considérant que c'était là une forme d'art qui aurait peut-être permis d'arrêter la guerre, « parce qu'elle pensait qu'il fallait trouver les mots pour la dire… »
Et que c'était justement le rôle de la poésie.
Mais elle ne revint jamais. Il reste juste à Amélia une boîte en carton remplie de poèmes que la jeune fille refuse de lire pour se venger d'avoir été abandonnée, elle, la gamine dont on a gâché l'enfance en la laissant seule dans un monde d'adultes sans amour.
Amélia, qui décide qu'elle a « autre chose à faire que d'être amoureuse. Être amoureuse c'est une façon de ne pas vivre », quittera Paul, retournera chercher sa mère dans un lieu, Sarajevo, où l'on s'empresse de tout reconstruire, au plus vite.
Mais reconstruire, c'est précisément effacer les traces de la guerre, de ce qui a été et donc les traces de la mère. Amélia supporte mal « l'obscénité de la reconstruction », considérant l'effacement comme un crime, mettant de la résine dans les trous d'obus pour qu'ils ne soient pas rebouchés, pour que l'on ne fasse pas disparaître les traces de l'Histoire.
Car pour ceux qui avaient vécu dans cette ville en guerre, « la ville était leur mère. La guerre était leur mère. » Que reste -t-il de la réalité, de la vérité si on l'oublie ?
L'avancée de la nuit est l'histoire de deux jeunes gens traversant leur existence tels des fantômes sans trouver la porte de sortie, s'épuisant à la recherche d'une issue vers la lumière, vers la liberté, deux jeunes gens qui, finalement, ne parviennent pas à se réaliser, à s'incarner, à trouver un sens à leur vie dans ce monde moderne.
Que faire ? S'engager ? Lutter ? Créer ? Aimer ? Renoncer ? Se protéger ? Ou disparaître ?
« Qu'est-ce que tu sauverais du XXe siècle ? » demande Amélia à Paul. « Ma peau » dit-il.
Amélia ne sauvera pas la sienne (on le sait dès la première page), se suicidant, trouvant dans ce geste une ultime forme d'art, une ultime liberté, peut-être impossible à trouver ailleurs , que ce soit dans l'art ou dans la vie.
Paul, de son côté, renoncera, abdiquera, dans une terrible attitude de repli comme il le dit dès les premières lignes du roman: « Il s'était dit qu'ils pourraient se fondre dans les lieux, dans le décor, et que c'était peut-être cela, le bonheur, ou ce qui s'en approchait le plus. Une vaste entreprise de camouflage... »
Se cacher pour être heureux, se dissimuler sous une large couverture épaisse comme la nuit et, peut-être même, fermer les yeux, les verrous, les portes blindées et les chambres fortes. (Paul fera d'ailleurs fortune « dans la sécurité », une forme de renoncement…) Quand on ne peut agir, on se protège, on se calfeutre, on s'enterre...
Finalement, les futures générations, incapables d'échapper à cette nuit qui avance au même rythme qu'elles, recouvrant et anéantissant toutes leurs ambitions, leur soif d'absolu, les empêchant de s'épanouir et d'être heureuses, décideront de rester dans cette nuit, d'y vivre, de s'y planquer même, d'en profiter, qui sait, pour n'y être plus rien : « Ce qu'ils recherchaient, c'était la nuit, ce que la nuit faisait à la ville, à ses parcs, à ses musées. Tout était plus mystérieux alors, tout semblait plus franc. Ils voulaient être des chats, être des ombres, échapper à ce regard permanent qui pesait sur tout, tout le temps, et semblait les sommer de rendre des comptes, de choisir leur camp dans des luttes qu'ils ne souhaitaient pas vivre. » Des générations vouées à s'occuper d'elles-mêmes, de leur petit nombril et de leurs enfants, « leur petit matériel génétique »...
L'avancée de la nuit est le roman d'un accomplissement raté et d'une quête de sens impossible, qui semble se perpétuer de génération en génération, c'est l'histoire de ceux qui cherchent à sortir de cette prison de ténèbres entravant leurs gestes, qui se débattent pour trouver un sens à leur existence et être libres mais comme le dit Anton Albers : « On ne peut rien glisser entre une personne et sa liberté… Ni ses soi-disant responsabilités, ni même ses enfants. La liberté est une peau que nous portons, et comme la peau, elle a plusieurs couches et ne s'ôte qu'à grand prix. »
On n'est pas libre qu'à moitié.
Le roman de Jakuta Alikavazovic est un texte dense et exigeant de par les problématiques qu'il brasse, à la fois riches, nombreuses et complexes. On ne s'y précipite pas, on le lit, on le relit pour y découvrir toute sa profondeur et son extraordinaire construction.
Son écriture précise, intense, puissante demande au lecteur de l'attention, de la concentration car les nuances sont à prendre au sérieux. Un mot va faire bifurquer le sens du texte, un ajout retournera la situation, une parenthèse viendra réduire à néant la phrase précédente. La phrase avance en se corrigeant, en se précisant sans cesse. Tout se combine, se construit, se déconstruit inlassablement, image même du monde insensé qui est le nôtre...
Lien : http://lireaulit.blogspot.fr/
Si bien que la première fois que Paul voit Amélia (de la même façon qu'Aurélien vit Bérénice chez Aragon), il la trouve « plus petite et moins symétrique, les traits moins légendaires... » « C'est ça, Amélia Dehr ? » s'étonne-t-il. Bref, Paul est un peu déçu. Mais bon, peut-être, est-ce comme cela que naissent les belles histoires d'amour…
Paul, de son poste, observe via les caméras de surveillance de l'hôtel celle qu'il va aimer, l'amour de sa vie.
Ils suivent ensemble les cours d'une certaine Anton Albers, auteur d'une thèse « d'histoire sur la nuit, et d'une thèse d'économie sur la nuit, et d'une thèse d'urbanisme sur la nuit... » Dans les années 60, Anton Albers a fréquenté des artistes, rencontré et peut-être même aimé la mère d'Amélia… Son cours a pour sujet « la ville de demain » mais finalement, l'essentiel de son propos porte sur un sentiment : la peur. Peut-être les deux thèmes sont-ils intrinsèquement liés…
Paul n'est pas bien sûr de comprendre le sens des propos d'Albers, de ses digressions infinies sur la nuit. Amélia, elle, est toujours présente et attentive, certainement parce qu'Anton Albers est le seul lien qui lui reste avec sa mère disparue, une mère qui l'a abandonnée pour « empêcher une guerre » et qui en est morte. Une femme qui a quitté son pays « comme on quitte une robe trop petite » et au moment où a éclaté la guerre en ex-Yougoslavie, elle s'est installée à l'Elisse de Sarajevo parce qu'elle considérait que « sa place était là ». Elle voulait dire au monde ce qu'elle voyait, et écrivait de la « poésie documentaire » considérant que c'était là une forme d'art qui aurait peut-être permis d'arrêter la guerre, « parce qu'elle pensait qu'il fallait trouver les mots pour la dire… »
Et que c'était justement le rôle de la poésie.
Mais elle ne revint jamais. Il reste juste à Amélia une boîte en carton remplie de poèmes que la jeune fille refuse de lire pour se venger d'avoir été abandonnée, elle, la gamine dont on a gâché l'enfance en la laissant seule dans un monde d'adultes sans amour.
Amélia, qui décide qu'elle a « autre chose à faire que d'être amoureuse. Être amoureuse c'est une façon de ne pas vivre », quittera Paul, retournera chercher sa mère dans un lieu, Sarajevo, où l'on s'empresse de tout reconstruire, au plus vite.
Mais reconstruire, c'est précisément effacer les traces de la guerre, de ce qui a été et donc les traces de la mère. Amélia supporte mal « l'obscénité de la reconstruction », considérant l'effacement comme un crime, mettant de la résine dans les trous d'obus pour qu'ils ne soient pas rebouchés, pour que l'on ne fasse pas disparaître les traces de l'Histoire.
Car pour ceux qui avaient vécu dans cette ville en guerre, « la ville était leur mère. La guerre était leur mère. » Que reste -t-il de la réalité, de la vérité si on l'oublie ?
L'avancée de la nuit est l'histoire de deux jeunes gens traversant leur existence tels des fantômes sans trouver la porte de sortie, s'épuisant à la recherche d'une issue vers la lumière, vers la liberté, deux jeunes gens qui, finalement, ne parviennent pas à se réaliser, à s'incarner, à trouver un sens à leur vie dans ce monde moderne.
Que faire ? S'engager ? Lutter ? Créer ? Aimer ? Renoncer ? Se protéger ? Ou disparaître ?
« Qu'est-ce que tu sauverais du XXe siècle ? » demande Amélia à Paul. « Ma peau » dit-il.
Amélia ne sauvera pas la sienne (on le sait dès la première page), se suicidant, trouvant dans ce geste une ultime forme d'art, une ultime liberté, peut-être impossible à trouver ailleurs , que ce soit dans l'art ou dans la vie.
Paul, de son côté, renoncera, abdiquera, dans une terrible attitude de repli comme il le dit dès les premières lignes du roman: « Il s'était dit qu'ils pourraient se fondre dans les lieux, dans le décor, et que c'était peut-être cela, le bonheur, ou ce qui s'en approchait le plus. Une vaste entreprise de camouflage... »
Se cacher pour être heureux, se dissimuler sous une large couverture épaisse comme la nuit et, peut-être même, fermer les yeux, les verrous, les portes blindées et les chambres fortes. (Paul fera d'ailleurs fortune « dans la sécurité », une forme de renoncement…) Quand on ne peut agir, on se protège, on se calfeutre, on s'enterre...
Finalement, les futures générations, incapables d'échapper à cette nuit qui avance au même rythme qu'elles, recouvrant et anéantissant toutes leurs ambitions, leur soif d'absolu, les empêchant de s'épanouir et d'être heureuses, décideront de rester dans cette nuit, d'y vivre, de s'y planquer même, d'en profiter, qui sait, pour n'y être plus rien : « Ce qu'ils recherchaient, c'était la nuit, ce que la nuit faisait à la ville, à ses parcs, à ses musées. Tout était plus mystérieux alors, tout semblait plus franc. Ils voulaient être des chats, être des ombres, échapper à ce regard permanent qui pesait sur tout, tout le temps, et semblait les sommer de rendre des comptes, de choisir leur camp dans des luttes qu'ils ne souhaitaient pas vivre. » Des générations vouées à s'occuper d'elles-mêmes, de leur petit nombril et de leurs enfants, « leur petit matériel génétique »...
L'avancée de la nuit est le roman d'un accomplissement raté et d'une quête de sens impossible, qui semble se perpétuer de génération en génération, c'est l'histoire de ceux qui cherchent à sortir de cette prison de ténèbres entravant leurs gestes, qui se débattent pour trouver un sens à leur existence et être libres mais comme le dit Anton Albers : « On ne peut rien glisser entre une personne et sa liberté… Ni ses soi-disant responsabilités, ni même ses enfants. La liberté est une peau que nous portons, et comme la peau, elle a plusieurs couches et ne s'ôte qu'à grand prix. »
On n'est pas libre qu'à moitié.
Le roman de Jakuta Alikavazovic est un texte dense et exigeant de par les problématiques qu'il brasse, à la fois riches, nombreuses et complexes. On ne s'y précipite pas, on le lit, on le relit pour y découvrir toute sa profondeur et son extraordinaire construction.
Son écriture précise, intense, puissante demande au lecteur de l'attention, de la concentration car les nuances sont à prendre au sérieux. Un mot va faire bifurquer le sens du texte, un ajout retournera la situation, une parenthèse viendra réduire à néant la phrase précédente. La phrase avance en se corrigeant, en se précisant sans cesse. Tout se combine, se construit, se déconstruit inlassablement, image même du monde insensé qui est le nôtre...
Lien : http://lireaulit.blogspot.fr/
Mon mari s'y est accroché jusqu'à la fin, bien obligé car c'est le seul roman qu'il avait apporté lors d’un séjour en camping... J'étais donc avisée de ses longueurs, de ses phrases répétitives et de ses redondances dans le propos.
D’abord, un abus inconsidéré de la conjonction « ou » nous a royalement agacés, par exemple :
« Il avait coupé les ponts ou croyait avoir coupé les ponts ou essayait de couper les ponts avec son milieu. »
« Son père était riche ou mort, ou riche et mort. »
« Il lui semblait que tout le monde était parti, au ski ou en famille ou pire encore au ski en famille. »
« Ma mère et Albers avaient décidé de travailler sur la question mais ont échoué. Ou peut-être réussi. Ou peut-être l’une a-t-elle réussi et l’autre échoué. »
« Écoute, dit-elle, à voix basse également, pour ne pas réveiller l’enfant ou pour ne pas réveiller autre chose ou les deux; »
« Elle avait peu de souvenirs de cette pension, ceux qu’elle avait tendaient à se confondre avec un film d’horreur célèbre, quoique avec ses scènes les moins horribles ou pas horribles du tout. »
« (…) le téléphone de la réception sonna, tard mais pas si tard, vers dix heures peut-être ou vers onze heures (…) »
Ensuite, certaines phrases creuses, d’une pauvreté littéraire, nous ont gâché notre lecture, par exemple :
« (…) un vague air de contentement détaché ou de détachement content (…) »
« Paul se sentit triste et exploité. Amélia se sentit exploitée et triste. »
Les personnages principaux (Paul et Amélia) sont désincarnés, peu sympathiques, ce qui rend leur parcours et leurs motivations peu intéressants. Je me serais attachée beaucoup plus au récit de la mère d’Amélia, originaire de Sarajevo et à son retour dans sa ville assiégée durant la guerre civile des Balkans. De même qu’à la figure professorale d’Albers et ses théories sur la mémoire. Bref, une lecture décevante…
D’abord, un abus inconsidéré de la conjonction « ou » nous a royalement agacés, par exemple :
« Il avait coupé les ponts ou croyait avoir coupé les ponts ou essayait de couper les ponts avec son milieu. »
« Son père était riche ou mort, ou riche et mort. »
« Il lui semblait que tout le monde était parti, au ski ou en famille ou pire encore au ski en famille. »
« Ma mère et Albers avaient décidé de travailler sur la question mais ont échoué. Ou peut-être réussi. Ou peut-être l’une a-t-elle réussi et l’autre échoué. »
« Écoute, dit-elle, à voix basse également, pour ne pas réveiller l’enfant ou pour ne pas réveiller autre chose ou les deux; »
« Elle avait peu de souvenirs de cette pension, ceux qu’elle avait tendaient à se confondre avec un film d’horreur célèbre, quoique avec ses scènes les moins horribles ou pas horribles du tout. »
« (…) le téléphone de la réception sonna, tard mais pas si tard, vers dix heures peut-être ou vers onze heures (…) »
Ensuite, certaines phrases creuses, d’une pauvreté littéraire, nous ont gâché notre lecture, par exemple :
« (…) un vague air de contentement détaché ou de détachement content (…) »
« Paul se sentit triste et exploité. Amélia se sentit exploitée et triste. »
Les personnages principaux (Paul et Amélia) sont désincarnés, peu sympathiques, ce qui rend leur parcours et leurs motivations peu intéressants. Je me serais attachée beaucoup plus au récit de la mère d’Amélia, originaire de Sarajevo et à son retour dans sa ville assiégée durant la guerre civile des Balkans. De même qu’à la figure professorale d’Albers et ses théories sur la mémoire. Bref, une lecture décevante…
En dépit des excessives louanges des critiques, j'ai trouvé ce roman raté. Par excès d'ambition ou plutôt ambition mal placée: l'auteur veut absolument faire oeuvre originale. Résultat, tout est artificiel:les personnages sont incompréhensibles et pas du tout attachants, l'histoire est un peu incohérente et part à la dérive, le style est compliqué et prétentieux, avec des phrases souvent trop longues et incompréhensibles, des notations absconses...L'auteur a voulu "nous en mettre plein la vue"!
On s'ennuie du début jusqu'à la fin.
On s'ennuie du début jusqu'à la fin.
"Neuf grands écrivains français ont accepté de relever le défi..."
Ils l'ont peut-être accepté (il faut bien vivre...) mais ne l'ont, en aucun cas, relevé !
Sur neuf histoires, seules deux m'ont légèrement intéressée : "Bogdana" et "La grande réparation". D'où ma note de deux étoiles.
L'aguichante quatrième de couverture n'a vraiment pas tenu ses promesses. Ce recueil est un flop.
Je souhaite néanmoins un Joyeux Noël aux auteurs. En ce qui me concerne, j'ai 9 € en moins pour m'offrir des chocolats.
Le seul bon souvenir que je retiendrais de ce livre est de l'avoir acheté par un bel après-midi de Décembre, en balade dans les rues de Bordeaux, dans une charmante petite librairie au nom alléchant de "La mauvaise réputation".
Ils l'ont peut-être accepté (il faut bien vivre...) mais ne l'ont, en aucun cas, relevé !
Sur neuf histoires, seules deux m'ont légèrement intéressée : "Bogdana" et "La grande réparation". D'où ma note de deux étoiles.
L'aguichante quatrième de couverture n'a vraiment pas tenu ses promesses. Ce recueil est un flop.
Je souhaite néanmoins un Joyeux Noël aux auteurs. En ce qui me concerne, j'ai 9 € en moins pour m'offrir des chocolats.
Le seul bon souvenir que je retiendrais de ce livre est de l'avoir acheté par un bel après-midi de Décembre, en balade dans les rues de Bordeaux, dans une charmante petite librairie au nom alléchant de "La mauvaise réputation".
Un livre assez facile à lire, drôle et émouvant.
Irina vit avec son père un auteur-illustrateur qui la prend pour modèle. Elle est l'héroïne de ses livres si bien qu'elle ne se reconnaît plus, des cheveux trop longs, des chaussures trop petites, où est sa place ? Peut être que son drôle de voisin est son seul espoir pour s'échapper ! Un garçon qu'elle voit par sa fenêtre gesticuler avec des habits de femme trop grands et des lunettes de soleil à toute heure du jour et de la nuit.
Sauvons Irina d'Irina !
Irina vit avec son père un auteur-illustrateur qui la prend pour modèle. Elle est l'héroïne de ses livres si bien qu'elle ne se reconnaît plus, des cheveux trop longs, des chaussures trop petites, où est sa place ? Peut être que son drôle de voisin est son seul espoir pour s'échapper ! Un garçon qu'elle voit par sa fenêtre gesticuler avec des habits de femme trop grands et des lunettes de soleil à toute heure du jour et de la nuit.
Sauvons Irina d'Irina !
Le récit commence par les « notes de conservation », passages très courts à propos d’œuvres d’art et de leurs techniques de conservation.
Nous basculons ensuite directement dans la description de la rencontre de Gray, un intellectuel un peu naïf, avec Anna, photographe célèbre, divorcée, vivant dans la même maison que son ex-mari, John, écrivain. Gray tombe très vite amoureux d’Anna et emménage chez elle.
À la mort de John Volstead, Gray est chargé par le testament de celui-ci de mener l’enquête à la recherche d’une mystérieuse et insaisissable collection Castiglioni.
La narration se présente comme une photographie dont l’auteur nous fournirait aussi le négatif à deviner. C’est une boucle figurant les mythes d’Eurydice et de Perséphone où l’amant descend au sous-sol reprendre le cœur et le passé innocent de sa belle afin de mieux la posséder puis la conserver à jamais. La mise en abyme est permanente, l’auteur rappelle la quête précédente ensuite par la recherche de cette mystérieuse collection après la mort du mari. Une collection inaccessible, comme la quête de la vie éternelle, de l’amour, de la présence à soi et aux autres. Une aspiration qui pourrait figurer la recherche par l’Homme de la perfection, du bonheur ou tout simplement du saint Graal : le but de l’existence. L’angoisse de la mort paraît en transparence par la notion permanente et répétitive d’absence dans le récit. Le style est tout à fait abordable dans la lecture. Toute la complexité du roman est dans les mises en abyme et dans les différentes possibilités d’analyse des tableaux de l’histoire.
J’ai passé un moment intéressant et je lirai peut-être d’autres ouvrages de cette auteure s’ils ne concernent pas l’art pictural, sujet dont je ne suis pas forcément adepte dans le roman.
Nous basculons ensuite directement dans la description de la rencontre de Gray, un intellectuel un peu naïf, avec Anna, photographe célèbre, divorcée, vivant dans la même maison que son ex-mari, John, écrivain. Gray tombe très vite amoureux d’Anna et emménage chez elle.
À la mort de John Volstead, Gray est chargé par le testament de celui-ci de mener l’enquête à la recherche d’une mystérieuse et insaisissable collection Castiglioni.
La narration se présente comme une photographie dont l’auteur nous fournirait aussi le négatif à deviner. C’est une boucle figurant les mythes d’Eurydice et de Perséphone où l’amant descend au sous-sol reprendre le cœur et le passé innocent de sa belle afin de mieux la posséder puis la conserver à jamais. La mise en abyme est permanente, l’auteur rappelle la quête précédente ensuite par la recherche de cette mystérieuse collection après la mort du mari. Une collection inaccessible, comme la quête de la vie éternelle, de l’amour, de la présence à soi et aux autres. Une aspiration qui pourrait figurer la recherche par l’Homme de la perfection, du bonheur ou tout simplement du saint Graal : le but de l’existence. L’angoisse de la mort paraît en transparence par la notion permanente et répétitive d’absence dans le récit. Le style est tout à fait abordable dans la lecture. Toute la complexité du roman est dans les mises en abyme et dans les différentes possibilités d’analyse des tableaux de l’histoire.
J’ai passé un moment intéressant et je lirai peut-être d’autres ouvrages de cette auteure s’ils ne concernent pas l’art pictural, sujet dont je ne suis pas forcément adepte dans le roman.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Jakuta Alikavazovic
Lecteurs de Jakuta Alikavazovic (472)Voir plus
Quiz
Voir plus
Professions des personnages de roman ( avec indices)
Charles, le mari d'Emma Bovary dans Mme Bovary de Gustave Flaubert Indice : hippocrate
avovat
pharmacien
notaire
médecin
15 questions
366 lecteurs ont répondu
Thèmes :
personnages
, roman
, littératureCréer un quiz sur cet auteur366 lecteurs ont répondu