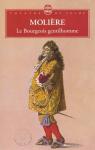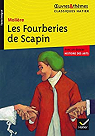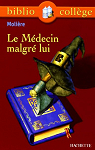Critiques de Molière (1735)
Bien sûr, nous la connaissons tous plus ou moins cette pièce ; nous l'avons tous plus ou moins subie ou adorée à l'école (au collège en particulier). Cependant, dans nos années " matures " (c'est-à-dire en nos années " ridées "), il ne nous en reste bien souvent qu'un souvenir très vague ou une réminiscence tellement ténue qu'il nous est parfois bien malaisé de s'en faire encore une idée fiable.
J'ai constaté cet état de fait auprès de plusieurs de mes amis et ai été incitée à me replonger dans Le Bourgeois Gentilhomme par les remarques d'un lecteur sur Babelio ce qui m'a permis de redécouvrir le fameux Monsieur Jourdain.
Bien évidemment, il y a des petits côtés désuets chez Molière, la mécanique est parfois lourde et très insistante, notamment dans les quiproquos, mais il y a aussi et surtout de ces finesses qui demeurent intactes et que les siècles n'érodent pas.
Ainsi, les premières scènes avec les maîtres de danse et de musique font dans l'épaisse caricature, en revanche, la scène 4 de l'acte II avec le maître de philosophie, était, reste et demeurera vraiment hilarante pour des siècles et des siècles.
En deux mots, M. Jourdain est nanti d'une richesse matérielle incalculable fruit de son activité de commerçant, et, désireux de s'élever socialement, ne jure que par les artifices de la noblesse. Son esprit étroit lui laisse trop peu d'espace pour se rendre compte que tous se payent sa tête et ne jurent, quant à eux, qu'en l'argent qu'ils arrivent à lui soutirer pour de prétendues leçons d'éducation aristocratique.
Mais le comble du comble, c'est Dorante : un gentilhomme de naissance sans le sou, qui puise abondamment dans la bourse de Jourdain, prétextant le servir et ne servant, bien évidemment que ses propres intérêts, au détriment de Jourdain même. Cherchez bien dans votre entourage, il doit bien y en avoir un ou deux des comme ça, n'est-ce pas ?
Parallèlement, Lucile, la fille de Jourdain, souhaite épouser Cléonte, garçon de bonne famille mais pas assez " gentilhomme " au goût de Jourdain, qui lui refuse donc sa main. Une nouvelle fois, cette situation sera prétexte à duperie pour le pauvre brave bougre, qui se retrouve tout content de se faire rouler une nouvelle fois dans la farine par l'ensemble de ses proches.
Elles sont nombreuses les morales de cette fable théâtrale, bien que la plus évidente, ressemble à s'y méprendre à celle de son contemporain La Fontaine dans Le Corbeau et le Renard : « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. »
Cependant, on y lit en filigrane d'autres moralités, notamment que l'honnêteté ne paye pas car Cléonte, honnête, se fait éconduire par le beau père tandis que pour le même Cléonte, travesti, on déroule le tapis rouge. Dorante, infâme coquin haut perché, s'en tire toujours par une pirouette.
Cela pourrait encore être : « Ne cherchez pas conseil auprès de ceux qui, tout professionnels qu'ils soient, ont des intérêts dans la réponse qu'ils apportent. » (Souvenez-vous de ça quand vous irez chez le dentiste, quand vous ferez repeindre vos murs ou que vous demanderez conseil pour changer vos robinetteries, par exemple).
L'hypocrisie et le délit d'initié (au sens large du terme, pas au sens boursier) sont les terrains de chasse favoris de Molière. Mais il y a aussi une autre dimension. Suite à la Réforme, le XVIIème siècle est le témoin de la montée en puissance de la bourgeoisie. La vieille aristocratie a encore les reins solides pour quelques temps, mais elle pliera inéluctablement à la fin du XVIIIème par la Révolution que l'on sait.
On ne sait donc qui est la dupe de qui. Sont-ce les bourgeois étrillés dans cette pièce ou sont-ce les nobles désargentés qui rient et négligent ce qui fera pourtant leur perte ? Molière était bien assez malin pour flatter ses mécènes tout en pensant exactement le contraire. Le fait est que, depuis le XIXème siècle, ce sont les bourgeois qui rient et se moquent copieusement des manières guindées de la vieille noblesse archaïque.
Et de ce que je perçois du monde, j'ai le sentiment que les bourgeois ont encore quelques beaux jours devant eux avant qu'une autre catégorie sociale ne prenne les commandes et ne s'empresse de faire exactement la même chose que la noblesse et la bourgeoisie avant elle...
Mais, donc, pour revenir à la pièce qui nous occupe aujourd'hui, je considère que le test de passage est réussi pour ce Bourgeois Gentilhomme et ce en dehors de toute contrainte scolaire me concernant.
En outre, ce n'est là que mon avis extraordinairement roturier et de peu de manières, c'est-à-dire, pas grand-chose.
J'ai constaté cet état de fait auprès de plusieurs de mes amis et ai été incitée à me replonger dans Le Bourgeois Gentilhomme par les remarques d'un lecteur sur Babelio ce qui m'a permis de redécouvrir le fameux Monsieur Jourdain.
Bien évidemment, il y a des petits côtés désuets chez Molière, la mécanique est parfois lourde et très insistante, notamment dans les quiproquos, mais il y a aussi et surtout de ces finesses qui demeurent intactes et que les siècles n'érodent pas.
Ainsi, les premières scènes avec les maîtres de danse et de musique font dans l'épaisse caricature, en revanche, la scène 4 de l'acte II avec le maître de philosophie, était, reste et demeurera vraiment hilarante pour des siècles et des siècles.
En deux mots, M. Jourdain est nanti d'une richesse matérielle incalculable fruit de son activité de commerçant, et, désireux de s'élever socialement, ne jure que par les artifices de la noblesse. Son esprit étroit lui laisse trop peu d'espace pour se rendre compte que tous se payent sa tête et ne jurent, quant à eux, qu'en l'argent qu'ils arrivent à lui soutirer pour de prétendues leçons d'éducation aristocratique.
Mais le comble du comble, c'est Dorante : un gentilhomme de naissance sans le sou, qui puise abondamment dans la bourse de Jourdain, prétextant le servir et ne servant, bien évidemment que ses propres intérêts, au détriment de Jourdain même. Cherchez bien dans votre entourage, il doit bien y en avoir un ou deux des comme ça, n'est-ce pas ?
Parallèlement, Lucile, la fille de Jourdain, souhaite épouser Cléonte, garçon de bonne famille mais pas assez " gentilhomme " au goût de Jourdain, qui lui refuse donc sa main. Une nouvelle fois, cette situation sera prétexte à duperie pour le pauvre brave bougre, qui se retrouve tout content de se faire rouler une nouvelle fois dans la farine par l'ensemble de ses proches.
Elles sont nombreuses les morales de cette fable théâtrale, bien que la plus évidente, ressemble à s'y méprendre à celle de son contemporain La Fontaine dans Le Corbeau et le Renard : « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. »
Cependant, on y lit en filigrane d'autres moralités, notamment que l'honnêteté ne paye pas car Cléonte, honnête, se fait éconduire par le beau père tandis que pour le même Cléonte, travesti, on déroule le tapis rouge. Dorante, infâme coquin haut perché, s'en tire toujours par une pirouette.
Cela pourrait encore être : « Ne cherchez pas conseil auprès de ceux qui, tout professionnels qu'ils soient, ont des intérêts dans la réponse qu'ils apportent. » (Souvenez-vous de ça quand vous irez chez le dentiste, quand vous ferez repeindre vos murs ou que vous demanderez conseil pour changer vos robinetteries, par exemple).
L'hypocrisie et le délit d'initié (au sens large du terme, pas au sens boursier) sont les terrains de chasse favoris de Molière. Mais il y a aussi une autre dimension. Suite à la Réforme, le XVIIème siècle est le témoin de la montée en puissance de la bourgeoisie. La vieille aristocratie a encore les reins solides pour quelques temps, mais elle pliera inéluctablement à la fin du XVIIIème par la Révolution que l'on sait.
On ne sait donc qui est la dupe de qui. Sont-ce les bourgeois étrillés dans cette pièce ou sont-ce les nobles désargentés qui rient et négligent ce qui fera pourtant leur perte ? Molière était bien assez malin pour flatter ses mécènes tout en pensant exactement le contraire. Le fait est que, depuis le XIXème siècle, ce sont les bourgeois qui rient et se moquent copieusement des manières guindées de la vieille noblesse archaïque.
Et de ce que je perçois du monde, j'ai le sentiment que les bourgeois ont encore quelques beaux jours devant eux avant qu'une autre catégorie sociale ne prenne les commandes et ne s'empresse de faire exactement la même chose que la noblesse et la bourgeoisie avant elle...
Mais, donc, pour revenir à la pièce qui nous occupe aujourd'hui, je considère que le test de passage est réussi pour ce Bourgeois Gentilhomme et ce en dehors de toute contrainte scolaire me concernant.
En outre, ce n'est là que mon avis extraordinairement roturier et de peu de manières, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Quel bonheur de relire une pièce de Molière qui, contrairement à certaines, est et demeure rafraichissante, drôle et caustique. (Dernièrement, j'ai relu plusieurs pièces de Momo, pas toutes avec le même bonheur, certaines sentent, à mon goût, beaucoup trop la naphtaline et ne jouissent que d'une réputation traditionnelle à défaut d'intérêt réellement contemporain.)
Ici, notre héros, Argan, homme d'âge mûr hypocondriaque, naïf et crédule (à la façon d'un Monsieur Jourdain dans le Bourgeois Gentilhomme), se fait prescrire à longueur de journées des remèdes bidon par son médecin Purgon, dont il prend tout de même au préalable le soin de négocier le prix en bon gros marchand de tapis qu'il est.
Sa fille, belle — évidemment — et amoureuse d'un bellâtre par dessus le marché, reçoit la demande en mariage d'un jeune médecin, Thomas Diafoirus, lui-même fils de médecin, parti qui ne peut que séduire son grand malade de père. Vous vous doutez bien que le jeune toubib est un indéfinissable crétin demeuré au dernier degré, d'où quelques tirades absolument tordantes.
Et, bien évidemment, Molière ne serait pas tout à fait satisfait s'il n'adjoignait pas à sa décoction théâtrale une petite belle-mère intéressée pour pimenter le tout.
Je laisse aux chanceux qui découvrent la pièce pour la première fois, le bonheur et la saveur des répliques et de la chute. Sachez encore simplement que cette pièce est l'occasion pour son auteur de tirer à boulets rouges sur la médecine d'alors qui, sous des atours de respectabilité et de science, était selon lui un réel charlatanisme.
Quand, quelques siècles plus tard, on voit encore la façon de procéder de certains médecins (homéopathie comme gage de sérieux, anti-inflammatoires à gogo quand une seule séance de kinésithérapie suffirait, etc., etc., etc.), pour ce qui est du médical, (et je préfère ne pas évoquer la question du coût ni celle de la pharmacie de peur de paraître en vouloir à ses beaux messieurs et belles dames de la Médecine), on se dit que la requête du bonhomme Molière ne devait pas être tout à fait injustifiée, surtout à l'époque où le niveau de formation et de savoir des médecins était encore à un stade embryonnaire.
En tout cas, cette pièce reste pour moi l'un des " must " de Molière (Voyez comme je la maltraite la langue de Molière !) mais ce n'est là que mon avis, probablement un peu malade lui aussi, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Ici, notre héros, Argan, homme d'âge mûr hypocondriaque, naïf et crédule (à la façon d'un Monsieur Jourdain dans le Bourgeois Gentilhomme), se fait prescrire à longueur de journées des remèdes bidon par son médecin Purgon, dont il prend tout de même au préalable le soin de négocier le prix en bon gros marchand de tapis qu'il est.
Sa fille, belle — évidemment — et amoureuse d'un bellâtre par dessus le marché, reçoit la demande en mariage d'un jeune médecin, Thomas Diafoirus, lui-même fils de médecin, parti qui ne peut que séduire son grand malade de père. Vous vous doutez bien que le jeune toubib est un indéfinissable crétin demeuré au dernier degré, d'où quelques tirades absolument tordantes.
Et, bien évidemment, Molière ne serait pas tout à fait satisfait s'il n'adjoignait pas à sa décoction théâtrale une petite belle-mère intéressée pour pimenter le tout.
Je laisse aux chanceux qui découvrent la pièce pour la première fois, le bonheur et la saveur des répliques et de la chute. Sachez encore simplement que cette pièce est l'occasion pour son auteur de tirer à boulets rouges sur la médecine d'alors qui, sous des atours de respectabilité et de science, était selon lui un réel charlatanisme.
Quand, quelques siècles plus tard, on voit encore la façon de procéder de certains médecins (homéopathie comme gage de sérieux, anti-inflammatoires à gogo quand une seule séance de kinésithérapie suffirait, etc., etc., etc.), pour ce qui est du médical, (et je préfère ne pas évoquer la question du coût ni celle de la pharmacie de peur de paraître en vouloir à ses beaux messieurs et belles dames de la Médecine), on se dit que la requête du bonhomme Molière ne devait pas être tout à fait injustifiée, surtout à l'époque où le niveau de formation et de savoir des médecins était encore à un stade embryonnaire.
En tout cas, cette pièce reste pour moi l'un des " must " de Molière (Voyez comme je la maltraite la langue de Molière !) mais ce n'est là que mon avis, probablement un peu malade lui aussi, c'est-à-dire, pas grand-chose.
L’Avare n’est pas, des pièces de Molière, celle que je préfère et ce pour diverses raisons.
Premièrement, je n’y retrouve pas les qualités d’écriture qui me ravissent tant parfois chez l’auteur et dont on peut faire l’éloge dans Le Tartuffe, à titre d'exemple.
Deuxièmement, ce qui donne normalement de la valeur à une comédie, c’est son potentiel comique, son pouvoir à faire rire sans retenue et sans complaisance. Ici, je n’ai que souri et à de rares endroits ce qui n’est pas la meilleure performance qu’a su réaliser Molière sur ma personne.
Ce faisant, et c’est mon troisième point, l’essentiel des passages vraiment drôles ont été repompés quasi intégralement dans des comédies existantes et ne sont donc pas, à proprement parler, de Molière. Je pense notamment au vol de la cassette et au quiproquo entre l’argent et la fille d’Harpagon qui vient tout droit de la comédie de Plaute La Marmite (Aulularia). La scène du prêt entre le fils prodigue et son père usurier ainsi que l’épisode fameux de l’inventaire des vieilleries à acquérir sont une recopie quasi intégrale d’une pièce du Normand Boisrobert (La Belle Plaideuse). De même que la fameuse tirade d’Harpagon qui hurle à l’assassin suite au vol de son argent, qui est un emprunt très fidèle à Larivey dans Les Esprits, lui-même s’étant largement inspiré de Plaute, ce dernier calquant sa pièce sur celles de Ménandre et lequel encore n’était probablement pas le premier à tirer le portrait de l’avarice maladive.
Quatrièmement, l’intérêt, dans la construction et pour la structure de la pièce, d’avoir surajouté des histoires d’amour alambiquées, croisées, compliquées, bancales opposant les pères et les fils parmi les frères et les sœurs ne m’apparaît pas clairement pour l’efficacité du portrait caricatural du vieil avare maniaque et pathologique qu’il se propose de brosser. Voire, et c’est mon point de vue, tout ce fouillis, ce cafouillis, ce brouhaha ne fait qu’affaiblir la puissance et la justesse de la satire.
Cinquièmement, le coming-out final est d’une nullité affligeante, qui sent le bâclé et qui plante le spectateur au milieu d’une fin décidément trop facile et trop faiblarde. On est très loin des très bonnes comédies de caractère de Molière comme Le Malade Imaginaire ou Le Bourgeois Gentilhomme. Finalement, tout bien pesé, je préfère l’avare de Plaute (La Marmite) à celui de Molière, mais cela n’engage que moi.
Bon, ceci étant dit, je me sens un peu dure car Molière reste Molière, et, même en petite forme, sa pièce reste supportable et de temps en temps très agréable, mais ce n’est pas le Molière des grands soirs, du moins c’est mon avis, c’est-à-dire, rien de bien numéraire ni très sonnant et encore moins trébuchant à mettre dans la cassette d’Harpagon… autant dire, pas grand-chose.
Premièrement, je n’y retrouve pas les qualités d’écriture qui me ravissent tant parfois chez l’auteur et dont on peut faire l’éloge dans Le Tartuffe, à titre d'exemple.
Deuxièmement, ce qui donne normalement de la valeur à une comédie, c’est son potentiel comique, son pouvoir à faire rire sans retenue et sans complaisance. Ici, je n’ai que souri et à de rares endroits ce qui n’est pas la meilleure performance qu’a su réaliser Molière sur ma personne.
Ce faisant, et c’est mon troisième point, l’essentiel des passages vraiment drôles ont été repompés quasi intégralement dans des comédies existantes et ne sont donc pas, à proprement parler, de Molière. Je pense notamment au vol de la cassette et au quiproquo entre l’argent et la fille d’Harpagon qui vient tout droit de la comédie de Plaute La Marmite (Aulularia). La scène du prêt entre le fils prodigue et son père usurier ainsi que l’épisode fameux de l’inventaire des vieilleries à acquérir sont une recopie quasi intégrale d’une pièce du Normand Boisrobert (La Belle Plaideuse). De même que la fameuse tirade d’Harpagon qui hurle à l’assassin suite au vol de son argent, qui est un emprunt très fidèle à Larivey dans Les Esprits, lui-même s’étant largement inspiré de Plaute, ce dernier calquant sa pièce sur celles de Ménandre et lequel encore n’était probablement pas le premier à tirer le portrait de l’avarice maladive.
Quatrièmement, l’intérêt, dans la construction et pour la structure de la pièce, d’avoir surajouté des histoires d’amour alambiquées, croisées, compliquées, bancales opposant les pères et les fils parmi les frères et les sœurs ne m’apparaît pas clairement pour l’efficacité du portrait caricatural du vieil avare maniaque et pathologique qu’il se propose de brosser. Voire, et c’est mon point de vue, tout ce fouillis, ce cafouillis, ce brouhaha ne fait qu’affaiblir la puissance et la justesse de la satire.
Cinquièmement, le coming-out final est d’une nullité affligeante, qui sent le bâclé et qui plante le spectateur au milieu d’une fin décidément trop facile et trop faiblarde. On est très loin des très bonnes comédies de caractère de Molière comme Le Malade Imaginaire ou Le Bourgeois Gentilhomme. Finalement, tout bien pesé, je préfère l’avare de Plaute (La Marmite) à celui de Molière, mais cela n’engage que moi.
Bon, ceci étant dit, je me sens un peu dure car Molière reste Molière, et, même en petite forme, sa pièce reste supportable et de temps en temps très agréable, mais ce n’est pas le Molière des grands soirs, du moins c’est mon avis, c’est-à-dire, rien de bien numéraire ni très sonnant et encore moins trébuchant à mettre dans la cassette d’Harpagon… autant dire, pas grand-chose.
La version du Tartuffe que nous connaissons n'est pas la pièce féroce, la bourrade farouchement anticléricale qu'avait tout d'abord écrite Molière et qui plaisait au roi.
Celle qui subsiste est une version remaniée, aménagée, allégée, adoucie, amoindrie, ramollie pour la rendre acceptable par le clergé d'alors car Louis XIV avait beau apprécier son dramaturge, il ne pouvait se passer de l'église pour mener sa politique, illustrant avant l'heure la vision exprimée si clairement par Napoléon, comme quoi, pour gouverner il n'avait pas besoin de dieu, mais de religion, si.
La version originale du Tartuffe est encore l'objet de discussions et discordes, les uns prétextant qu'elle n'était pas très différente, les autres arguant que l'imposteur à la fin tirait tous les bénéfices au déni total de toute forme de moralité. Hormis qu'elle devait comporter trois actes au lieu de cinq actuellement, le fin mot de tout ça, le vrai du faux, nous ne l'auront probablement jamais.
Cette pièce n'en demeure pas moins, malgré ou en raison des transformations qu'elle a dû subir, l'un des fleurons de l'auteur. C'est l'une des toutes premières très grandes comédies que nous a légué Molière et elle est remarquable à plus d'un titre.
Tout d'abord, d'un point de vue scénique et dramaturgique, il réussit une entrée en scène particulièrement tonitruante sous la houlette de Madame Pernelle. Cependant, le tour d'astuce, le trait de génie de Molière dans cette pièce est de faire en sorte que du personnage central on n'entende parler que par jugements interposés et que sa voix vraiment, pendant deux actes pleins, on ne l'entende point.
Ainsi c'est l'aptitude des uns et des autres à nous convaincre (plus qu'une réflexion qui nous serait propre) qui nous place dans les dispositions voulues pour accueillir Tartuffe en l'exécrant avant même de l'avoir rencontré. de la sorte, le chemin de pensée des autres, on se le fait sien ; procédé particulièrement efficace et payant scénographiquement parlant.
L'un des grands points forts de cette comédie est aussi la qualité remarquable de son écriture, où certains de ses vers souffrent la comparaison avec les grands tragédiens d'alors. Au passage, j'en profite pour mentionner que Molière, au travers du personnage de la servante Dorine, l'un des personnages les plus lucides de la composition, règle son compte à la tragédie, jugez plutôt :
« DORINE :
Sur cette union quelle est donc votre attente ?
MARIANE :
De me donner la mort si l'on me violente.
DORINE :
Fort bien : c'est un recours où je ne songeais pas ;
Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras ;
Le remède sans doute est merveilleux. J'enrage
Lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. »
Si ce n'est pas une petite pierre lancée dans le jardin de Corneille et Racine, je ne m'y connais plus.
Sur les procédés comiques proprement dits, il faut encore louer cette trouvaille de nom : Tartuffe. Un nom qui évoque à la fois la tarte et la truffe, sans oublier le tuf, cette roche poreuse et de faible qualité mais qui fait illusion, véritable allégorie du personnage qu'elle désigne.
Sans oublier que la double consonance en « t » ne jouit pas d'un grand prestige en français car elle rappelle des mots comme tordu, tortueux, tortillard ou surtout tartine comme nous le laisse entendre le vers 674 : « Non, vous serez, ma foi ! tartuffiée. »
Outre ce déluge d'éloges que je dresse depuis tout à l'heure, il me faut quand même admettre que le comique de cette pièce n'est pas toujours très fort. Quel dommage en effet que Molière ait la passion des gags récurrents et des quiproquos à gros sabots que, personnellement, je trouve assez lourdingues, alors qu'il sait si bien sans cela, à d'autres endroits, dans la teneur d'une réplique, manier force et finesse, et envoyer son fait et bien mieux faire rire qu'avec ces gags poussifs, gros comme des menhirs. Mais bon, c'est ainsi, c'est la marque d'une époque, sachons trier les bons grains de l'ivraie dont cette moisson foisonne.
En deux mots, la trame, quelle est-elle ? Nous avons Orgon, l'inévitable gros bourgeois ou faible aristocrate, qui possède plus de richesse que de discernement. Cette fois-ci, il s'est entiché d'un miséreux, fort dévot, qui par ses cajoleries a su s'attirer toutes les grâces du maître de maison au point d'être logé, choyé, écouté et grassement rétribué sous ses airs de serviteur de la foi. Vous avez bien sûr reconnu le Tartuffe. (Un type de personne, le faux dévot, qui ne devait pas être rare à l'époque puisque La Bruyère les étrille copieusement aussi dans ses Caractères.)
La sauce prend un tour aigre lorsque notre brave Orgon, tellement hypnotisé par les hautes valeurs du Tartuffe, décide de lui octroyer la main de sa fille Mariane, laquelle main était déjà promise de longue date à l'honorable Valère. Mais c'est plutôt la nouvelle femme d'Orgon, Elmire, que le Tartuffe mire. La femme, la fille, l'argent… que faudra-t-il encore au vorace Tartuffe ? C'est ce que je m'autorise à ne vous pas dire.
C'est donc du très bon Molière, à l'écriture magnifique, avec la limitation que j'ai exprimée plus haut sur la teneur du comique ainsi que celle que je fais maintenant, sur la thématique du faux dévot, plus exactement d'actualité, car plus spécialement un mal qui gangrène la société, même si le trait de caractère qu'elle dénonce, l'hypocrisie, la fourberie et la voix double, font merveille aujourd'hui comme alors, et pour longtemps encore car c'est là quelque trait constitutif, universel chez l'humain. Mais tout ceci bien sûr, ne représente que mon avis, un parmi tellement d'autres, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Celle qui subsiste est une version remaniée, aménagée, allégée, adoucie, amoindrie, ramollie pour la rendre acceptable par le clergé d'alors car Louis XIV avait beau apprécier son dramaturge, il ne pouvait se passer de l'église pour mener sa politique, illustrant avant l'heure la vision exprimée si clairement par Napoléon, comme quoi, pour gouverner il n'avait pas besoin de dieu, mais de religion, si.
La version originale du Tartuffe est encore l'objet de discussions et discordes, les uns prétextant qu'elle n'était pas très différente, les autres arguant que l'imposteur à la fin tirait tous les bénéfices au déni total de toute forme de moralité. Hormis qu'elle devait comporter trois actes au lieu de cinq actuellement, le fin mot de tout ça, le vrai du faux, nous ne l'auront probablement jamais.
Cette pièce n'en demeure pas moins, malgré ou en raison des transformations qu'elle a dû subir, l'un des fleurons de l'auteur. C'est l'une des toutes premières très grandes comédies que nous a légué Molière et elle est remarquable à plus d'un titre.
Tout d'abord, d'un point de vue scénique et dramaturgique, il réussit une entrée en scène particulièrement tonitruante sous la houlette de Madame Pernelle. Cependant, le tour d'astuce, le trait de génie de Molière dans cette pièce est de faire en sorte que du personnage central on n'entende parler que par jugements interposés et que sa voix vraiment, pendant deux actes pleins, on ne l'entende point.
Ainsi c'est l'aptitude des uns et des autres à nous convaincre (plus qu'une réflexion qui nous serait propre) qui nous place dans les dispositions voulues pour accueillir Tartuffe en l'exécrant avant même de l'avoir rencontré. de la sorte, le chemin de pensée des autres, on se le fait sien ; procédé particulièrement efficace et payant scénographiquement parlant.
L'un des grands points forts de cette comédie est aussi la qualité remarquable de son écriture, où certains de ses vers souffrent la comparaison avec les grands tragédiens d'alors. Au passage, j'en profite pour mentionner que Molière, au travers du personnage de la servante Dorine, l'un des personnages les plus lucides de la composition, règle son compte à la tragédie, jugez plutôt :
« DORINE :
Sur cette union quelle est donc votre attente ?
MARIANE :
De me donner la mort si l'on me violente.
DORINE :
Fort bien : c'est un recours où je ne songeais pas ;
Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras ;
Le remède sans doute est merveilleux. J'enrage
Lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. »
Si ce n'est pas une petite pierre lancée dans le jardin de Corneille et Racine, je ne m'y connais plus.
Sur les procédés comiques proprement dits, il faut encore louer cette trouvaille de nom : Tartuffe. Un nom qui évoque à la fois la tarte et la truffe, sans oublier le tuf, cette roche poreuse et de faible qualité mais qui fait illusion, véritable allégorie du personnage qu'elle désigne.
Sans oublier que la double consonance en « t » ne jouit pas d'un grand prestige en français car elle rappelle des mots comme tordu, tortueux, tortillard ou surtout tartine comme nous le laisse entendre le vers 674 : « Non, vous serez, ma foi ! tartuffiée. »
Outre ce déluge d'éloges que je dresse depuis tout à l'heure, il me faut quand même admettre que le comique de cette pièce n'est pas toujours très fort. Quel dommage en effet que Molière ait la passion des gags récurrents et des quiproquos à gros sabots que, personnellement, je trouve assez lourdingues, alors qu'il sait si bien sans cela, à d'autres endroits, dans la teneur d'une réplique, manier force et finesse, et envoyer son fait et bien mieux faire rire qu'avec ces gags poussifs, gros comme des menhirs. Mais bon, c'est ainsi, c'est la marque d'une époque, sachons trier les bons grains de l'ivraie dont cette moisson foisonne.
En deux mots, la trame, quelle est-elle ? Nous avons Orgon, l'inévitable gros bourgeois ou faible aristocrate, qui possède plus de richesse que de discernement. Cette fois-ci, il s'est entiché d'un miséreux, fort dévot, qui par ses cajoleries a su s'attirer toutes les grâces du maître de maison au point d'être logé, choyé, écouté et grassement rétribué sous ses airs de serviteur de la foi. Vous avez bien sûr reconnu le Tartuffe. (Un type de personne, le faux dévot, qui ne devait pas être rare à l'époque puisque La Bruyère les étrille copieusement aussi dans ses Caractères.)
La sauce prend un tour aigre lorsque notre brave Orgon, tellement hypnotisé par les hautes valeurs du Tartuffe, décide de lui octroyer la main de sa fille Mariane, laquelle main était déjà promise de longue date à l'honorable Valère. Mais c'est plutôt la nouvelle femme d'Orgon, Elmire, que le Tartuffe mire. La femme, la fille, l'argent… que faudra-t-il encore au vorace Tartuffe ? C'est ce que je m'autorise à ne vous pas dire.
C'est donc du très bon Molière, à l'écriture magnifique, avec la limitation que j'ai exprimée plus haut sur la teneur du comique ainsi que celle que je fais maintenant, sur la thématique du faux dévot, plus exactement d'actualité, car plus spécialement un mal qui gangrène la société, même si le trait de caractère qu'elle dénonce, l'hypocrisie, la fourberie et la voix double, font merveille aujourd'hui comme alors, et pour longtemps encore car c'est là quelque trait constitutif, universel chez l'humain. Mais tout ceci bien sûr, ne représente que mon avis, un parmi tellement d'autres, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Certains me reprochent parfois cette manière que j'ai de terminer mes avis par la petite ritournelle " ceci n'est que mon avis, c'est-à-dire, pas grand-chose ". Il n'est pourtant rien de plus vrai à mes yeux et, si reproche on doit faire à cette ritournelle, c'est sur son imprécision. La forme correcte devrait être " ceci n'est que mon avis DU MOMENT, c'est-à-dire, pas grand-chose. "
En effet, il m'arrive quelquefois de ne pas me trouver d'accord avec moi-même. Entre ces deux moi(s), s'étalent parfois deux décennies. Et c'est le cas ici avec Dom Juan.
J'ai lu cette pièce pour la première fois alors que j'essuyais encore les bancs du lycée avec mes robes à fleurs. Et le Dom Juan d'alors ne m'avait pas séduite. Une pièce plate, sans farouche déplaisir, mais absolument sans enthousiasme. Et cette fin surprenante m'avait totalement laissée insatisfaite.
C'était donc un souvenir tout ce qu'il y a de plus médiocre. Très récemment, je viens de relire Dom Juan, et là, rien n'est pareil. Là j'ai pris plaisir, là je comprends pourquoi cette pièce est si connue et si réputée. Mais quel est le bon avis ? Celui d'alors ou celui de maintenant ? Probablement aucun des deux. Les deux sont valables, les deux ont leur légitimité propre et les deux sont superflus, les deux ne veulent dire que ce que ressent ma sensibilité du moment, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Il est vrai que j'ai désormais en mémoire l'original de Tirso de Molina. Ceci me permets de mesurer les distorsions, les innovations, les apports et parfois les entorses faites par Molière à la trame originale.
La statue du commandeur est quasi incompréhensible chez Molière alors qu'elle représentait chez Tirso de Molina le père noble d'une femme sincère humiliée. Un vieux père qui avait trouvé assez de courage, malgré son grand âge, pour aller défier le jeune et fringant Dom Juan, qui l'avait alors terrassé sans coup férir. La statue du commandeur venait décorer le monument élevé sur la tombe de ce noble seigneur disparu et Dom Juan avait encore trouvé le moyen de provoquer le souvenir même de cet homme en s'adressant à la statue comme pour la ridiculiser.
On comprenait le pourquoi du comment et la symbolique de cette statue de pierre. Ici, c'est beaucoup plus nébuleux et — je crois — c'est fait exprès. Notons au passage que la pièce originale avait pour titre complet L'Abuseur De Séville Ou Le Convive De Pierre, lequel convive de pierre s'est transformé en festin de Pierre, dont on ignore bien de quel individu nommé Pierre il s'agit... mystère...
Autant le dramaturge espagnol dénonçait sans ambages les dérives libertines de la noblesse, et en ce sens, l'œuvre française la plus proche serait probablement Les Liaisons Dangereuses de Laclos, autant Molière semble avoir quelque affection pour son héros, on sent que derrière le discours officiel qu'il fallait tenir devant le roi et surtout devant les autorités ecclésiastiques, il y a un vrai pied-de-nez de Molière qui n'en pense pas un traitre mot. Il initie donc une tendance nouvelle qui consiste à trouver une certaine grandeur à Dom Juan, ce que ses suiveurs reprendront parfois à leur compte, tel Pouchkine.
On comprend aussi le Dom Juan de Molière quand on le replace dans la filiation des pièces de son auteur, juste après le Tartuffe, pièce qui dénonçait l'hypocrisie et les faux dévots. Car je crois bien que ce n'est pas tant la question des femmes qui est ici en jeu qu'un bras de fer avec la religion.
Et le message du Poquelin est, à l'exacte image du Tartuffe, que ceux qui crient, qui hurlent, qui martèlent en public leur foi et leur conduite irréprochable selon les prescriptions divines n'en sont pas moins en privé d'avérés coquins et qui prennent donc le monde pour un petit enfant naïf.
On sent que Molière veut que son Dom Juan soit apprécié. Ce n'est pas un couard, il est capable de sentiments nobles, il veut penser par lui-même et non ce qu'on lui dit de penser. Il veut sa totale liberté et s'il perd sa franchise, s'il devient hypocrite, c'est seulement à cause des autres, à cause du carcan de la morale.
C'est un cartésien et un viveur, il veut prendre les plaisirs là où ils sont et exprime clairement sa relation à la femme comme une lutte, une bataille de tous les instants. Pour lui, si la femme n'est pas assez experte pour exciter toujours la brûlure du désir, alors elle n'a pas d'intérêt. D'une certaine manière, selon son raisonnement, si la femme est trompée, c'est de sa faute. D'ailleurs, Done Elvire, lorsqu'elle redevient inaccessible retrouve du même coup un surcroît d'intérêt à ses yeux.
Avec Dom Juan, une nouvelle fois, Molière fait dans le commercial (j'ai déjà eu l'occasion d'argumenter ce point, notamment pour les Fourberies de Scapin). La pièce, créée 35 ans plus tôt en Espagne avait été abondamment reprise par les Italiens et elle faisait régulièrement salle comble à Paris, sous diverses formes remaniées. Certes, on peut peut-être lui en faire reproche encore une fois, mais il a le génie de savoir lui insuffler sa touche à lui, et quelque chose qui apporte à l'épaisseur et à la complexité du personnage.
Cette pièce, qui était une tragi-comédie à l'origine en Espagne, devient franchement plus burlesque entre ses mains, tout en ne lâchant rien sur le propos entamé dans Le Tartuffe avec lequel il pourrait presque constituer un diptyque.
Je vous conseille donc bien plus vivement qu'il y a vingt ans cette pièce mythique, au besoin, en ayant lu au préalable la version originale de Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla, qui apporte, par contraste, de nombreuses clefs de compréhension de l'œuvre de Molière.
Mais ceci, bien sûr, n'est que mon avis du moment, c'est-à-dire, bien peu de chose.
En effet, il m'arrive quelquefois de ne pas me trouver d'accord avec moi-même. Entre ces deux moi(s), s'étalent parfois deux décennies. Et c'est le cas ici avec Dom Juan.
J'ai lu cette pièce pour la première fois alors que j'essuyais encore les bancs du lycée avec mes robes à fleurs. Et le Dom Juan d'alors ne m'avait pas séduite. Une pièce plate, sans farouche déplaisir, mais absolument sans enthousiasme. Et cette fin surprenante m'avait totalement laissée insatisfaite.
C'était donc un souvenir tout ce qu'il y a de plus médiocre. Très récemment, je viens de relire Dom Juan, et là, rien n'est pareil. Là j'ai pris plaisir, là je comprends pourquoi cette pièce est si connue et si réputée. Mais quel est le bon avis ? Celui d'alors ou celui de maintenant ? Probablement aucun des deux. Les deux sont valables, les deux ont leur légitimité propre et les deux sont superflus, les deux ne veulent dire que ce que ressent ma sensibilité du moment, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Il est vrai que j'ai désormais en mémoire l'original de Tirso de Molina. Ceci me permets de mesurer les distorsions, les innovations, les apports et parfois les entorses faites par Molière à la trame originale.
La statue du commandeur est quasi incompréhensible chez Molière alors qu'elle représentait chez Tirso de Molina le père noble d'une femme sincère humiliée. Un vieux père qui avait trouvé assez de courage, malgré son grand âge, pour aller défier le jeune et fringant Dom Juan, qui l'avait alors terrassé sans coup férir. La statue du commandeur venait décorer le monument élevé sur la tombe de ce noble seigneur disparu et Dom Juan avait encore trouvé le moyen de provoquer le souvenir même de cet homme en s'adressant à la statue comme pour la ridiculiser.
On comprenait le pourquoi du comment et la symbolique de cette statue de pierre. Ici, c'est beaucoup plus nébuleux et — je crois — c'est fait exprès. Notons au passage que la pièce originale avait pour titre complet L'Abuseur De Séville Ou Le Convive De Pierre, lequel convive de pierre s'est transformé en festin de Pierre, dont on ignore bien de quel individu nommé Pierre il s'agit... mystère...
Autant le dramaturge espagnol dénonçait sans ambages les dérives libertines de la noblesse, et en ce sens, l'œuvre française la plus proche serait probablement Les Liaisons Dangereuses de Laclos, autant Molière semble avoir quelque affection pour son héros, on sent que derrière le discours officiel qu'il fallait tenir devant le roi et surtout devant les autorités ecclésiastiques, il y a un vrai pied-de-nez de Molière qui n'en pense pas un traitre mot. Il initie donc une tendance nouvelle qui consiste à trouver une certaine grandeur à Dom Juan, ce que ses suiveurs reprendront parfois à leur compte, tel Pouchkine.
On comprend aussi le Dom Juan de Molière quand on le replace dans la filiation des pièces de son auteur, juste après le Tartuffe, pièce qui dénonçait l'hypocrisie et les faux dévots. Car je crois bien que ce n'est pas tant la question des femmes qui est ici en jeu qu'un bras de fer avec la religion.
Et le message du Poquelin est, à l'exacte image du Tartuffe, que ceux qui crient, qui hurlent, qui martèlent en public leur foi et leur conduite irréprochable selon les prescriptions divines n'en sont pas moins en privé d'avérés coquins et qui prennent donc le monde pour un petit enfant naïf.
On sent que Molière veut que son Dom Juan soit apprécié. Ce n'est pas un couard, il est capable de sentiments nobles, il veut penser par lui-même et non ce qu'on lui dit de penser. Il veut sa totale liberté et s'il perd sa franchise, s'il devient hypocrite, c'est seulement à cause des autres, à cause du carcan de la morale.
C'est un cartésien et un viveur, il veut prendre les plaisirs là où ils sont et exprime clairement sa relation à la femme comme une lutte, une bataille de tous les instants. Pour lui, si la femme n'est pas assez experte pour exciter toujours la brûlure du désir, alors elle n'a pas d'intérêt. D'une certaine manière, selon son raisonnement, si la femme est trompée, c'est de sa faute. D'ailleurs, Done Elvire, lorsqu'elle redevient inaccessible retrouve du même coup un surcroît d'intérêt à ses yeux.
Avec Dom Juan, une nouvelle fois, Molière fait dans le commercial (j'ai déjà eu l'occasion d'argumenter ce point, notamment pour les Fourberies de Scapin). La pièce, créée 35 ans plus tôt en Espagne avait été abondamment reprise par les Italiens et elle faisait régulièrement salle comble à Paris, sous diverses formes remaniées. Certes, on peut peut-être lui en faire reproche encore une fois, mais il a le génie de savoir lui insuffler sa touche à lui, et quelque chose qui apporte à l'épaisseur et à la complexité du personnage.
Cette pièce, qui était une tragi-comédie à l'origine en Espagne, devient franchement plus burlesque entre ses mains, tout en ne lâchant rien sur le propos entamé dans Le Tartuffe avec lequel il pourrait presque constituer un diptyque.
Je vous conseille donc bien plus vivement qu'il y a vingt ans cette pièce mythique, au besoin, en ayant lu au préalable la version originale de Tirso de Molina, El Burlador de Sevilla, qui apporte, par contraste, de nombreuses clefs de compréhension de l'œuvre de Molière.
Mais ceci, bien sûr, n'est que mon avis du moment, c'est-à-dire, bien peu de chose.
C’est terrible quand la légende, quand la vie rêvée de quelqu’un dont on aimerait faire une idole, se voit contredite, mise à mal, voire mise en pièces par les éléments patents de la réalité. Plus j’explore les arcanes sombres des archives théâtrales, plus je vogue dans l’histoire dramatique mondiale, plus je lis à droite et à gauche, et plus je découvre de petits faits qui viennent entacher la belle aura de mon Molière.
Dès le collège, j’ai rencontré Molière et ai de suite aimé, emportée par son ton, sa plume, son traitement scénique.
J’ai adoré Le Bourgeois Gentilhomme puis vint le moment, peu de temps après, de ma rencontre avec Les Fourberies De Scapin.
Je crois que j’avais encore mieux aimé cette dernière, j’avais fait des pieds et des mains pour que nous montions la pièce avec notre prof de français qui s’était laissée vaincre par mes élans d’enthousiasme, si rares (déjà pour l’époque nous disait-elle) chez les collégiens moyens que nous étions.
J’ai relu récemment un certain nombre de pièces de Molière ; certaines m’ayant fort déçues, d’autres, c’est le cas du Malade Imaginaire ou des Fourberies De Scapin, ayant tenu toutes leurs promesses.
Me voilà rassurée, le talent de mon idole du collège n’a pas tant terni que cela. Mais dans le même temps, je découvre beaucoup de pièces antiques, de Plaute ou Térence, notamment, je lis des auteurs français moins connus du XVIIème siècle et là, je me rends compte, que beaucoup de ce que je crois être du Molière est un repompage quasi intégral d’autres auteurs. Je me rends compte également que nombreuses sont les thèses de doctorat, les études, les critiques et les analyses sur la paternité réelle de Molière sur « ses » pièces.
Les bras m’en tombent, il faut que j’aille voir ça moi-même. Pas Scapin, tout de même, pas lui que j’aime tant, non, ce n’est pas possible à la fin !
Et si, ma grande, encore une désillusion, encore un mensonge dans la liste si longue des histoires qui te répugnent et que tu ne voudrais pas connaître...
L’ossature des Fourberies est en fait la pièce de Térence intitulée Phormion. Le traitement de la pièce est une recopie intégrale des fameuses farces de la Commedia Dell'Arte. Et enfin, le coup de grâce, la scène, non !, pas la scène, LA scène, le fameux « Mais que diable allait-il faire dans cette galère ! », même celle-là n’est pas de lui. C’est un authentique plagiat de Cyrano de Bergerac dans sa pièce Le Pédant Joué de 1654.
Le talent de Molière ne serait-il que d’être un génial compilateur ? Aïe ! que j’ai mal à ma légende, que son image se brise et s’effrite ! Sans compter que l’analyse académique très pointue réalisée en 2008 sur le lexique de sa pièce en vers Le Tartuffe révèle avec une quasi certitude qu’elle aurait été écrite par Corneille, et PAN ! encore une vitrine qui s’effondre.
Je découvre que dès l’époque on lui reproche ses plagiats et que c’est même la principale critique à son talent, tant d’écrivain que d’acteur que de metteur en scène (de nos jours il ne nous reste que les textes, mais il semble bien que sur le jeu d’acteur, les costumes et la mise en scène, c’était pareil). On lui reproche de copier tout ce qui marche ou qui a du succès et de le faire sien puis de se l’attribuer en propre.
Aïe ! ma légende, que je souffre tout d’un coup à vouloir te conserver. Il me reste soit le choix de te piétiner, soit celui de fermer mes écoutilles et de ne rien entendre, de continuer à te vénérer comme dans n’importe quelle croyance divine quelles que soient les preuves matérielles irréfutables. Je ne sais encore que choisir. Et la langue de Molière, alors ? Ne parlerais-je que le tissu plagiaire d’une bordée d’anonymes ?! C’est bien possible.
Ah ! Les Fourberies de Poquelin ! Un faquin ce Molière, en somme. On sait qu'il aurait beaucoup souhaité s'adonner au drame satyrique, voire à la tragédie plutôt qu'à la comédie. Et il est vrai que sa soif d'exprimer des messages sociaux ou politiques forts fut parfois muselée tant par la férule du roi soleil et de sa cour que par le style auquel il fut, un peu contre son gré, cantonné. Est-ce la raison intime pour laquelle Molière se serait adonné ainsi à la comédie, en faisant "ce qu'on lui demande" ou bien "ce qui marche auprès du public" et en s’y investissant personnellement assez peu pour ne pas répugner de voler de la matière à d’autres ? C’est ce que j’ai envie de croire. On a du mal à se figurer le réseau de contraintes qui s’exerçaient sur un artiste tel que lui à l’époque et c’est l’excuse que je veux lui donner.
Pourtant il faut bien que je vous parle de cette pièce. Ici, on peut dire que Molière fait si bien ce pourquoi on l’attend, réalise une pièce si réussie de bout en bout que cette comédie est devenue un archétype, que dis-je, LA comédie par excellence. Pas de message fort, pas de grande dénonciation (même si l'on voit poindre deci-delà des piques envers qui vous savez), par contre, un jeu scénique réglé au millimètre (même si le millimètre n'existait pas encore !), des gags et des dialogues qui font mouche, notamment, la fameuse scène 7 de l'acte II entre Géronte et Scapin et sa sublime récurrence « Que diable allait-il faire dans cette galère ? » qui est passée dans le langage courant (et ça, c’est bien à Molière qu’on le doit et non à Cyrano de Bergerac).
J'oserais presque, si vous me le permettiez, tenter une comparaison entre Molière et René Goscinny, qui lui aussi aurait tant souhaité se faire remarquer autrement que par des sujets légers et qui lui aussi nous a légué de ces récurrences géniales du genre : « les derniers irréductibles », « être tombé dedans quand on était petit », « vouloir être calife à la place du calife », « tirer plus vite que son ombre », etc., etc. En somme, la prochaine fois que vous direz « Pouah ! quelle galère ! », sachez que Monsieur Molière y est peut-être pour quelque chose, même s’il n’en est pas le géniteur véritable et authentifié.
L'histoire, c'est à peine si j'ose tellement elle est connue de tous. Deux fils de bourgeois tombés amoureux, contre la volonté de leur père avare respectif, de deux filles belles comme l'aube mais dont le mariage est impossible. Par l'entremise de Scapin et de sa roublardise, il faudra arriver à arranger tout ça et, si possible, rogner quelques écus au passage aux deux vieux radins. Tout s'arrangera bien vraisemblablement, mais au fait, j'y pense, qui sont-elles ces deux beautés féminines ?
Et malgré tout ce que j’ai écrit plus haut, malgré toutes les limitations qu’on peut faire, quel bonheur quand Molière fait s'agiter les personnages autour de nous comme une volée de moineaux en cage, c'est drôle, c’est plaisant, c’est vivant, c’est du grand théâtre et ça se mange sans faim, du moins c'est mon avis, mon tout petit avis, plus petit et piteux aujourd’hui que jamais, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Dès le collège, j’ai rencontré Molière et ai de suite aimé, emportée par son ton, sa plume, son traitement scénique.
J’ai adoré Le Bourgeois Gentilhomme puis vint le moment, peu de temps après, de ma rencontre avec Les Fourberies De Scapin.
Je crois que j’avais encore mieux aimé cette dernière, j’avais fait des pieds et des mains pour que nous montions la pièce avec notre prof de français qui s’était laissée vaincre par mes élans d’enthousiasme, si rares (déjà pour l’époque nous disait-elle) chez les collégiens moyens que nous étions.
J’ai relu récemment un certain nombre de pièces de Molière ; certaines m’ayant fort déçues, d’autres, c’est le cas du Malade Imaginaire ou des Fourberies De Scapin, ayant tenu toutes leurs promesses.
Me voilà rassurée, le talent de mon idole du collège n’a pas tant terni que cela. Mais dans le même temps, je découvre beaucoup de pièces antiques, de Plaute ou Térence, notamment, je lis des auteurs français moins connus du XVIIème siècle et là, je me rends compte, que beaucoup de ce que je crois être du Molière est un repompage quasi intégral d’autres auteurs. Je me rends compte également que nombreuses sont les thèses de doctorat, les études, les critiques et les analyses sur la paternité réelle de Molière sur « ses » pièces.
Les bras m’en tombent, il faut que j’aille voir ça moi-même. Pas Scapin, tout de même, pas lui que j’aime tant, non, ce n’est pas possible à la fin !
Et si, ma grande, encore une désillusion, encore un mensonge dans la liste si longue des histoires qui te répugnent et que tu ne voudrais pas connaître...
L’ossature des Fourberies est en fait la pièce de Térence intitulée Phormion. Le traitement de la pièce est une recopie intégrale des fameuses farces de la Commedia Dell'Arte. Et enfin, le coup de grâce, la scène, non !, pas la scène, LA scène, le fameux « Mais que diable allait-il faire dans cette galère ! », même celle-là n’est pas de lui. C’est un authentique plagiat de Cyrano de Bergerac dans sa pièce Le Pédant Joué de 1654.
Le talent de Molière ne serait-il que d’être un génial compilateur ? Aïe ! que j’ai mal à ma légende, que son image se brise et s’effrite ! Sans compter que l’analyse académique très pointue réalisée en 2008 sur le lexique de sa pièce en vers Le Tartuffe révèle avec une quasi certitude qu’elle aurait été écrite par Corneille, et PAN ! encore une vitrine qui s’effondre.
Je découvre que dès l’époque on lui reproche ses plagiats et que c’est même la principale critique à son talent, tant d’écrivain que d’acteur que de metteur en scène (de nos jours il ne nous reste que les textes, mais il semble bien que sur le jeu d’acteur, les costumes et la mise en scène, c’était pareil). On lui reproche de copier tout ce qui marche ou qui a du succès et de le faire sien puis de se l’attribuer en propre.
Aïe ! ma légende, que je souffre tout d’un coup à vouloir te conserver. Il me reste soit le choix de te piétiner, soit celui de fermer mes écoutilles et de ne rien entendre, de continuer à te vénérer comme dans n’importe quelle croyance divine quelles que soient les preuves matérielles irréfutables. Je ne sais encore que choisir. Et la langue de Molière, alors ? Ne parlerais-je que le tissu plagiaire d’une bordée d’anonymes ?! C’est bien possible.
Ah ! Les Fourberies de Poquelin ! Un faquin ce Molière, en somme. On sait qu'il aurait beaucoup souhaité s'adonner au drame satyrique, voire à la tragédie plutôt qu'à la comédie. Et il est vrai que sa soif d'exprimer des messages sociaux ou politiques forts fut parfois muselée tant par la férule du roi soleil et de sa cour que par le style auquel il fut, un peu contre son gré, cantonné. Est-ce la raison intime pour laquelle Molière se serait adonné ainsi à la comédie, en faisant "ce qu'on lui demande" ou bien "ce qui marche auprès du public" et en s’y investissant personnellement assez peu pour ne pas répugner de voler de la matière à d’autres ? C’est ce que j’ai envie de croire. On a du mal à se figurer le réseau de contraintes qui s’exerçaient sur un artiste tel que lui à l’époque et c’est l’excuse que je veux lui donner.
Pourtant il faut bien que je vous parle de cette pièce. Ici, on peut dire que Molière fait si bien ce pourquoi on l’attend, réalise une pièce si réussie de bout en bout que cette comédie est devenue un archétype, que dis-je, LA comédie par excellence. Pas de message fort, pas de grande dénonciation (même si l'on voit poindre deci-delà des piques envers qui vous savez), par contre, un jeu scénique réglé au millimètre (même si le millimètre n'existait pas encore !), des gags et des dialogues qui font mouche, notamment, la fameuse scène 7 de l'acte II entre Géronte et Scapin et sa sublime récurrence « Que diable allait-il faire dans cette galère ? » qui est passée dans le langage courant (et ça, c’est bien à Molière qu’on le doit et non à Cyrano de Bergerac).
J'oserais presque, si vous me le permettiez, tenter une comparaison entre Molière et René Goscinny, qui lui aussi aurait tant souhaité se faire remarquer autrement que par des sujets légers et qui lui aussi nous a légué de ces récurrences géniales du genre : « les derniers irréductibles », « être tombé dedans quand on était petit », « vouloir être calife à la place du calife », « tirer plus vite que son ombre », etc., etc. En somme, la prochaine fois que vous direz « Pouah ! quelle galère ! », sachez que Monsieur Molière y est peut-être pour quelque chose, même s’il n’en est pas le géniteur véritable et authentifié.
L'histoire, c'est à peine si j'ose tellement elle est connue de tous. Deux fils de bourgeois tombés amoureux, contre la volonté de leur père avare respectif, de deux filles belles comme l'aube mais dont le mariage est impossible. Par l'entremise de Scapin et de sa roublardise, il faudra arriver à arranger tout ça et, si possible, rogner quelques écus au passage aux deux vieux radins. Tout s'arrangera bien vraisemblablement, mais au fait, j'y pense, qui sont-elles ces deux beautés féminines ?
Et malgré tout ce que j’ai écrit plus haut, malgré toutes les limitations qu’on peut faire, quel bonheur quand Molière fait s'agiter les personnages autour de nous comme une volée de moineaux en cage, c'est drôle, c’est plaisant, c’est vivant, c’est du grand théâtre et ça se mange sans faim, du moins c'est mon avis, mon tout petit avis, plus petit et piteux aujourd’hui que jamais, c'est-à-dire, pas grand-chose.
George Dindon de la farce, pardon George Dandin, au milieu de la "basse-cour "de Louis XIV... Il fut surnommé Monsieur de la Dandinière !
Cette comédie- ballet la première fois à Versailles, avec une musique de Lully, le 18 juillet 166, en présence du Roy.
Pauvre George Dandin qui se... dandine d'une condition de paysan à celui de mari d'une jeune femme, fille de nobliaux ruinés...
Plus habitué aux bestiaux dont il aime flatter la croupe qu'aux belles manières, George a épousé la jolie Angélique de Sotenville. La malheureuse a été forcée au mariage alors qu'elle a déjà un amoureux nommé Clitandre, gentilhomme libertin..
Ah vacherie!
" Une jolie fleur dans une peau de vache
Une jolie vache déguisée en fleur
Qui fait la belle et qui vous attache
Puis qui vous mène par le bout du coeur"
George essaiera de faire traire, euh taire Angélique! Ca ira, ( Ah ça ira, ça ira, ça ira) de mal en pis. car la belle n'a pas sa langue dans sa poche.
Féminisme naissant ( liberté de la femme ) et lutte des classes.
-"Pour moi, qui ne vous ai point dit de vous marier avec moi, et que vous avez prise sans consulter mes sentiments, je prétends n'être point obligée de me soumettre en esclave à vos volontés ; et je veux jouir, s'il vous plaît, de quelque nombre de beaux jours que m'offre la jeunesse, prendre les douces libertés que l'âge me permet, voir un peu le beau monde, et goûter le plaisir de m'ouïr dire des douceurs" jette Angélique.
George surprend Angélique et Clitandre...
Devant ses parents, Angélique feint de vouloir rosser son prétendant... Mais, c'est George que tombent les coups de bâton généreusement administrés par Angélique. Ravis, les Sots , pardon les Sotenville félicitent leur fille, et il s'en faut de peu que George Dandin ne soit obligé de remercier Angélique, pour son comportement exemplaire.
Quelques années plus tard, après que de Sotenville, le beau père, a fait tombé violemment le bonnet de George Dandin, comment ne pas penser à la lutte des classes avec:
"Dansons la Carmagnole" et "Ah, ça ira : les aristocrates on les pendra..."
Ca ira... mal et ça coupera le ...sifflet à un Roi de France!
Cette comédie- ballet la première fois à Versailles, avec une musique de Lully, le 18 juillet 166, en présence du Roy.
Pauvre George Dandin qui se... dandine d'une condition de paysan à celui de mari d'une jeune femme, fille de nobliaux ruinés...
Plus habitué aux bestiaux dont il aime flatter la croupe qu'aux belles manières, George a épousé la jolie Angélique de Sotenville. La malheureuse a été forcée au mariage alors qu'elle a déjà un amoureux nommé Clitandre, gentilhomme libertin..
Ah vacherie!
" Une jolie fleur dans une peau de vache
Une jolie vache déguisée en fleur
Qui fait la belle et qui vous attache
Puis qui vous mène par le bout du coeur"
George essaiera de faire traire, euh taire Angélique! Ca ira, ( Ah ça ira, ça ira, ça ira) de mal en pis. car la belle n'a pas sa langue dans sa poche.
Féminisme naissant ( liberté de la femme ) et lutte des classes.
-"Pour moi, qui ne vous ai point dit de vous marier avec moi, et que vous avez prise sans consulter mes sentiments, je prétends n'être point obligée de me soumettre en esclave à vos volontés ; et je veux jouir, s'il vous plaît, de quelque nombre de beaux jours que m'offre la jeunesse, prendre les douces libertés que l'âge me permet, voir un peu le beau monde, et goûter le plaisir de m'ouïr dire des douceurs" jette Angélique.
George surprend Angélique et Clitandre...
Devant ses parents, Angélique feint de vouloir rosser son prétendant... Mais, c'est George que tombent les coups de bâton généreusement administrés par Angélique. Ravis, les Sots , pardon les Sotenville félicitent leur fille, et il s'en faut de peu que George Dandin ne soit obligé de remercier Angélique, pour son comportement exemplaire.
Quelques années plus tard, après que de Sotenville, le beau père, a fait tombé violemment le bonnet de George Dandin, comment ne pas penser à la lutte des classes avec:
"Dansons la Carmagnole" et "Ah, ça ira : les aristocrates on les pendra..."
Ca ira... mal et ça coupera le ...sifflet à un Roi de France!
L'Avare c'est pour moi une des meilleures pièces de Molière.Lue en classe de quatrième,notre professeur de français nous avait fait visionner le film avec Louis de Funès afin de faire une analyse comparative entre l'adaptation cinématographique et le texte.
Le personnage d'Harpagon est juste énorme,il représente à lui tout seul les pires défauts du genre humain.En plus d'être avare,c'est un tyran,un égoiste,un sexiste et j'en passe,le tout porte à rire de sa personne tellement il est grotesque.
En général ces gens là dans la vraie vie on les évite comme la peste,mais en lecture on en redemande.Je crois que dans le genre radin on ne fait pas mieux,et dieu sait si l'avarice a été souvent traitée en littérature mais cet Harpagon possède le petit je-ne-sais-quoi qui lui garantis la place numéro un du podium des pince-maille.
A lire et à relire.
Le personnage d'Harpagon est juste énorme,il représente à lui tout seul les pires défauts du genre humain.En plus d'être avare,c'est un tyran,un égoiste,un sexiste et j'en passe,le tout porte à rire de sa personne tellement il est grotesque.
En général ces gens là dans la vraie vie on les évite comme la peste,mais en lecture on en redemande.Je crois que dans le genre radin on ne fait pas mieux,et dieu sait si l'avarice a été souvent traitée en littérature mais cet Harpagon possède le petit je-ne-sais-quoi qui lui garantis la place numéro un du podium des pince-maille.
A lire et à relire.
Une comédie plutôt féroce comme Molière savait si bien les écrire. Il se moque sans vergogne des médecins de son époque... Une comédie savoureuse, une de mes pièces préférées du grand auteur.
Je sais que je vais en faire rugir certain(e)s, mais je vais donner un avis sincère, honnête et qui n'engage que moi.
J'ai relu récemment cette pièce de Molière (chose qui ne nous arrive pas forcément si souvent car il nous reste le plus communément quelques vagues souvenirs du collège), auteur que j'adore à mille égards, et ai par conséquent une image très fraîche en tête.
Et donc, au risque de défendre une hérésie, je crois que cette pièce, contrairement à nombre d'autres de l'auteur, à fort mal vieilli, que les clefs d'écriture en sont assez grossières et que son comique reste à chercher.
Je sais, vous allez me parler du "message", qui n'a pas pris une ride, et patati et patata...
Franchement, entre quatre yeux, vous n'avez rien lu de plus fort, pêchu ou mieux senti, voire mieux exprimé pour évoquer ce même "message" ? Sans chercher bien loin je pourrais vous en citer une bonne brochette et d'autre calibre si vous me le demandiez.
D'ailleurs, même chez Molière, dans d'autres pièces on trouve mieux sur cette question. Je me suis donc mortellement ennuyée à la relecture. (Je n'avais plus aucun souvenir valable pour me faire une opinion, ceci n'est peut-être pas si anodin que cela, d'autres pièces, même en mes jeunes années. m'ont durablement marquée.)
Cela reste du Molière, ce n'est pas insupportable, Alceste a quelque chose auquel on aime s'accrocher, mais ça sent très fort la naphtaline, et je ne la conseillerais pas à quelqu'un désireux de découvrir notre "Magic Molière", lui qui a su faire tellement, tellement mieux dans d'autres pièces.
Qui suis-je donc pour dédaigner ainsi l'un de nos fleurons nationaux en matière de théâtre ? Je sais bien que nombreuses sont les personnes qui considèrent cette pièce comme un pur joyau, mais vous le noterez, les arguments de bas étage que j'évoque ne sont que mon misérable petit avis, mon ressenti brut, c'est-à-dire, pas grand-chose.
J'ai relu récemment cette pièce de Molière (chose qui ne nous arrive pas forcément si souvent car il nous reste le plus communément quelques vagues souvenirs du collège), auteur que j'adore à mille égards, et ai par conséquent une image très fraîche en tête.
Et donc, au risque de défendre une hérésie, je crois que cette pièce, contrairement à nombre d'autres de l'auteur, à fort mal vieilli, que les clefs d'écriture en sont assez grossières et que son comique reste à chercher.
Je sais, vous allez me parler du "message", qui n'a pas pris une ride, et patati et patata...
Franchement, entre quatre yeux, vous n'avez rien lu de plus fort, pêchu ou mieux senti, voire mieux exprimé pour évoquer ce même "message" ? Sans chercher bien loin je pourrais vous en citer une bonne brochette et d'autre calibre si vous me le demandiez.
D'ailleurs, même chez Molière, dans d'autres pièces on trouve mieux sur cette question. Je me suis donc mortellement ennuyée à la relecture. (Je n'avais plus aucun souvenir valable pour me faire une opinion, ceci n'est peut-être pas si anodin que cela, d'autres pièces, même en mes jeunes années. m'ont durablement marquée.)
Cela reste du Molière, ce n'est pas insupportable, Alceste a quelque chose auquel on aime s'accrocher, mais ça sent très fort la naphtaline, et je ne la conseillerais pas à quelqu'un désireux de découvrir notre "Magic Molière", lui qui a su faire tellement, tellement mieux dans d'autres pièces.
Qui suis-je donc pour dédaigner ainsi l'un de nos fleurons nationaux en matière de théâtre ? Je sais bien que nombreuses sont les personnes qui considèrent cette pièce comme un pur joyau, mais vous le noterez, les arguments de bas étage que j'évoque ne sont que mon misérable petit avis, mon ressenti brut, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Très souvent, lorsque l'on parle de Molière, les gens font la moue, balançant un "j'aime pas, c'est trop vieux" qui a le don de m'horripiler ! Mais comment ça c'est trop vieux ? Je peux comprendre que le style du XVIIe siècle puisse les bloquer un peu dans leur lecture. Mais il faut savoir être curieux. Le texte ne va pas les mordre ! Ce sont ces mêmes personnes qui sont prêtes à aller faire des safaris dans la jungle, manger des insectes etc... Donc des personnes qui sont prêtes à se mettre en danger parce que "c'est tendance" mais qui n'ont aucune attirance pour le patrimoine culturel et qui n'essaient même pas d'en comprendre les ressorts. Quelle misère !
Allez, revenons donc à ce brave Jean-Baptiste Poquelin. Ses pièces sont d'un modernisme sans nom et ce n'est pas pour rien qu'elles sont encore jouées aujourd'hui. Que raconte Le Tartuffe ? Orgon a accueilli chez lui un faux dévot, un hypocrite de première, Tartuffe. Même sa mère, Madame Pernelle, se laisse duper. Orgon, naïf, lui voue un véritable culte, à tel point qu'il en fait son directeur de conscience et qu'il en oublie sa propre famille. Il veut lui donner sa fille en mariage (pendant que l'autre tente de séduire sa femme, Elmire). Mais Tartuffe exerce un pouvoir tyrannique. Il ira beaucoup trop loin, au point de vouloir exclure Orgon de sa propre maison... Et, comme souvent chez Molière, Tartuffe se retrouvera pris à son propre piège.
Qui n'a pas connu un personnage de cette trempe de nos jours ? Les hypocrites et les faux dévots sont toujours d'actualité... malheureusement !
Lien : http://www.lydiabonnaventure..
Allez, revenons donc à ce brave Jean-Baptiste Poquelin. Ses pièces sont d'un modernisme sans nom et ce n'est pas pour rien qu'elles sont encore jouées aujourd'hui. Que raconte Le Tartuffe ? Orgon a accueilli chez lui un faux dévot, un hypocrite de première, Tartuffe. Même sa mère, Madame Pernelle, se laisse duper. Orgon, naïf, lui voue un véritable culte, à tel point qu'il en fait son directeur de conscience et qu'il en oublie sa propre famille. Il veut lui donner sa fille en mariage (pendant que l'autre tente de séduire sa femme, Elmire). Mais Tartuffe exerce un pouvoir tyrannique. Il ira beaucoup trop loin, au point de vouloir exclure Orgon de sa propre maison... Et, comme souvent chez Molière, Tartuffe se retrouvera pris à son propre piège.
Qui n'a pas connu un personnage de cette trempe de nos jours ? Les hypocrites et les faux dévots sont toujours d'actualité... malheureusement !
Lien : http://www.lydiabonnaventure..
Dom Juan est un terrible séducteur, à l'assaut de nouvelles conquêtes amoureuses au prix du désespoir de certaines de ses victimes...
Sganarelle est son valet, un peu bouffon, mais aussi fidèle à son maître, qu'il n'aime tout de même pas.
Ces deux personnages font tout le génie de Dom Juan, pièce de Molière, qui fût censurée à l'époque par sa moquerie des "faux dévots".
Et pourtant, Molière mêle dans son récit une touche d'humour, comme dans toutes ses comédies, mais surtout une critique de la société de son époque (en particulier de la médecine et de la religion), qui rende cette pièce de théâtre profonde et d'une sincérité remarquable.
J'aime beaucoup Molière, le grand Jean-Baptiste Poquelin, dont je voulais découvrir Dom Juan depuis un certain temps ; le hasard est bien tombé puisque j'ai enfin pu, avec grand plaisir, découvrir cette oeuvre !
Ainsi, je ne peux que recommander Dom Juan à tous ceux qui veulent le découvrir, en ajoutant simplement qu'il est différent des autres oeuvres de Molière, car moins comique mais plus symbolique.
Un grand plaisir !
Sganarelle est son valet, un peu bouffon, mais aussi fidèle à son maître, qu'il n'aime tout de même pas.
Ces deux personnages font tout le génie de Dom Juan, pièce de Molière, qui fût censurée à l'époque par sa moquerie des "faux dévots".
Et pourtant, Molière mêle dans son récit une touche d'humour, comme dans toutes ses comédies, mais surtout une critique de la société de son époque (en particulier de la médecine et de la religion), qui rende cette pièce de théâtre profonde et d'une sincérité remarquable.
J'aime beaucoup Molière, le grand Jean-Baptiste Poquelin, dont je voulais découvrir Dom Juan depuis un certain temps ; le hasard est bien tombé puisque j'ai enfin pu, avec grand plaisir, découvrir cette oeuvre !
Ainsi, je ne peux que recommander Dom Juan à tous ceux qui veulent le découvrir, en ajoutant simplement qu'il est différent des autres oeuvres de Molière, car moins comique mais plus symbolique.
Un grand plaisir !
Qui n'a pas en tête la fameuse réplique de Magdelon : "Vite, voiturez-nous ici les commodités de la conversation" ? Cathos et Magdelon sont respectivement la nièce et la fille de Gorgibus. Celui-ci veut les marier le plus vite possible avec deux hommes de sa connaissance, Du Croisy et La Grange. Mais les filles les repoussent sous prétexte qu'ils ne sont pas assez bien pour elles. Elles se sont en effet mis en tête une fausse naissance et ont adapté leur vocabulaire en fonction de la hauteur de leur rang imaginaire. Avec l'aide de Gorgibus, les deux amants vont imaginer un stratagème afin de punir les deux écervelées : faire passer leurs valets pour un marquis et un vicomte...
Les Précieuses ridicules est une comédie mettant en relief une fin peu heureuse pour les deux pédantes. On sent, de ce fait, la critique virulente de ces précieuses que notre auteur n'appréciait guère. Cependant, il prit le soin de se justifier en disant ne dénigrer que celles qui étaient ridicules, d'où le titre de la pièce. Il voulait éviter de s'attirer les foudres d'une société qui non seulement les acceptait mais les mettait sur un piédestal. Le "gratin" intellectuel les côtoyait. Pour cela, il écrira dans sa préface : "J’aurois voulu faire voir qu’elle se tient partout dans les bornes de la satire honnête et permise ; que les plus excellentes choses sont sujettes à être copiées par de mauvais singes qui méritent d’être bernés ; que ces vicieuses imitations de ce qu’il y a de plus parfait ont été de tout temps la matière de la comédie ; et que, par la même raison les véritables savants et les vrais braves ne se sont point encore avisés de s’offenser du Docteur de la comédie, et du Capitan ; non plus que les juges, les princes et les rois, de voir Trivelin, ou quelque autre, sur le théâtre, faire ridiculement le juge, le prince ou le roi : aussi les véritables précieuses auroient tort de se piquer, lorsqu’on joue les ridicules qui les imitent mal."
A lire et à relire !
Lien : http://www.lydiabonnaventure..
Les Précieuses ridicules est une comédie mettant en relief une fin peu heureuse pour les deux pédantes. On sent, de ce fait, la critique virulente de ces précieuses que notre auteur n'appréciait guère. Cependant, il prit le soin de se justifier en disant ne dénigrer que celles qui étaient ridicules, d'où le titre de la pièce. Il voulait éviter de s'attirer les foudres d'une société qui non seulement les acceptait mais les mettait sur un piédestal. Le "gratin" intellectuel les côtoyait. Pour cela, il écrira dans sa préface : "J’aurois voulu faire voir qu’elle se tient partout dans les bornes de la satire honnête et permise ; que les plus excellentes choses sont sujettes à être copiées par de mauvais singes qui méritent d’être bernés ; que ces vicieuses imitations de ce qu’il y a de plus parfait ont été de tout temps la matière de la comédie ; et que, par la même raison les véritables savants et les vrais braves ne se sont point encore avisés de s’offenser du Docteur de la comédie, et du Capitan ; non plus que les juges, les princes et les rois, de voir Trivelin, ou quelque autre, sur le théâtre, faire ridiculement le juge, le prince ou le roi : aussi les véritables précieuses auroient tort de se piquer, lorsqu’on joue les ridicules qui les imitent mal."
A lire et à relire !
Lien : http://www.lydiabonnaventure..
Arnolphe, dit M. de la Souche, désespère de pouvoir trouver un jour son bonheur sur le plan conjugal. Il considère les femmes comme des êtres frivoles, dénuées de bon sens. Il a peur d'être cocufié. Il pense ainsi que la meilleure solution serait d'en épouser une ne connaissant rien au monde et à ses perversions. L'ingénue est toute trouvée puisque sa pupille, Agnès, a été élevée dans un couvent. Mais bien évidemment, rien ne se passe comme prévu. Agnès n'éprouve absolument rien pour lui et s'est entichée d'Horace, le fils d'un ami de son tuteur, Oronte.
Si cette pièce a obtenu un franc succès, on peut également imaginer à quel point elle a dû choquer. Car sous des dehors naïfs, la petite Agnès cache un autre caractère. Une scène (acte II, sc. 5) montre à quel point elle peut faire tourner Arnolphe en bourrique. Lorsqu'il lui demande quelles sont les nouvelles, elle lui dit que le petit chat est mort. Bon, certes, c'est bien malheureux pour la pauvre bête, mais elle se garde bien de lui dire qu'elle a vu Horace. Arnolphe est obligé de lui tirer les vers du nez car elle ne répond que par de petites phrases. Peur d'en dire trop ? Et puis, il y a ce passage, fabuleux, lorsqu'elle lui annonce, toujours aussi naïvement (mon œil ! ) qu'elle a vu Horace et qu'elle ne comprenait pas lorsque la voisine disait qu'elle l'avait blessée. Elle voulut aussitôt réparer sa faute :
Agnès.
Voilà comme il me vit, et reçut guérison.
Vous-même, à votre avis, n’ai-je pas eu raison ?
Et pouvois-je, après tout, avoir la conscience
De le laisser mourir faute d’une assistance,
Moi qui compatis tant aux gens qu’on fait souffrir
Et ne puis, sans pleurer, voir un poulet mourir ?
[...]
Arnolphe.
Non. Mais de cette vue apprenez-moi les suites,
Et comme le jeune homme a passé ses visites.
Agnès.
Hélas ! si vous saviez comme il était ravi,
Comme il perdit son mal sitôt que je le vi,
Le présent qu’il m’a fait d’une belle cassette,
Et l’argent qu’en ont eu notre Alain et Georgette,
Vous l’aimeriez sans doute et diriez comme nous...
Arnolphe.
Oui. Mais que faisait-il étant seul avec vous ?
Agnès.
Il jurait qu’il m’aimait d’une amour sans seconde,
Et me disait des mots les plus gentils du monde,
Des choses que jamais rien ne peut égaler,
Et dont, toutes les fois que je l’entends parler,
La douceur me chatouille et là dedans remue
Certain je ne sais quoi dont je suis toute émue.
Arnolphe, à part.
Ô fâcheux examen d’un mystère fatal,
Où l’examinateur souffre seul tout le mal !
(À Agnès.)
Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses,
Ne vous faisait-il point aussi quelques caresses ?
Agnès.
Oh tant ! Il me prenait et les mains et les bras,
Et de me les baiser il n’était jamais las.
Arnolphe.
Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose ?
(La voyant interdite.)
Ouf !
Agnès.
Hé ! il m’a...
Arnolphe.
Quoi ?
Agnès.
Pris...
Arnolphe.
Euh !
Agnès.
Le...
Arnolphe.
Plaît-il ?
Agnès.
Je n’ose,
Et vous vous fâcherez peut-être contre moi.
Arnolphe.
Non.
Agnès.
Si fait.
Arnolphe.
Mon Dieu, non !
Agnès.
Jurez donc votre foi.
Arnolphe.
Ma foi, soit.
Agnès.
Il m’a pris... Vous serez en colère.
Arnolphe.
Non.
Agnès.
Si.
Arnolphe.
Non, non, non, non. Diantre, que de mystère !
Qu’est-ce qu’il vous a pris ?
Remarquez à quel point elle le fait attendre, à quel point ses paroles sont ambiguës. Tous les sous-entendus peuvent se percevoir, ce qui induit le barbon en erreur. Et après, on me fera croire que cette Agnès est une ingénue ? Je pense que Molière a joué justement avec cela. Et c'est bien d'ailleurs ce qui lui vaudra le courroux de ses détracteurs (vous me direz, quand on veut trouver quelque chose à redire, on trouve toujours) qui estimaient que les bienséances n'étaient pas respectées, qu'il y avait trop d'obscénités. Bref, pour revenir à notre Agnès, elle finit quand même enfin par lâcher :
Agnès.
Il m’a pris le ruban que vous m’aviez donné.
À vous dire le vrai, je n’ai pu m’en défendre.
Arnolphe, reprenant haleine.
Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre
S’il ne vous a rien fait que vous baiser les bras.
Agnès.
Comment ? est-ce qu’on fait d’autres choses ?
"Est-ce qu'on fait d'autres choses ," ose t-elle répondre !!! Allez, je sais bien qu'elle a été élevée dans un couvent mais quand même ! Ah, il est fort ce Molière, très fort ! Et sous une apparente simplicité se cache là quelque chose de mordant, de féroce. Qu'on vienne après me dire que Molière, "c'est trop gnan gnan !"
Lien : http://www.lydiabonnaventure..
Si cette pièce a obtenu un franc succès, on peut également imaginer à quel point elle a dû choquer. Car sous des dehors naïfs, la petite Agnès cache un autre caractère. Une scène (acte II, sc. 5) montre à quel point elle peut faire tourner Arnolphe en bourrique. Lorsqu'il lui demande quelles sont les nouvelles, elle lui dit que le petit chat est mort. Bon, certes, c'est bien malheureux pour la pauvre bête, mais elle se garde bien de lui dire qu'elle a vu Horace. Arnolphe est obligé de lui tirer les vers du nez car elle ne répond que par de petites phrases. Peur d'en dire trop ? Et puis, il y a ce passage, fabuleux, lorsqu'elle lui annonce, toujours aussi naïvement (mon œil ! ) qu'elle a vu Horace et qu'elle ne comprenait pas lorsque la voisine disait qu'elle l'avait blessée. Elle voulut aussitôt réparer sa faute :
Agnès.
Voilà comme il me vit, et reçut guérison.
Vous-même, à votre avis, n’ai-je pas eu raison ?
Et pouvois-je, après tout, avoir la conscience
De le laisser mourir faute d’une assistance,
Moi qui compatis tant aux gens qu’on fait souffrir
Et ne puis, sans pleurer, voir un poulet mourir ?
[...]
Arnolphe.
Non. Mais de cette vue apprenez-moi les suites,
Et comme le jeune homme a passé ses visites.
Agnès.
Hélas ! si vous saviez comme il était ravi,
Comme il perdit son mal sitôt que je le vi,
Le présent qu’il m’a fait d’une belle cassette,
Et l’argent qu’en ont eu notre Alain et Georgette,
Vous l’aimeriez sans doute et diriez comme nous...
Arnolphe.
Oui. Mais que faisait-il étant seul avec vous ?
Agnès.
Il jurait qu’il m’aimait d’une amour sans seconde,
Et me disait des mots les plus gentils du monde,
Des choses que jamais rien ne peut égaler,
Et dont, toutes les fois que je l’entends parler,
La douceur me chatouille et là dedans remue
Certain je ne sais quoi dont je suis toute émue.
Arnolphe, à part.
Ô fâcheux examen d’un mystère fatal,
Où l’examinateur souffre seul tout le mal !
(À Agnès.)
Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses,
Ne vous faisait-il point aussi quelques caresses ?
Agnès.
Oh tant ! Il me prenait et les mains et les bras,
Et de me les baiser il n’était jamais las.
Arnolphe.
Ne vous a-t-il point pris, Agnès, quelque autre chose ?
(La voyant interdite.)
Ouf !
Agnès.
Hé ! il m’a...
Arnolphe.
Quoi ?
Agnès.
Pris...
Arnolphe.
Euh !
Agnès.
Le...
Arnolphe.
Plaît-il ?
Agnès.
Je n’ose,
Et vous vous fâcherez peut-être contre moi.
Arnolphe.
Non.
Agnès.
Si fait.
Arnolphe.
Mon Dieu, non !
Agnès.
Jurez donc votre foi.
Arnolphe.
Ma foi, soit.
Agnès.
Il m’a pris... Vous serez en colère.
Arnolphe.
Non.
Agnès.
Si.
Arnolphe.
Non, non, non, non. Diantre, que de mystère !
Qu’est-ce qu’il vous a pris ?
Remarquez à quel point elle le fait attendre, à quel point ses paroles sont ambiguës. Tous les sous-entendus peuvent se percevoir, ce qui induit le barbon en erreur. Et après, on me fera croire que cette Agnès est une ingénue ? Je pense que Molière a joué justement avec cela. Et c'est bien d'ailleurs ce qui lui vaudra le courroux de ses détracteurs (vous me direz, quand on veut trouver quelque chose à redire, on trouve toujours) qui estimaient que les bienséances n'étaient pas respectées, qu'il y avait trop d'obscénités. Bref, pour revenir à notre Agnès, elle finit quand même enfin par lâcher :
Agnès.
Il m’a pris le ruban que vous m’aviez donné.
À vous dire le vrai, je n’ai pu m’en défendre.
Arnolphe, reprenant haleine.
Passe pour le ruban. Mais je voulais apprendre
S’il ne vous a rien fait que vous baiser les bras.
Agnès.
Comment ? est-ce qu’on fait d’autres choses ?
"Est-ce qu'on fait d'autres choses ," ose t-elle répondre !!! Allez, je sais bien qu'elle a été élevée dans un couvent mais quand même ! Ah, il est fort ce Molière, très fort ! Et sous une apparente simplicité se cache là quelque chose de mordant, de féroce. Qu'on vienne après me dire que Molière, "c'est trop gnan gnan !"
Lien : http://www.lydiabonnaventure..
Ô classique des classiques ! Lu à l'école, vu à la télévision, savouré au fil des années, L'Avare nous accompagne tout au long notre apprentissage des livres et de leur imprégnation dans notre culture française classique.
Peut-être un peu moins bien apprécié que Les Fourberies de Scapin, Le Bourgeois Gentilhomme ou bien Le Malade Imaginaire, L'Avare n'en est pas moins l'une des comédies de Molière les plus réussies. Créée en 1668, elle met en scène le bien connu Harpagon, le "rapace" en grec ancien, LE personnage omniprésent tout au long de la pièce, l'Avare par excellence. Par ses longues tirades marquantes au possible, son "sens de la famille" et son mépris sans foi ni loi des désirs d'autrui, Harpagon est le prétexte parfait pour aborder des thèmes toujours d'actualité comme l'avarice, la tyrannie domestique, l'égoïsme et le sexisme, le tout avec un angle bien entendu toujours comique qui sied au talent de Molière.
Les habitués de Monsieur de Poquelin retrouveront avec soulagement le fameux "coup de théâtre" qui résoud les problèmes mis en place dès les premières scènes de la pièce. L'ensemble est beaucoup trop culte et matière à réinterprétation pour ne pas le savourer à chaque lecture. Un classique !
Peut-être un peu moins bien apprécié que Les Fourberies de Scapin, Le Bourgeois Gentilhomme ou bien Le Malade Imaginaire, L'Avare n'en est pas moins l'une des comédies de Molière les plus réussies. Créée en 1668, elle met en scène le bien connu Harpagon, le "rapace" en grec ancien, LE personnage omniprésent tout au long de la pièce, l'Avare par excellence. Par ses longues tirades marquantes au possible, son "sens de la famille" et son mépris sans foi ni loi des désirs d'autrui, Harpagon est le prétexte parfait pour aborder des thèmes toujours d'actualité comme l'avarice, la tyrannie domestique, l'égoïsme et le sexisme, le tout avec un angle bien entendu toujours comique qui sied au talent de Molière.
Les habitués de Monsieur de Poquelin retrouveront avec soulagement le fameux "coup de théâtre" qui résoud les problèmes mis en place dès les premières scènes de la pièce. L'ensemble est beaucoup trop culte et matière à réinterprétation pour ne pas le savourer à chaque lecture. Un classique !
J'avais déjà lu cette pièce il y a fort longtemps et quel plaisir j'ai eu à la redécouvrir ici, tombant par hasard sur ce dernier en faisant un peu de rangement dans "Mes" bibliothèques. Ici, vous l'aurez compris, Molière se moque effrontément de la médecine, et, parfois, à raison.
Argan est un homme honorable, gentilhomme, père de deux jeune filles, ayant deux épouses et qui aurait donc tout pour être heureux. Mais non, puisque ce dernier est ce que l'on pourrait qualifier d’hypocondriaque. En effet, ce dernier se complaît dans le fait de se faire plaindre et s'en remet éternellement aux médecins.
Sa fille aînée, Angélique, elle ne rêve que d'une chose : épouser l'homme qu'elle aime et non pas le prétendant que son père a pris soin de choisir à sa place, et qui n'est autre que le neveu de son médecin, et un futur médecin lui-même. Voilà la bonne affaire s'était dit très égoïstement Argan que d'avoir un médecin pour gendre...
Mais heureusement qu'il reste des âmes pures dans cette famille pour éviter ce qui pourrait s'avérer être un désastre et ne faire, cette fois encore, plus de mal que de bien, mais non pas du mal physique mais du mal dans les âmes et dans les cœurs !
Une comédie qui reste toujours d'actualité car malheureusement, certaines personnes (non pas les médecins mais des gens mal intentionnés) n'hésitent pas à vous faire croire n'importe quoi en échange de quelque rétribution bien entendu. Comme le disent si bien les personnages de la pièce de Molière, certaines fois, ce ne sont pas les remèdes qui soulagent mais le malade lui-même s'il veut bien s'en donner la peine. Attention, je ne critique absolument pas la médecine (bien au contraire), je dis simplement qu'il faut faire attention. Une comédie absolument superbe, à lire et à relire...mais surtout à voir je pense !
Argan est un homme honorable, gentilhomme, père de deux jeune filles, ayant deux épouses et qui aurait donc tout pour être heureux. Mais non, puisque ce dernier est ce que l'on pourrait qualifier d’hypocondriaque. En effet, ce dernier se complaît dans le fait de se faire plaindre et s'en remet éternellement aux médecins.
Sa fille aînée, Angélique, elle ne rêve que d'une chose : épouser l'homme qu'elle aime et non pas le prétendant que son père a pris soin de choisir à sa place, et qui n'est autre que le neveu de son médecin, et un futur médecin lui-même. Voilà la bonne affaire s'était dit très égoïstement Argan que d'avoir un médecin pour gendre...
Mais heureusement qu'il reste des âmes pures dans cette famille pour éviter ce qui pourrait s'avérer être un désastre et ne faire, cette fois encore, plus de mal que de bien, mais non pas du mal physique mais du mal dans les âmes et dans les cœurs !
Une comédie qui reste toujours d'actualité car malheureusement, certaines personnes (non pas les médecins mais des gens mal intentionnés) n'hésitent pas à vous faire croire n'importe quoi en échange de quelque rétribution bien entendu. Comme le disent si bien les personnages de la pièce de Molière, certaines fois, ce ne sont pas les remèdes qui soulagent mais le malade lui-même s'il veut bien s'en donner la peine. Attention, je ne critique absolument pas la médecine (bien au contraire), je dis simplement qu'il faut faire attention. Une comédie absolument superbe, à lire et à relire...mais surtout à voir je pense !
Peu de scènes de théâtre ont eu autant de succès auprès de moi que la leçon de prononciation que Mr Jourdain reçoit de son maître de philosophie !
(Acte II, Sc. 4)
Le pragmatisme de Mme Jourdain et ses "coups bas" sont excellents et tellement représentatifs des relations conjugales d'un temps où, dans les classes aisées de la société, on ne se mariait que par intérêt et on s’accommodait tant bien que mal du conjoint qu'on vous avait choisi.
Pour goûter tout le piquant d'une telle comédie qui se veut la parodie sans fard de l'arrivisme bourgeois, il faut se plonger dans le contexte social et historique de ce 17ème siècle où l'ascension de la bourgeoisie et de la noblesse dite "de robe" (en opposition à l'aristocratie, noblesse dite "d'épée") prend tout son essor, posant bien avant les écrits des Lumières les bases solides sur lesquelles s'appuiera 120 ans plus tard la Révolution Française.
Il faut imaginer ce que devaient être les premières représentations de cette pièce avec Molière dans le rôle principal (lui-même étant né de cette riche bourgeoisie dont il connaît les utopies et s'étant hissé par son talent et son génie jusqu'à la Cour du Roi-Soleil), sur une musique de Lully, ce devait vraiment être quelque chose !
(Acte II, Sc. 4)
Le pragmatisme de Mme Jourdain et ses "coups bas" sont excellents et tellement représentatifs des relations conjugales d'un temps où, dans les classes aisées de la société, on ne se mariait que par intérêt et on s’accommodait tant bien que mal du conjoint qu'on vous avait choisi.
Pour goûter tout le piquant d'une telle comédie qui se veut la parodie sans fard de l'arrivisme bourgeois, il faut se plonger dans le contexte social et historique de ce 17ème siècle où l'ascension de la bourgeoisie et de la noblesse dite "de robe" (en opposition à l'aristocratie, noblesse dite "d'épée") prend tout son essor, posant bien avant les écrits des Lumières les bases solides sur lesquelles s'appuiera 120 ans plus tard la Révolution Française.
Il faut imaginer ce que devaient être les premières représentations de cette pièce avec Molière dans le rôle principal (lui-même étant né de cette riche bourgeoisie dont il connaît les utopies et s'étant hissé par son talent et son génie jusqu'à la Cour du Roi-Soleil), sur une musique de Lully, ce devait vraiment être quelque chose !
La pièce commence par une scène de ménage entre Sganarelle et Martine. Celle-ci reçoit de coups de bâton.
Sganarelle parti, elle décide de se venger à sa façon et cela ne tardera pas.
Arrivent Lucas et Valère, les valets de Géronte qui rencontrent Martine et lui confient qu'ils cherchent désespérément un médecin pour guérir la fille de leur maître. Celle-ci est devenue muette et de nombreux médecins ne sont pas parvenus à la guérir.
Martine leur renseigne le lieu où se tient Sganarelle et leur fait croire qu'il est grand médecin mais ne veut pas exercer.
N'hésitez pas à le frapper pour le faire avouer et vous suivre dit-elle.
Et c'est ainsi que notre Sganarelle, habillé en médecin par Valère et Lucas, va se rendre au chevet de Léandre .
Il usera d'un charabia soi-disant médical et découvrira quand même la source de la maladie de la pauvre fille grâce à son amoureux Léandre refusé par le père.
Touts est bien qui finit bien : le couple Sganarelle et Martine se réconcilient.
Les amoureux peuvent s'aimer.
Molière met l'accent sur le côté charlatan des médecins de l'époque.
La scène la plus révélatrice de ce que pense Molière à ce sujet se passe entre Léandre qui entre dans la maison de Géronte déguisé en apothicaire et Sganarelle qui lui avoue tout.
Un vrai régal que cette pièce revue cet après-midi sur you tube avec le livre en accompagnement. Tous les souvenirs liés à la pièce revenaient.
Un miracle que ma recette du mardi-gras n'ait pas brûlé.
Sganarelle parti, elle décide de se venger à sa façon et cela ne tardera pas.
Arrivent Lucas et Valère, les valets de Géronte qui rencontrent Martine et lui confient qu'ils cherchent désespérément un médecin pour guérir la fille de leur maître. Celle-ci est devenue muette et de nombreux médecins ne sont pas parvenus à la guérir.
Martine leur renseigne le lieu où se tient Sganarelle et leur fait croire qu'il est grand médecin mais ne veut pas exercer.
N'hésitez pas à le frapper pour le faire avouer et vous suivre dit-elle.
Et c'est ainsi que notre Sganarelle, habillé en médecin par Valère et Lucas, va se rendre au chevet de Léandre .
Il usera d'un charabia soi-disant médical et découvrira quand même la source de la maladie de la pauvre fille grâce à son amoureux Léandre refusé par le père.
Touts est bien qui finit bien : le couple Sganarelle et Martine se réconcilient.
Les amoureux peuvent s'aimer.
Molière met l'accent sur le côté charlatan des médecins de l'époque.
La scène la plus révélatrice de ce que pense Molière à ce sujet se passe entre Léandre qui entre dans la maison de Géronte déguisé en apothicaire et Sganarelle qui lui avoue tout.
Un vrai régal que cette pièce revue cet après-midi sur you tube avec le livre en accompagnement. Tous les souvenirs liés à la pièce revenaient.
Un miracle que ma recette du mardi-gras n'ait pas brûlé.
Je n’ai pas ouvert un livre de Molière depuis le collège, ce qui fait presque vingt ans. Oui, je sais c’est long, mais bon, je n’ai jamais trouvé que mes chers professeurs savaient nous donner le gout de la lecture, mais ceci est un autre sujet.
J’en reviens donc au Misanthrope, que j’ai lu pour pouvoir lire un autre livre. Je voulais lire Un homme trop facile, de Eric-Emmanuel Schmitt dans lequel un acteur de théâtre va rencontrer le véritable Alceste, le personnage.
Impossible de lire ce livre sans avoir lu le misanthrope au préalable. Et me voilà donc plongé dans une pièce de Molière. Bon, je dois avouer que j’y allais un peu à reculons, mes souvenirs du collège ne m’avaient pas plus captivé.
Et là, surprise ! J’ai adoré ! Cette pièce n’a pas pris une ride et dénonce la société telle qu’elle l’était à l’époque, et surtout telle qu’elle l’est encore de nos jours. Ne pas dire ce que l’on pense des gens, paraitre aimable en toute circonstance, les sourires, les faux-semblants, l’hypocrisie. Toute l’absurdité de la société est décrite avec justesse dans cette pièce.
Célimène est le personnage que tout le monde se dispute mais qui est la personne la plus détestable de la pièce. J’ai bien aimé sa façon d’être, un vraie peste qui se moque de tout le monde et profite de la vie tout en sachant détourner les codes de la société.
Alceste est à l’opposé de Célimène. Lui, est honnête, il dit ce qu’il pense en toute circonstance et ne se rends pas compte des problèmes qu’il peut s’attirer.
La relation entre Alceste et Célimène est forcément très complexe car même si on aimerait voir les deux personnages terminer ensemble, les choses sont bien plus compliqués et que chacun des deux protagonistes campe sur ses positions.
Criante de vérité, pas vraiment très drôle et un brin moralisatrice, et surtout toujours d’actualité de nos jours. J’ai adoré de bout en bout, si bien que je pense me lancer prochainement dans d’autres pièces de Molière.
J’en reviens donc au Misanthrope, que j’ai lu pour pouvoir lire un autre livre. Je voulais lire Un homme trop facile, de Eric-Emmanuel Schmitt dans lequel un acteur de théâtre va rencontrer le véritable Alceste, le personnage.
Impossible de lire ce livre sans avoir lu le misanthrope au préalable. Et me voilà donc plongé dans une pièce de Molière. Bon, je dois avouer que j’y allais un peu à reculons, mes souvenirs du collège ne m’avaient pas plus captivé.
Et là, surprise ! J’ai adoré ! Cette pièce n’a pas pris une ride et dénonce la société telle qu’elle l’était à l’époque, et surtout telle qu’elle l’est encore de nos jours. Ne pas dire ce que l’on pense des gens, paraitre aimable en toute circonstance, les sourires, les faux-semblants, l’hypocrisie. Toute l’absurdité de la société est décrite avec justesse dans cette pièce.
Célimène est le personnage que tout le monde se dispute mais qui est la personne la plus détestable de la pièce. J’ai bien aimé sa façon d’être, un vraie peste qui se moque de tout le monde et profite de la vie tout en sachant détourner les codes de la société.
Alceste est à l’opposé de Célimène. Lui, est honnête, il dit ce qu’il pense en toute circonstance et ne se rends pas compte des problèmes qu’il peut s’attirer.
La relation entre Alceste et Célimène est forcément très complexe car même si on aimerait voir les deux personnages terminer ensemble, les choses sont bien plus compliqués et que chacun des deux protagonistes campe sur ses positions.
Criante de vérité, pas vraiment très drôle et un brin moralisatrice, et surtout toujours d’actualité de nos jours. J’ai adoré de bout en bout, si bien que je pense me lancer prochainement dans d’autres pièces de Molière.
Molière… Je ne suis pas du genre à avoir envie de le lire par plaisir (en tous cas, pas pour le moment, et ce depuis 24 ans). Mais il était au programme de mon cours de Français. Donc je l'ai quand même lu, dans la foulée des Fourberies de Scapin, et c'était agréable. J'ai souri plusieurs fois de bon coeur. Bon coeur ? Attendez, j'ai comme des pincements dans la poitrine… Et à bien y réfléchir, j'ai un peu de mal à respirer. Mon dieu, ça y est, j'ai attrapé le virus !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Molière
Lecteurs de Molière Voir plus
Quiz
Voir plus
Molière
Quel est le vrai nom de Molière ?
Jean Coquelin
Jean-Baptiste Poquelin
Baptiste Gravelin
Molière Troiquelin
10 questions
1109 lecteurs ont répondu
Thème :
MolièreCréer un quiz sur cet auteur1109 lecteurs ont répondu