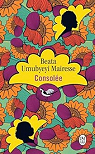Critiques filtrées sur 5 étoiles
"Le convoi" n'est pas un roman. Il s'agit bien d'un récit, celui de l'auteure qui relate différents aspects de son histoire au sein de l'Histoire du Rwanda.
Bien évidemment, elle relate son sauvetage, à 15 ans, et avec sa mère, par une ONG suisse, du génocide Tutsi au Rwanda en 1994. Il y a donc des faits concrets, des fuites, des caches, des rencontres, des portraits. On est avec Beata, on tremble, on voit la mort arriver, on se fige devant les cadavres. Cette partie très réaliste est nécessaire pour savoir de quoi on parle, mais je n'ai pas trouvé sa lecture difficile. Je pense que sa volonté de survivre a été tellement forte qu'elle ne s'est pas appesantie sur l'horreur de cette période pour ne pas être tentée de baisser les bras. de fait, pour moi, son récit est surtout une course en avant pour sortir du pays avec sa mère. Sa volonté a probablement été sa plus grande force. Pour cela, elle a toute mon admiration.
Mais ce récit est bien plus que cela. L'auteure nous explique aussi tout le cheminement qui l'a amenée à écrire son histoire : Doit-elle le faire? Pour elle ou pour tous les survivants? Les images retrouvées sont-elles les seules existantes? Doit-elle chercher les autres? Des survivants ont-ils la même démarche? Les photos témoignent-elles vraiment de la réalité?
J'ai trouvé toutes ces réflexions très intéressantes à lire. On sent bien toute l'émotion de l'auteure à expliquer son raisonnement. Au fur et à mesure de ses trouvailles notamment auprès de la BBC et de l'ONG Terre des Hommes qui l'a sauvée, elle ouvre des fenêtres vers d'autres survivants avec qui elle finit par former un vrai réseau. Les témoignages qu'elle organise auprès de lycées et de collèges la confortent dans son idée de transmettre son vécu. J'ai eu l'impression qu'elle engrangeait de la force pour se convaincre totalement qu'elle devait écrire son récit. C'était très beau à lire.
Deux aspects plus généralistes m'ont interpellée.
Généralement, quand on parle de "convoi", l'esprit comprend tout de suite "convoi de Juifs pendant la seconde guerre mondiale". Ce sont donc des convois de la mort. Or, dans le cas de Beata, il s'agit d'un convoi de la vie puisqu'il va sauver des dizaines d'enfants. L'auteure a souvent croisé des survivants de la Shoah lors de conférences ou de commémorations et cet aspect, d'apparence anecdotique, leur fait tous dire qu'il ne faut pas conclure d'une situation sur un mot. Il est nécessaire que chacun s'informe auprès de sources fiables pour connaitre la vraie Histoire.
Beata Umubyeyi Mairesse évoque aussi la problématique de l'image et la diffusion de celle-ci au monde. Beaucoup de photos ont été prises lors des trois convois qui seront organisés en juin - juillet 1994. L'auteure les a parfois retrouvées dans des magazines avec une légende totalement erronée. Cette mauvaise information l'a confortée dans son idée de transmettre la vérité qu'elle a elle-même vécue. Elle en a aussi conclu que ces images appartiennent aux survivants et qu'il serait légitime qu'ils les réclament, ce qu'elle a fait, inlassablement.
"Le convoi" est un récit fort, instructif, plein d'émotions et de rebondissements (la quête d'informations de Beata est un vrai jeu de piste!). Je lis rarement ce genre de témoignage mais je ne regrette absolument pas cette lecture que je conseille à toutes et tous.
Bien évidemment, elle relate son sauvetage, à 15 ans, et avec sa mère, par une ONG suisse, du génocide Tutsi au Rwanda en 1994. Il y a donc des faits concrets, des fuites, des caches, des rencontres, des portraits. On est avec Beata, on tremble, on voit la mort arriver, on se fige devant les cadavres. Cette partie très réaliste est nécessaire pour savoir de quoi on parle, mais je n'ai pas trouvé sa lecture difficile. Je pense que sa volonté de survivre a été tellement forte qu'elle ne s'est pas appesantie sur l'horreur de cette période pour ne pas être tentée de baisser les bras. de fait, pour moi, son récit est surtout une course en avant pour sortir du pays avec sa mère. Sa volonté a probablement été sa plus grande force. Pour cela, elle a toute mon admiration.
Mais ce récit est bien plus que cela. L'auteure nous explique aussi tout le cheminement qui l'a amenée à écrire son histoire : Doit-elle le faire? Pour elle ou pour tous les survivants? Les images retrouvées sont-elles les seules existantes? Doit-elle chercher les autres? Des survivants ont-ils la même démarche? Les photos témoignent-elles vraiment de la réalité?
J'ai trouvé toutes ces réflexions très intéressantes à lire. On sent bien toute l'émotion de l'auteure à expliquer son raisonnement. Au fur et à mesure de ses trouvailles notamment auprès de la BBC et de l'ONG Terre des Hommes qui l'a sauvée, elle ouvre des fenêtres vers d'autres survivants avec qui elle finit par former un vrai réseau. Les témoignages qu'elle organise auprès de lycées et de collèges la confortent dans son idée de transmettre son vécu. J'ai eu l'impression qu'elle engrangeait de la force pour se convaincre totalement qu'elle devait écrire son récit. C'était très beau à lire.
Deux aspects plus généralistes m'ont interpellée.
Généralement, quand on parle de "convoi", l'esprit comprend tout de suite "convoi de Juifs pendant la seconde guerre mondiale". Ce sont donc des convois de la mort. Or, dans le cas de Beata, il s'agit d'un convoi de la vie puisqu'il va sauver des dizaines d'enfants. L'auteure a souvent croisé des survivants de la Shoah lors de conférences ou de commémorations et cet aspect, d'apparence anecdotique, leur fait tous dire qu'il ne faut pas conclure d'une situation sur un mot. Il est nécessaire que chacun s'informe auprès de sources fiables pour connaitre la vraie Histoire.
Beata Umubyeyi Mairesse évoque aussi la problématique de l'image et la diffusion de celle-ci au monde. Beaucoup de photos ont été prises lors des trois convois qui seront organisés en juin - juillet 1994. L'auteure les a parfois retrouvées dans des magazines avec une légende totalement erronée. Cette mauvaise information l'a confortée dans son idée de transmettre la vérité qu'elle a elle-même vécue. Elle en a aussi conclu que ces images appartiennent aux survivants et qu'il serait légitime qu'ils les réclament, ce qu'elle a fait, inlassablement.
"Le convoi" est un récit fort, instructif, plein d'émotions et de rebondissements (la quête d'informations de Beata est un vrai jeu de piste!). Je lis rarement ce genre de témoignage mais je ne regrette absolument pas cette lecture que je conseille à toutes et tous.
A quoi reconnait-on qu'une auteure est vraiment devenue une de nos favorites ? Au fait qu'on ne réfléchisse même pas quand on a l'opportunité d'acheter son dernier livre. Pour beaucoup d'auteurs, j'attends avant d'envisager même de lire leur dernier livre, je n'ai pas de scrupule particulier à l'emprunter en bibliothèque plutôt qu'à l'acheter. Pour Beata, quand j'ai l'opportunité d'un achat, je vérifie d'abord si elle n'a pas de nouvelle parution... et ce fut le cas grâce à la carte cadeau de Noël de ma chère soeur, merci beaucoup !
Elle qui avait tracé son chemin d'auteure en évoquant la tragédie du génocide des Tutsis par le biais de la fiction, tout en subtilité puisqu'elle n'aborde jamais de front les massacres mais préfère évoquer le passé et le futur, Ejo en kynyarwanda, titre de son premier recueil de nouvelles... comment allait-elle se frotter au travail du récit autobiographique, genre qui est loin d'être mon préféré. Sans voyeurisme, il m'intéressait fortement d'en savoir plus sur son vécu personnel de ce drame.
Elle nous offre tout d'abord la genèse de ce projet, ce qui fut parfait pour moi car elle explique ainsi son choix premier de la fiction et me permet moi aussi de mieux comprendre ce qui m'avait séduit en tant que lecteur dans sa démarche, cette volonté de témoigner sans choquer, en offrant au lecteur l'émotion qui n'enferme pas mais libère. Son dessein rejoignant mon ressenti, je ne pouvais ainsi que me confirmer le lien littéraire construit avec elle. Elle explique également ce qui la mène finalement à témoigner de son histoire, pour elle, pour ses enfants, en communion avec les autres victimes, pour L Histoire. Elle analyse tous les écueils rencontrés par les victimes d'un tel drame, dénichant une formule si explicite en évoquant des histoires "pas tant indicibles qu'inentendables". Elle trace également un lien essentiel entre les génocides, sans jamais vouloir comparer, mais insistant sur la nécessité des échanges et du travail en commun, pour mieux comprendre ce qui peut amener des êtres humains à abolir leur jugement pour perpétrer l'horreur.
Quand elle rentre dans le coeur du récit, elle endosse toujours les habits de l'auteure qu'elle es devenue : humilité, générosité, bienveillance, douceur malgré l'horreur. Elle s'excuserait presque d'avoir vécu moins de drames personnels que la plupart des victimes, parvenant par exemple à survivre aux côtés de sa mère. Une mère dont on apprend peu de choses, comme elle l'explique plus tard en interview, parce que celle-ci ne souhaite pas qu'on parle trop d'elle. Toujours autant de pudeur, de respect du ressenti de l'autre. Elle prend également un bon quart du livre à rendre hommage aux humanitaires qui l'ont sauvée du génocide, à nous raconter sa rencontre avec eux plus de 20 ans après. Elle évoque bien sûr les responsabilités des gouvernements occidentaux, particulièrement belges et français dans la tragédie. Mais elle ne s'attarde pas en longueur sur les coupables, préférant expliquer ce qui a pu fonctionner et offrant ainsi un bon guide pour les associations oeuvrant sur le terrain, même si elle reconnait et déplore que rien de tout cela ne serait possible aujourd'hui, les procédures d'intervention des humanitaires s'étant considérablement alourdies.
Face à autant de bienveillance, on ne peut que comprendre la dernière partie, qui s'interroge sur les photos prises de ce drame, qui ont contribué à en fausser l'image, transformant les coupables hutus en victimes et permettant ainsi de justifier la protection de certains des coupables directs des tueries. Et on ne peut que s'offusquer avec elle des difficultés éprouvées par les victimes pour récupérer certaines de ces photos où elles figurent pourtant elle-mêmes, en total déni d'un droit à l'image, et alors même qu'elle nous détaille bien ici à quel point ces souvenirs du drame gravés sur la pellicule peuvent être des étapes importantes pour la reconstruction. Là encore, elle montre tant d'humilité, déplorant que son statut de privilégiée (Française, ayant fait des études supérieures, auteure) lui permette un accès facilité (et pourtant bien semé d'embûches) aux archives alors que d'autres victimes en sont elles privées. Totalement dans la ligne qu'elle s'est toujours fixée, de bout en bout de son récit, tout simplement sans doute parce qu'elle ne peut pas agir autrement qu'en personne humaine et respectueuse.
Pour finir, petite anecdote en passant. Dans le livre, elle cite trois auteurs de fiction, soit pour évoquer une lecture qui l'a guidée dans sa réflexion, soit à l'occasion d'une rencontre réelle, soit pour une citation qui lui permet d'appuyer son propos. Ces trois auteurs sont Imre Kertesz... dont j'ai lu le livre qu'elle évoque en septembre dernier ; Mohamed Mbougar Sarr... dont j'ai adoré le Goncourt lu en mars dernier... et Abdulrazak Gurnah, dernier prix Nobel africain que j'ai découvert en août dernier... quand je vous disais que la littérature me lie à cette auteure et que je ne pourrais donc que continuer à la suivre, une pénitence que je respecterais avec beaucoup d'enthousiasme.
Elle qui avait tracé son chemin d'auteure en évoquant la tragédie du génocide des Tutsis par le biais de la fiction, tout en subtilité puisqu'elle n'aborde jamais de front les massacres mais préfère évoquer le passé et le futur, Ejo en kynyarwanda, titre de son premier recueil de nouvelles... comment allait-elle se frotter au travail du récit autobiographique, genre qui est loin d'être mon préféré. Sans voyeurisme, il m'intéressait fortement d'en savoir plus sur son vécu personnel de ce drame.
Elle nous offre tout d'abord la genèse de ce projet, ce qui fut parfait pour moi car elle explique ainsi son choix premier de la fiction et me permet moi aussi de mieux comprendre ce qui m'avait séduit en tant que lecteur dans sa démarche, cette volonté de témoigner sans choquer, en offrant au lecteur l'émotion qui n'enferme pas mais libère. Son dessein rejoignant mon ressenti, je ne pouvais ainsi que me confirmer le lien littéraire construit avec elle. Elle explique également ce qui la mène finalement à témoigner de son histoire, pour elle, pour ses enfants, en communion avec les autres victimes, pour L Histoire. Elle analyse tous les écueils rencontrés par les victimes d'un tel drame, dénichant une formule si explicite en évoquant des histoires "pas tant indicibles qu'inentendables". Elle trace également un lien essentiel entre les génocides, sans jamais vouloir comparer, mais insistant sur la nécessité des échanges et du travail en commun, pour mieux comprendre ce qui peut amener des êtres humains à abolir leur jugement pour perpétrer l'horreur.
Quand elle rentre dans le coeur du récit, elle endosse toujours les habits de l'auteure qu'elle es devenue : humilité, générosité, bienveillance, douceur malgré l'horreur. Elle s'excuserait presque d'avoir vécu moins de drames personnels que la plupart des victimes, parvenant par exemple à survivre aux côtés de sa mère. Une mère dont on apprend peu de choses, comme elle l'explique plus tard en interview, parce que celle-ci ne souhaite pas qu'on parle trop d'elle. Toujours autant de pudeur, de respect du ressenti de l'autre. Elle prend également un bon quart du livre à rendre hommage aux humanitaires qui l'ont sauvée du génocide, à nous raconter sa rencontre avec eux plus de 20 ans après. Elle évoque bien sûr les responsabilités des gouvernements occidentaux, particulièrement belges et français dans la tragédie. Mais elle ne s'attarde pas en longueur sur les coupables, préférant expliquer ce qui a pu fonctionner et offrant ainsi un bon guide pour les associations oeuvrant sur le terrain, même si elle reconnait et déplore que rien de tout cela ne serait possible aujourd'hui, les procédures d'intervention des humanitaires s'étant considérablement alourdies.
Face à autant de bienveillance, on ne peut que comprendre la dernière partie, qui s'interroge sur les photos prises de ce drame, qui ont contribué à en fausser l'image, transformant les coupables hutus en victimes et permettant ainsi de justifier la protection de certains des coupables directs des tueries. Et on ne peut que s'offusquer avec elle des difficultés éprouvées par les victimes pour récupérer certaines de ces photos où elles figurent pourtant elle-mêmes, en total déni d'un droit à l'image, et alors même qu'elle nous détaille bien ici à quel point ces souvenirs du drame gravés sur la pellicule peuvent être des étapes importantes pour la reconstruction. Là encore, elle montre tant d'humilité, déplorant que son statut de privilégiée (Française, ayant fait des études supérieures, auteure) lui permette un accès facilité (et pourtant bien semé d'embûches) aux archives alors que d'autres victimes en sont elles privées. Totalement dans la ligne qu'elle s'est toujours fixée, de bout en bout de son récit, tout simplement sans doute parce qu'elle ne peut pas agir autrement qu'en personne humaine et respectueuse.
Pour finir, petite anecdote en passant. Dans le livre, elle cite trois auteurs de fiction, soit pour évoquer une lecture qui l'a guidée dans sa réflexion, soit à l'occasion d'une rencontre réelle, soit pour une citation qui lui permet d'appuyer son propos. Ces trois auteurs sont Imre Kertesz... dont j'ai lu le livre qu'elle évoque en septembre dernier ; Mohamed Mbougar Sarr... dont j'ai adoré le Goncourt lu en mars dernier... et Abdulrazak Gurnah, dernier prix Nobel africain que j'ai découvert en août dernier... quand je vous disais que la littérature me lie à cette auteure et que je ne pourrais donc que continuer à la suivre, une pénitence que je respecterais avec beaucoup d'enthousiasme.
En exergue du récit de l'auteure, une citation de Rithy Panh pour ancrer ses mots dans le sillage de ceux qui ont fait le travail de revenir au passé pour dire le vécu génocidaire.
Beata Umubyeyi Mairesse nous invite à partager l'itinéraire qui fut le sien pour parler de ce convoi qui l'a sortie de l'enfer le 18 juin 1994, de Boutare au Rwanda à la frontière avec le Burundi.
Trente petits kilomètres, jalonnés de barrières où des miliciens armés de machettes et autres outils du même type ,exercent par leur contrôle, un droit absolu de vie ou de mort sur ceux qui passent.
Bien au delà de cette route de tous les dangers, Beata Umubyeyi Mairesse rapporte dans son récit, ce qui a pu la conduire à mobiliser sa mémoire pour écrire et témoigner à la première personne, de ce qu'elle a vécu. Elle nous dit pourquoi ce travail de revenir au passé ne va pas de soi, et comment par un faisceau de circonstances elle a fini par y venir.
Dans la première partie de son récit, elle explique son cheminement pour découvrir presque à l'insu d'elle même de quel poids pèsent les traces du passé. Ce sont 4 photos qui vont jouer pour elle ce rôle de révélateur et tout son récit se structure autour de la recherche d'autres traces.
Ce travail qu'elle commence pour elle, elle le poursuit aussi pour les autres enfants du convoi. Dans cette quête éperdue, Beata Umubyeyi Mairesse retrouve les humanitaires qui ont organisé dès le 5 juin, le sauvetage de centaines d'enfants. Sa rencontre avec l'un d'eux déterminera sa décision d'écrire. le récit apporte un témoignage fort des conditions dans lesquelles ces humanitaires ont travaillé dans un contexte de totale duplicité internationale.
Tout au long du récit, elle témoigne sur ce cheminement qui a été le sien, elle montre que c'est bien la vie elle même, dans sa puissance et ses hasards qui conditionnent les regards en arrière. Retrouver une photographie c'est renouer avec le réel d'hier, c'est en même temps se l'approprier et le distancer.
Le génocide des Tutsis au Rwanda a trente ans en ce mois d'avril 2024, le témoignage de Beata Umubyeyi Mairesse, dit avec une grande force comment la mémoire des survivants peut trouver dans le passé ce qui les fait avancer et contribuer à ce que demain soit différent.
Beata Umubyeyi Mairesse nous invite à partager l'itinéraire qui fut le sien pour parler de ce convoi qui l'a sortie de l'enfer le 18 juin 1994, de Boutare au Rwanda à la frontière avec le Burundi.
Trente petits kilomètres, jalonnés de barrières où des miliciens armés de machettes et autres outils du même type ,exercent par leur contrôle, un droit absolu de vie ou de mort sur ceux qui passent.
Bien au delà de cette route de tous les dangers, Beata Umubyeyi Mairesse rapporte dans son récit, ce qui a pu la conduire à mobiliser sa mémoire pour écrire et témoigner à la première personne, de ce qu'elle a vécu. Elle nous dit pourquoi ce travail de revenir au passé ne va pas de soi, et comment par un faisceau de circonstances elle a fini par y venir.
Dans la première partie de son récit, elle explique son cheminement pour découvrir presque à l'insu d'elle même de quel poids pèsent les traces du passé. Ce sont 4 photos qui vont jouer pour elle ce rôle de révélateur et tout son récit se structure autour de la recherche d'autres traces.
Ce travail qu'elle commence pour elle, elle le poursuit aussi pour les autres enfants du convoi. Dans cette quête éperdue, Beata Umubyeyi Mairesse retrouve les humanitaires qui ont organisé dès le 5 juin, le sauvetage de centaines d'enfants. Sa rencontre avec l'un d'eux déterminera sa décision d'écrire. le récit apporte un témoignage fort des conditions dans lesquelles ces humanitaires ont travaillé dans un contexte de totale duplicité internationale.
Tout au long du récit, elle témoigne sur ce cheminement qui a été le sien, elle montre que c'est bien la vie elle même, dans sa puissance et ses hasards qui conditionnent les regards en arrière. Retrouver une photographie c'est renouer avec le réel d'hier, c'est en même temps se l'approprier et le distancer.
Le génocide des Tutsis au Rwanda a trente ans en ce mois d'avril 2024, le témoignage de Beata Umubyeyi Mairesse, dit avec une grande force comment la mémoire des survivants peut trouver dans le passé ce qui les fait avancer et contribuer à ce que demain soit différent.
J'ai eu besoin de temps pour comprendre pourquoi l auteure est obsédée par les photos et le film sur lesquels elle apparaît, et qui ont été prises lors de sa fuite du Rwanda. Je pensais même que voir ces photos ne pouvait que réveiller le traumatisme et que, par conséquent, ce n'était pas une bonne idée... Au delà des souvenirs terribles que restituent les images, c'est la reappropriation de son histoire qui guide la narratrice, que j ai trouvé très émouvante. Reconstituer cet épisode terrible de sa vie et nous éclairer enfin sur une histoire à propos de laquelle l information a été tronquée. Grâce à ce récit, je comprend un peu mieux l histoire du génocide du peuple Tutsi.
Après avoir écrit des romans et des recueils de nouvelles, Beata Umubyeyi Mairesse passe ici de la fiction au récit et nous donne un témoignage bouleversant de ce qu'elle a pu vivre, il y a trente ans, lors du génocide des Tutsis au Rwanda.
Dans « Le convoi », elle rassemble, non sans embûches, les images et les reportages qui ont été rapportés par les journalistes et les humanitaires occidentaux. Tout en exprimant sa reconnaissance d'avoir été sauvée lorsqu'elle avait quinze ans par un convoi de Terre des hommes, elle identifie les erreurs qui ont été commises lorsqu'il est venu le temps de raconter ce qui s'est passé.
Elle porte une réflexion profonde, juste et nuancée sur la mémoire collective, sur les gestes et les mots qui permettent aux récits de s'inscrire correctement dans L Histoire. Après trente ans, son livre est une invitation à l'empathie et à l'écoute, car suite à l'innommable, il est essentiel de donner enfin la place aux voix des survivants et des survivantes.
Dans « Le convoi », elle rassemble, non sans embûches, les images et les reportages qui ont été rapportés par les journalistes et les humanitaires occidentaux. Tout en exprimant sa reconnaissance d'avoir été sauvée lorsqu'elle avait quinze ans par un convoi de Terre des hommes, elle identifie les erreurs qui ont été commises lorsqu'il est venu le temps de raconter ce qui s'est passé.
Elle porte une réflexion profonde, juste et nuancée sur la mémoire collective, sur les gestes et les mots qui permettent aux récits de s'inscrire correctement dans L Histoire. Après trente ans, son livre est une invitation à l'empathie et à l'écoute, car suite à l'innommable, il est essentiel de donner enfin la place aux voix des survivants et des survivantes.
Dans "Le convoi", l'autrice nous livre un récit poignant de sa quête personnelle, tissant habilement sa propre histoire à celle d'une tragédie collective : le génocide des Tutsi au Rwanda en juin 1994.
Ayant elle-même échappé à la mort grâce à un convoi humanitaire suisse en 1994, elle entame, des années plus tard, une enquête minutieuse pour retrouver des traces de son passé. Cette quête, démarrée avec quatre photos envoyées par un journaliste de la BBC, devient le symbole d'une lutte pour la mémoire et la reconnaissance.
L'autrice explique vouloir passer à l'autobiographie après avoir écrit des oeuvres fictions pour illustrer son engagement en tant que passeuse d'histoire, consciente de l'importance de transmettre cette mémoire collective, notamment aux générations futures. Elle aborde avec justesse son rapport à l'écriture, et son engagement dans une recherche acharnée de traces de son passé et celui de sa communauté.
Le récit nous fait toucher de près à l'humanitaire, rendant un hommage vibrant à ceux qui ont risqué leurs vies pour sauver des enfants du génocide. Cette perspective apporte un éclairage nouveau sur les efforts de sauvetage durant cette période, montrant la complexité et le courage des opérations humanitaires.
Cette quête de photos la représentant elle et sa mère, qui l'amène à parcourir plusieurs pays, est alimentée par le désir de se réapproprier une mémoire souvent narrée par des voix extérieures qui nous ont donné une vision erronée de la situation à l'époque.
La réflexion sur le rôle des médias et la représentation du génocide est d'ailleurs bien écrite. Les victimes ont souvent été dépeintes par les journalistes occidentaux, comme souvent réduites à des figures passives de cette tragédie.
Ma découverte de l'histoire du Rwanda à travers ce livre a été éducative et vraiment passionnante. le témoignage de l'autrice, émouvant, puissant et parfois brutal de vérité, ne laisse pas indifférent, elle se met véritablement à nu et invite à une réflexion profonde sur la transmission de la mémoire. Elle s'interroge même sur sa légitimité à témoigner, mettant en lumière la complexité du statut de survivante. Un comble !
Ce récit, au-delà de son aspect autobiographique, s'impose comme un outil pédagogique essentiel, permettant de comprendre les mécanismes de survie, de résilience, et l'importance cruciale du témoignage et de la mémoire dans la construction de l'identité collective d'un pays.
Et à l'aube de la 30ème commémoration du génocide des Tutsi qui aura lieu en juin 2024, "Le convoi" résonne comme un appel impérieux à ne jamais oublier les leçons du passé.
A lire absolument !
Ayant elle-même échappé à la mort grâce à un convoi humanitaire suisse en 1994, elle entame, des années plus tard, une enquête minutieuse pour retrouver des traces de son passé. Cette quête, démarrée avec quatre photos envoyées par un journaliste de la BBC, devient le symbole d'une lutte pour la mémoire et la reconnaissance.
L'autrice explique vouloir passer à l'autobiographie après avoir écrit des oeuvres fictions pour illustrer son engagement en tant que passeuse d'histoire, consciente de l'importance de transmettre cette mémoire collective, notamment aux générations futures. Elle aborde avec justesse son rapport à l'écriture, et son engagement dans une recherche acharnée de traces de son passé et celui de sa communauté.
Le récit nous fait toucher de près à l'humanitaire, rendant un hommage vibrant à ceux qui ont risqué leurs vies pour sauver des enfants du génocide. Cette perspective apporte un éclairage nouveau sur les efforts de sauvetage durant cette période, montrant la complexité et le courage des opérations humanitaires.
Cette quête de photos la représentant elle et sa mère, qui l'amène à parcourir plusieurs pays, est alimentée par le désir de se réapproprier une mémoire souvent narrée par des voix extérieures qui nous ont donné une vision erronée de la situation à l'époque.
La réflexion sur le rôle des médias et la représentation du génocide est d'ailleurs bien écrite. Les victimes ont souvent été dépeintes par les journalistes occidentaux, comme souvent réduites à des figures passives de cette tragédie.
Ma découverte de l'histoire du Rwanda à travers ce livre a été éducative et vraiment passionnante. le témoignage de l'autrice, émouvant, puissant et parfois brutal de vérité, ne laisse pas indifférent, elle se met véritablement à nu et invite à une réflexion profonde sur la transmission de la mémoire. Elle s'interroge même sur sa légitimité à témoigner, mettant en lumière la complexité du statut de survivante. Un comble !
Ce récit, au-delà de son aspect autobiographique, s'impose comme un outil pédagogique essentiel, permettant de comprendre les mécanismes de survie, de résilience, et l'importance cruciale du témoignage et de la mémoire dans la construction de l'identité collective d'un pays.
Et à l'aube de la 30ème commémoration du génocide des Tutsi qui aura lieu en juin 2024, "Le convoi" résonne comme un appel impérieux à ne jamais oublier les leçons du passé.
A lire absolument !
J'ai été profondément émue en lisant ce témoignage.
J'ai lu, je crois à peu près tout ce que Béata Umubyeyi Mairesse a écrit. J'ai toujours eu un faible pour Ejo, ma première rencontre avec cette auteure.
C'est ouvrage est qualifié d'essai chez l'éditeur (Flammarion). C'est loin de l'écriture à laquelle l'écrivaine m'avait habituée. J'y ai trouvé un fragment pur et dur de ce que vit un être humain, « pris » encore enfant et convoyé de façon brutale et inhumaine. Pas vraiment une biographie, non, juste un instant de vie, de survie.
Ce désir de retrouver des photos, ces quatre photos où elle et sa mère devraient se trouver. Une preuve, s'il lui en fallait une, qu'elles étaient parmi les réfugiés. Une image d'elle et de sa maman, un sourire peut-être.
Témoigner de l'intérieur, autrement que tous ces journalistes qui ne sont que regards, des observateurs qui ne vivent pas ce génocide. C'est important pour Béata de nous faire partager son vécu, ses peurs mais aussi ses espoirs et ses joies.
Elle raconte les associations, et plus particulièrement de « Terre des hommes » à l'origine du convoi. Elle raconte ces hommes et ces femmes qui ont aidés, parfois au risque de leur vie, des traitres aussi, et des brutes.
Il aura fallu beaucoup de temps à Béata pour poser ainsi sur le papier ses souvenirs. Il lui aura fallu le soutien inconditionnel de son mari, de quelques amis aussi.
Il lui faut témoigner, pour ses enfants bien sûr, mais aussi pour des gens comme moi, anonymes qui de ces drames ne connaissent que peu de choses. Ceux que veulent bien nous dire les médias, et les politiques. Pour qu'on soit plus attentifs à tous ces mouvements de population dont les raisons trop souvent nous échappent.
Lien : https://leslecturesdejoelle...
J'ai lu, je crois à peu près tout ce que Béata Umubyeyi Mairesse a écrit. J'ai toujours eu un faible pour Ejo, ma première rencontre avec cette auteure.
C'est ouvrage est qualifié d'essai chez l'éditeur (Flammarion). C'est loin de l'écriture à laquelle l'écrivaine m'avait habituée. J'y ai trouvé un fragment pur et dur de ce que vit un être humain, « pris » encore enfant et convoyé de façon brutale et inhumaine. Pas vraiment une biographie, non, juste un instant de vie, de survie.
Ce désir de retrouver des photos, ces quatre photos où elle et sa mère devraient se trouver. Une preuve, s'il lui en fallait une, qu'elles étaient parmi les réfugiés. Une image d'elle et de sa maman, un sourire peut-être.
Témoigner de l'intérieur, autrement que tous ces journalistes qui ne sont que regards, des observateurs qui ne vivent pas ce génocide. C'est important pour Béata de nous faire partager son vécu, ses peurs mais aussi ses espoirs et ses joies.
Elle raconte les associations, et plus particulièrement de « Terre des hommes » à l'origine du convoi. Elle raconte ces hommes et ces femmes qui ont aidés, parfois au risque de leur vie, des traitres aussi, et des brutes.
Il aura fallu beaucoup de temps à Béata pour poser ainsi sur le papier ses souvenirs. Il lui aura fallu le soutien inconditionnel de son mari, de quelques amis aussi.
Il lui faut témoigner, pour ses enfants bien sûr, mais aussi pour des gens comme moi, anonymes qui de ces drames ne connaissent que peu de choses. Ceux que veulent bien nous dire les médias, et les politiques. Pour qu'on soit plus attentifs à tous ces mouvements de population dont les raisons trop souvent nous échappent.
Lien : https://leslecturesdejoelle...
J'ai eu beaucoup de mal à écrire cet avis, à mettre mes idées en ordre, je suis d'avance désolée si c'est un peu confus et que ça part dans tous les sens.
Il y a trente ans, Beata Umubyeyi Mairesse échappe à la mort avec sa mère. Elle est une adolescente qu'on extirpe de l'enfance par la violence des hommes. Elles passent la frontière grâce à une opération de sauvetage menée par des humanitaires : un convoi, Terre des Hommes.
Depuis trente ans, Beata Umubyeyi Mairesse est une survivante tutsi.
Après avoir écrit plusieurs fictions qu'elle définit inspirées de faits réels mais avec la lucidité de créer une mise à distance autant pour elle, autrice que pour son lecteur, Beata Umubyeyi Mairesse, se lance dans un processus d'écriture de reconstitution de la vérité des victimes du génocide des Tutsi qui a eu lieu en 1994 au Rwanda.
Intervenant régulièrement pour de la sensibilisation et de la prévention, pour « raconter son histoire », la légitimité de son statut de survivante est souvent remise en cause, parfois avec même avec négation, comme cette éditrice qui lui rappelle avec un racisme décomplexé comme on en voit encore trop, qu'il y a déjà une écrivaine rwandaise dans la sphère littéraire française…comme s'il n'y avait pas de place pour d'autres écrivains et écrivaines africains.
Au détour d'une conversation, des amis lui rappellent qu'ils les ont vues, elle et sa mère, dans un reportage diffusé sur la BBC. Point de départ d'une longue investigation pour retrouver ce documentaire qui l'a mène à se souvenir, à définir ce qu'est une survivante, une victime et à rendre hommage à l'importance de leurs parole. Elle retrouve des photographies de ceux et celles qui ont pensées, organisées, aidées aux passages des convois de la vie.
Beata Umubyeyi Mairesse s'interroge sur la forme du récit, sur les assignations et les injonctions paradoxales des uns et des autres dont elle ne sait quoi faire. À sa légitimité en tant que rescapée privilégiée. Parce qu'il est nécessaire de rappeler qu'il est essentiel de raconter pour préserver la mémoire.
La force de ce récit est autant dans la démarche que dans les intentions : remettre au coeur du récit la parole des victimes du génocide des Tutsi. S'interroger sur les conséquences traumatiques d'un récit, raconter une histoire collective tout autant qu'intime. D'ailleurs, tout au long du récit qu'elle déroule avec énormément d'émotion et de courage, elle ne peut pas cesser de s'interroger sur les liens avec le génocide de la Shoah ! Et mettre en lien et opposition les Convois de la mort à ceux des Convois de la Vie.
L'emploi du Je, de la premier personne, écrit son passé au présent pour abolir les distances entre la jeune d'aujourd'hui et l'adolescente du passé.
Dans la troisième partie, elle s'interroge sur le photojournalisme, porteur de la toute puissance du monde Occidental, en s'appuyant sur l'analyse très juste de Susan Sontag dans notamment Dans la Douleur, sur ce que voit l'autre, le photographié, la victime photographiée. Les institutions qui bloquent l'accès d'une partie de vie, de mémoire aux victimes, ce qui leur est de droit, devrait leur appartenir. Les gens utilisent les mots à la lègère. L'autrice nous rappelle l'importance de l'utilisation des mots, comme par exemple définir le génocide des tutsi comme génocide du Rwanda…c'est problématique car ça fausse la perception de la réalité. Les légendes qui accompagnent les photographies des victimes sont l'interprétation des photographes et des journaux et ont une responsabilité très lourdes sur la manière dont les victimes et l'histoire sont perçues, elle devient leur histoire officielle. Ce qui est extrêmement problématique car c'est une vérité étonnée.
C'est une des raisons qui prouvent qu'il est essentiel que les victimes d'hier racontent leur vérité, qu'il légende leur histoire avec leur langage loin de la silencialisation que le photojournalisme a pu créer.
Elle s'interroge sur les limites et les déboires de l'humanitaire. Mais surtout elle rappelle qu'il est important que les récits des victimes soient au centre de la mémoire collective qui se construit dans le monde, depuis 1994, que ces victimes soient entendus. Dans la troisième partie, elle récolte les souvenirs et les témoignages d'autres survivants et survivantes qu'elle retranscrit.
Alors oui c'est un ouvrage qui marque sur la capacité de l'Homme à être horrifique et tortionnaire, j'ai encore en tête les coups de machette, l'injustice, leur peur et leur humiliation à être considéré comme des cafards, cette femme enceinte détruite et découpée…mais c'est aussi un ouvrage qui appelle à la vérité, à la résilience, à l'humanité. Cet ouvrage m'a bouleversé, m'a fait prendre conscience à quel point je suis ignorante, peu informée et que je manque cruellement de curiosité quant à l'histoire du monde. Je crois que cet ouvrage m'a ouvert les yeux sur mon rapport au monde et à l'importance du témoignage.
**Lu dans le cadre du Grand Prix des Lectrices ELLE - lauréat du mois de janvier dans la catégorie Non-Fiction
Il y a trente ans, Beata Umubyeyi Mairesse échappe à la mort avec sa mère. Elle est une adolescente qu'on extirpe de l'enfance par la violence des hommes. Elles passent la frontière grâce à une opération de sauvetage menée par des humanitaires : un convoi, Terre des Hommes.
Depuis trente ans, Beata Umubyeyi Mairesse est une survivante tutsi.
Après avoir écrit plusieurs fictions qu'elle définit inspirées de faits réels mais avec la lucidité de créer une mise à distance autant pour elle, autrice que pour son lecteur, Beata Umubyeyi Mairesse, se lance dans un processus d'écriture de reconstitution de la vérité des victimes du génocide des Tutsi qui a eu lieu en 1994 au Rwanda.
Intervenant régulièrement pour de la sensibilisation et de la prévention, pour « raconter son histoire », la légitimité de son statut de survivante est souvent remise en cause, parfois avec même avec négation, comme cette éditrice qui lui rappelle avec un racisme décomplexé comme on en voit encore trop, qu'il y a déjà une écrivaine rwandaise dans la sphère littéraire française…comme s'il n'y avait pas de place pour d'autres écrivains et écrivaines africains.
Au détour d'une conversation, des amis lui rappellent qu'ils les ont vues, elle et sa mère, dans un reportage diffusé sur la BBC. Point de départ d'une longue investigation pour retrouver ce documentaire qui l'a mène à se souvenir, à définir ce qu'est une survivante, une victime et à rendre hommage à l'importance de leurs parole. Elle retrouve des photographies de ceux et celles qui ont pensées, organisées, aidées aux passages des convois de la vie.
Beata Umubyeyi Mairesse s'interroge sur la forme du récit, sur les assignations et les injonctions paradoxales des uns et des autres dont elle ne sait quoi faire. À sa légitimité en tant que rescapée privilégiée. Parce qu'il est nécessaire de rappeler qu'il est essentiel de raconter pour préserver la mémoire.
La force de ce récit est autant dans la démarche que dans les intentions : remettre au coeur du récit la parole des victimes du génocide des Tutsi. S'interroger sur les conséquences traumatiques d'un récit, raconter une histoire collective tout autant qu'intime. D'ailleurs, tout au long du récit qu'elle déroule avec énormément d'émotion et de courage, elle ne peut pas cesser de s'interroger sur les liens avec le génocide de la Shoah ! Et mettre en lien et opposition les Convois de la mort à ceux des Convois de la Vie.
L'emploi du Je, de la premier personne, écrit son passé au présent pour abolir les distances entre la jeune d'aujourd'hui et l'adolescente du passé.
Dans la troisième partie, elle s'interroge sur le photojournalisme, porteur de la toute puissance du monde Occidental, en s'appuyant sur l'analyse très juste de Susan Sontag dans notamment Dans la Douleur, sur ce que voit l'autre, le photographié, la victime photographiée. Les institutions qui bloquent l'accès d'une partie de vie, de mémoire aux victimes, ce qui leur est de droit, devrait leur appartenir. Les gens utilisent les mots à la lègère. L'autrice nous rappelle l'importance de l'utilisation des mots, comme par exemple définir le génocide des tutsi comme génocide du Rwanda…c'est problématique car ça fausse la perception de la réalité. Les légendes qui accompagnent les photographies des victimes sont l'interprétation des photographes et des journaux et ont une responsabilité très lourdes sur la manière dont les victimes et l'histoire sont perçues, elle devient leur histoire officielle. Ce qui est extrêmement problématique car c'est une vérité étonnée.
C'est une des raisons qui prouvent qu'il est essentiel que les victimes d'hier racontent leur vérité, qu'il légende leur histoire avec leur langage loin de la silencialisation que le photojournalisme a pu créer.
Elle s'interroge sur les limites et les déboires de l'humanitaire. Mais surtout elle rappelle qu'il est important que les récits des victimes soient au centre de la mémoire collective qui se construit dans le monde, depuis 1994, que ces victimes soient entendus. Dans la troisième partie, elle récolte les souvenirs et les témoignages d'autres survivants et survivantes qu'elle retranscrit.
Alors oui c'est un ouvrage qui marque sur la capacité de l'Homme à être horrifique et tortionnaire, j'ai encore en tête les coups de machette, l'injustice, leur peur et leur humiliation à être considéré comme des cafards, cette femme enceinte détruite et découpée…mais c'est aussi un ouvrage qui appelle à la vérité, à la résilience, à l'humanité. Cet ouvrage m'a bouleversé, m'a fait prendre conscience à quel point je suis ignorante, peu informée et que je manque cruellement de curiosité quant à l'histoire du monde. Je crois que cet ouvrage m'a ouvert les yeux sur mon rapport au monde et à l'importance du témoignage.
**Lu dans le cadre du Grand Prix des Lectrices ELLE - lauréat du mois de janvier dans la catégorie Non-Fiction
Le génocide des Tutsis au Rwanda a 30 ans … Que reste-t-il dans nos mémoires de cet événement tragique, alors que la guerre éclate à nouveau, que la mort rôde et tue des innocents ?
Beata Umubyeyi Mairesse a 15 ans lorsqu'elle fuit son pays avec sa mère grâce à un convoi humanitaire organisé par l'ONG suisse Terre des hommes. Des années plus tard, elle se lance dans une enquête minutieuse afin de reconstituer les événements de cette journée et peut-être de retrouver les personnes qui lui ont sauvé la vie.
Sur les traces des reporters de la BBC qui ont filmé le convoi, des humanitaires de l'ONG mais également des autres enfants rescapés, elle va écrire un récit aussi captivant que bouleversant. Dans la reconstitution des faits, pour elle c'est une véritable thérapie, mais c'est également un devoir de mémoire, une transmission pour les générations à venir. Afin de ne pas oublier !
Beata Umubyeyi Mairesse a 15 ans lorsqu'elle fuit son pays avec sa mère grâce à un convoi humanitaire organisé par l'ONG suisse Terre des hommes. Des années plus tard, elle se lance dans une enquête minutieuse afin de reconstituer les événements de cette journée et peut-être de retrouver les personnes qui lui ont sauvé la vie.
Sur les traces des reporters de la BBC qui ont filmé le convoi, des humanitaires de l'ONG mais également des autres enfants rescapés, elle va écrire un récit aussi captivant que bouleversant. Dans la reconstitution des faits, pour elle c'est une véritable thérapie, mais c'est également un devoir de mémoire, une transmission pour les générations à venir. Afin de ne pas oublier !
Beata Umubyeyi Mairesse fait partie des miraculés. Rescapée du génocide rwandais à l'âge de 15 ans grâce à un convoi humanitaire, elle se lance des années plus tard dans une enquête pour reconstituer les événements de cette journée et retrouver les personnes qui lui ont sauvé la vie.
Son enquête, parsemée d'embûches, la mènera sur les traces des reporters de la BBC ayant filmé le convoi, des humanitaires ayant organisé l'opération, mais également des autres enfants rescapés.
Son récit est captivant et bouleversant, et détient une grande force littéraire.
On découvre avec effroi le témoignage poignant de ce qu'elle a vécu, de son quotidien durant le génocide, une reconstitution marquante des faits d'après son point de vue. Cette narration s'entrelace avec les avancées ou difficultés de son enquête, sa soif de savoir et de réappropriation de son histoire.
Il ne s'agit pas ici que d'un témoignage personnel. L'autrice nous montre l'importance cruciale qu'ont, pour les rescapés, la transmission des informations et du savoir, la reconstitution des faits, le devoir de mémoire, et l'appropriation d'images journalistiques destinées à un public occidental.
Il s'agit d'une oeuvre forte et importante de mémoire, qui donne voix aux victimes et leur permet de se réapproprier leur histoire.
Son enquête, parsemée d'embûches, la mènera sur les traces des reporters de la BBC ayant filmé le convoi, des humanitaires ayant organisé l'opération, mais également des autres enfants rescapés.
Son récit est captivant et bouleversant, et détient une grande force littéraire.
On découvre avec effroi le témoignage poignant de ce qu'elle a vécu, de son quotidien durant le génocide, une reconstitution marquante des faits d'après son point de vue. Cette narration s'entrelace avec les avancées ou difficultés de son enquête, sa soif de savoir et de réappropriation de son histoire.
Il ne s'agit pas ici que d'un témoignage personnel. L'autrice nous montre l'importance cruciale qu'ont, pour les rescapés, la transmission des informations et du savoir, la reconstitution des faits, le devoir de mémoire, et l'appropriation d'images journalistiques destinées à un public occidental.
Il s'agit d'une oeuvre forte et importante de mémoire, qui donne voix aux victimes et leur permet de se réapproprier leur histoire.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Beata Umubyeyi Mairesse (9)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1744 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1744 lecteurs ont répondu